Depuis longtemps, l'État n'est pas seulement un arbitre, mais aussi un acteur majeur sur des marchés tels que la banque, l'énergie, les télécommunications et le foncier. Lorsqu'il joue ce rôle, les ressources se concentrent naturellement sur lui, créant des distorsions pour les autres acteurs présents sur le marché, n'est-ce pas ?
Dr. Tran Dinh Thien : Ici, la question centrale n'est pas seulement de savoir si l'État doit participer au marché ou non, mais aussi : l'État fait-il une discrimination entre son secteur et le secteur privé ou non ?
C’est cette question institutionnelle qu’il convient d’examiner attentivement dans les prochains mois. Car si l’État continue de jouer à la fois le rôle d’arbitre et d’acteur, le principe d’égalité du marché restera lettre morte, et toutes les réformes n’auront aucune portée.
Nous sommes issus d'une économie planifiée, où l'État est quasiment le seul acteur, assumant l'intégralité des rôles de régulation, de production et de distribution. Lors du passage à une économie de marché, le rôle de l'État aurait dû se restreindre progressivement, passant de celui d'« exécutant » à celui de « créateur », de celui de « sujet de production » à celui de « sujet de coordination et de contrôle ».
Cependant, nous avons longtemps soutenu que l'économie d'État était la « principale » et la « plus importante », tandis que le secteur privé – bien que représentant la majorité des entreprises et des emplois – était toujours considéré comme une « composante supplémentaire ».
Ce n'est qu'aujourd'hui que le Vietnam a officiellement identifié l'économie privée comme le principal moteur de son économie.

M. Tran Dinh Thien : Les gens et les entreprises y croient parce qu'ils constatent de réels changements – des résolutions aux lois et aux actions.
Dans une économie de marché, l’État doit comprendre que le secteur privé est l’acteur principal, son rôle étant celui de facilitateur : créer les conditions favorables, apporter un soutien et superviser. Bien que le secteur privé demeure fragile, les politiques publiques doivent viser à le développer et à le protéger, et ne sauraient tolérer une inversion des rôles : l’État détenant la majorité des ressources tandis que le secteur privé ne joue qu’un rôle de soutien.
Cette approche constitue une forme de discrimination, contraire aux principes de l'économie de marché. Le principe fondamental doit être l'égalité de statut juridique, d'accès aux ressources et aux opportunités pour tous les acteurs économiques.
Autrement dit : si l’État contrôle de nombreuses centrales électriques alors que le secteur privé n’est pas encore en mesure d’y participer, il doit assumer temporairement ce rôle. Mais, parallèlement, il doit préparer le terrain pour que le secteur privé puisse y participer ; il ne peut pas monopoliser indéfiniment le secteur simplement parce qu’il en tire profit.
Il ne s'agit pas d'opposer l'État au secteur privé, mais de répartir les ressources selon les principes de non-discrimination, d'ouverture et de transparence.
En réalité, de nombreuses lois actuelles conservent des traces de discrimination. Par exemple, le concept selon lequel « l’économie d’État est le pilier de l’économie nationale » est pertinent, car ce secteur économique englobe la majeure partie des ressources nationales : budget, ressources naturelles, terres, entreprises publiques, etc.
C’est exact en principe, mais il convient de bien le comprendre : concernant les terres, l’État n’en est que le représentant ; concernant le budget, il appartient à l’ensemble du peuple et non à l’État. Par conséquent, toutes les entités – qu’elles soient publiques ou privées – doivent y avoir un accès égal.
Par conséquent, le mécanisme d’allocation des ressources nationales – notamment foncières et budgétaires – doit respecter les principes de non-discrimination, d’ouverture, de transparence et reposer sur une véritable concurrence.
Quant aux entreprises publiques, la part qui relève véritablement du domaine public doit être gérée de manière transparente, professionnelle et publique. Si l'État continue de contrôler des secteurs d'activité, de l'énergie à la banque, sans mécanisme de contrôle du marché, l'efficacité ne pourra jamais être optimale. Dans les secteurs où les ressources sont équitablement réparties, où règne la concurrence et où il n'y a pas de discrimination, l'efficacité est toujours remarquable. Le marché public concurrentiel des biens en est un exemple. On constate que les biens ne sont jamais en pénurie, que les prix sont toujours compétitifs et qu'aucune intervention n'est nécessaire.

Levons tous les obstacles, qu'ils soient liés à la perception ou aux institutions, et nous connaîtrons un développement spectaculaire. Photo : Hoang Ha
Dans de nombreux documents de congrès, la « pensée novatrice » et l’exigence d’« allouer les ressources selon les principes du marché » sont constamment évoquées. Comment percevez-vous cette réalité ?
C’est un point délicat, car nous n’avons toujours pas de système qui encourage véritablement l’économie privée. Inconsciemment, beaucoup conservent l’idée que l’« économie privée » est synonyme d’exploitation. C’est cette obsession qui explique que le secteur privé, bien que reconnu, soit exclu en profondeur des politiques publiques.
C’est pourquoi j’ai dit que considérer l’économie privée comme le principal moteur cette fois-ci constitue essentiellement une libération de la pensée – une « véritable libération », et non pas de vaines paroles.
Car lorsque les mentalités auront évolué, les politiques mises en place ne seront plus entachées par l'idée que le secteur privé est synonyme d'exploitation. Au contraire, c'est le secteur économique privé qui incarne le mieux l'esprit socialiste. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui crée 82 % des emplois et contribue à améliorer le quotidien de la majorité des travailleurs. Il y a vingt ou trente ans, je disais souvent aux hauts dirigeants : « C'est le secteur privé qui est le plus socialiste. »
Car elles créent des emplois, génèrent des revenus, contribuent à la réduction de la pauvreté et améliorent le bien-être social. Si l'État crée les conditions propices à un développement solide du secteur privé, celui-ci peut accomplir encore plus de choses bénéfiques pour la population – et c'est là l'essence même du socialisme moderne.
Par conséquent, l’enjeu aujourd’hui n’est pas seulement l’innovation politique, mais plus profondément la libération idéologique – échapper à l’obsession selon laquelle « l’économie privée » est exploiteuse.
Nous traversons un processus de « libération » et de « renouveau » de la perception et de la pensée. Mais il est vrai que l'étape la plus difficile se situe au niveau fondamental de la pensée, car tout au long de l'histoire, notre société a été hantée par l'idée que « les riches sont des exploiteurs », que s'enrichir est contraire à l'esprit d'« équité ».
Heureusement, le secteur privé est désormais reconnu comme le principal moteur du développement. En levant tous les obstacles, qu'ils soient d'ordre mental ou institutionnel, je suis convaincu que nous connaîtrons un développement spectaculaire.
Le problème, c'est qu'une série de résolutions à vocation réformatrice ont été adoptées très rapidement, avec un engagement et une détermination remarquables. Parallèlement , l'Assemblée nationale et le gouvernement ont également adopté des résolutions…
Nous disons que les expressions « innovation de pensée », « allocation des ressources fondée sur le marché » ou « percée institutionnelle » sont plus convaincantes, car elles constituent des résultats concrets et aboutis de la pratique.
Par exemple, l'affirmation selon laquelle « l'économie privée est le principal moteur du développement » et que la science et la technologie doivent guider le développement doit devenir le moteur de ce dernier, et non un simple slogan. De même, l'engagement selon lequel « les percées institutionnelles doivent être des percées à l'origine de percées » a fait l'objet d'un large consensus.
Aujourd'hui, l'innovation intellectuelle est bien plus forte. Les particuliers et les entreprises y croient car ils constatent de réels changements, qu'il s'agisse de résolutions, de lois ou d'actions concrètes.
Cette fois, nous choisissons la percée par excellence : l’institution. Mais même une « percée institutionnelle » doit avoir des coordonnées précises, et non des termes généraux.
Par exemple, aucune avancée majeure n'a été réalisée en matière de droit foncier depuis de nombreuses années car cela touche à des intérêts particuliers. Si nous voulons que le marché foncier fonctionne, nous devons briser la structure des intérêts dominants, tout comme nous avons brisé le monopole dans le secteur commercial auparavant.
Le principal avantage du marché foncier réside toujours dans les liens entre l'appareil d'État et les spéculateurs. Par conséquent, la clé de la réforme foncière est un système de tarification transparent.
À l'heure actuelle, nous n'avons pas encore clairement défini ce que sont les prix fonciers – les prix du marché, le mécanisme de fixation des prix et les moyens de garantir un développement équitable. Si le marché ne peut instaurer une équité absolue, il peut néanmoins créer une concurrence loyale, conduisant à une répartition plus raisonnable et équilibrée des ressources.
Si cela est possible, la nouvelle loi foncière permettra véritablement de libérer des ressources et d'ouvrir le marché.
Vietnamnet.vn
Source : https://vietnamnet.vn/chung-ta-se-phat-trien-ngoan-muc-2462577.html





![[Photo] Art unique de la peinture des masques Tuong](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/14/1763094089301_ndo_br_1-jpg.webp)

![[Photo] Architecture unique de la station de métro la plus profonde de France](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/14/1763107592365_ga-sau-nhat-nuoc-phap-duy-1-6403-jpg.webp)















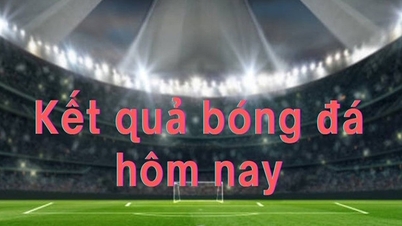




![[Photo] Cours spécial à Tra Linh](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/14/1763078485441_ndo_br_lop-hoc-7-jpg.webp)



















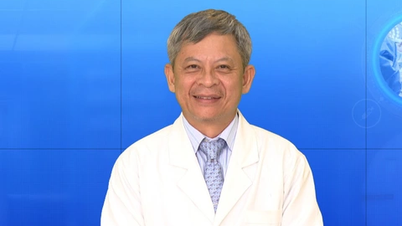
















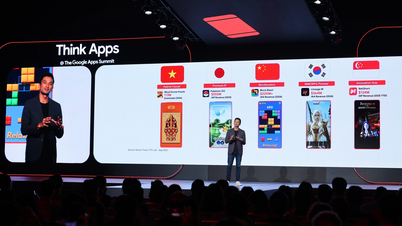





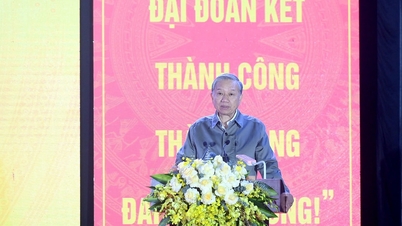




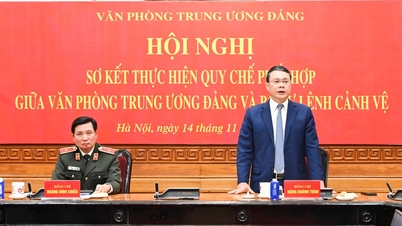























Comment (0)