Dans un monde en pleine mutation, marqué par la révolution technologique et l'intelligence artificielle (IA), l'éducation , considérée comme la priorité nationale absolue, est confrontée à des défis sans précédent. Le Vietnam, qui ambitionne de devenir un pays développé d'ici le milieu du XXIe siècle, ne pourra atteindre cet objectif sans repenser son approche de l'éducation en l'orientant vers une stratégie intégrée et une gouvernance moderne.
Le projet de document du XIVe Congrès du Parti soulignait : « La mise en œuvre d’une innovation fondamentale et globale dans l’éducation et la formation n’est pas encore synchrone, manque de systématisation et demeure confuse. La mise en œuvre de la socialisation dans l’éducation et la formation montre des signes de déviation. La qualité de l’éducation et de la formation, notamment en matière de compétences, de personnalité, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, progresse lentement. L’éducation et la formation dans les zones reculées, isolées et à forte population minoritaire ethnique se heurtent encore à de nombreuses difficultés ; le régime et les politiques applicables aux enseignants restent inadéquats. »
Ces commentaires francs témoignent de la volonté d'affronter la vérité de front, révélant la nécessité de passer d'une « innovation locale » à une innovation dans la pensée et la gestion stratégique.
Lier l'éducation au destin national
Un pays ne peut progresser sans une vision stratégique pour sa population. Depuis de nombreuses années, l'éducation vietnamienne fait l'objet de discours ambitieux, mais sa mise en œuvre manque de cohérence. Chaque trimestre, chaque localité, voire chaque école, a ses propres « projets », parfois redondants et à court terme. Du changement constant des programmes scolaires à l'instabilité des examens et des évaluations, les élèves restent passifs et les établissements scolaires peinent à s'adapter, entravés par des mécanismes rigides et des exigences d'autonomie et d'innovation. Il en résulte une réalité : l'éducation n'est pas véritablement liée au destin de la nation et n'a pas été conçue comme une stratégie de développement durable.
Parallèlement, des pays dotés de systèmes éducatifs avancés comme la Finlande, le Japon ou Singapour ont une vision à long terme, fondée sur une philosophie humaniste et centrée sur l'humain, et concrétisée par un système politique stable et harmonieux. L'éducation vietnamienne a besoin d'une nouvelle approche stratégique : la considérer non seulement comme un secteur d'activité, mais aussi comme une responsabilité nationale ; non pas comme un simple enseignement, mais comme un investissement dans la compétitivité nationale. Il nous faut définir clairement que former les Vietnamiens du XXIe siècle, c'est former des citoyens du monde capables de s'intégrer et de faire preuve de créativité, tout en préservant leur identité nationale.

Forte intégration dans la compétition mondiale
L'intégration éducative ne se limite pas aux séjours d'études à l'étranger ou à la coopération internationale. Il s'agit d'un processus de normalisation et de modernisation du système éducatif selon les normes internationales, tout en respectant les spécificités vietnamiennes. Ces dernières années, nous avons constaté que de nombreuses universités, lycées et même écoles primaires ont introduit des programmes internationaux dans leurs cursus. Toutefois, cette intégration reste encore superficielle et n'a pas entraîné d'amélioration significative de la qualité de l'enseignement.
Parallèlement, le monde entre dans une période de concurrence féroce pour attirer des ressources humaines hautement qualifiées. Si le Vietnam ne s'intègre pas rapidement, son système éducatif accusera un retard, non seulement en matière de transmission des connaissances, mais aussi dans le développement de la créativité, de l'esprit critique et de l'adaptabilité – des qualités essentielles sur le marché du travail mondial.
Autonomiser les populations à la base, en lien avec l'efficacité
L'un des principaux obstacles à l'éducation aujourd'hui réside dans un système de gestion centralisé et rigide. Les écoles publiques sont souvent soumises à une série de réglementations en matière d'organisation, de personnel et de finances, ce qui entrave la capacité des chefs d'établissement à agir de manière proactive. Le système privilégie encore la « gestion » à l'« administration ». Les enseignants subissent une forte pression : dossiers, manuels, évaluations et concours extrascolaires, sans pour autant avoir la possibilité de participer à la planification et à l'innovation pédagogique. Les parents s'inquiètent d'un système scolaire trop administratif et d'un manque de créativité ; les élèves, quant à eux, estiment que leurs apprentissages manquent d'inspiration et de lien avec la réalité.
Parallèlement, la tendance mondiale s'oriente fortement vers une plus grande autonomie des établissements d'enseignement, considérés comme des « unités d'apprentissage autonomes » responsables de la qualité de leurs résultats. Autonomie ne rime pas avec laxisme, mais plutôt avec responsabilisation. Sans un modèle de gouvernance moderne – associant autorité, responsabilité et efficacité –, toute tentative d'innovation restera vaine.
Contrôle précis de la sortie : Connecté mais sans jeu
L’éducation moderne ne saurait être « fermée », mais doit adopter un modèle ouvert : flexible, interconnecté entre les différents niveaux d’enseignement, entre les universitaires et les professions, entre les établissements scolaires et la société. Toutefois, cette ouverture doit s’accompagner d’un contrôle de qualité au niveau du résultat final.
En réalité, de nombreux établissements, y compris des universités, continuent de privilégier les résultats d'admission. Les étudiants peuvent ainsi facilement passer d'un niveau à l'autre, mais leurs compétences réelles ne sont pas vérifiées.
Cela démontre que l'éducation a besoin d'un système d'évaluation standardisé, transparent et cohérent qui mesure non seulement les connaissances, mais aussi les aptitudes, les qualités et la capacité d'application. Ce modèle a été appliqué avec succès dans de nombreux pays, où les certificats, les compétences professionnelles et les acquis d'apprentissage sont évalués de manière indépendante, instaurant ainsi un climat de confiance entre les établissements scolaires, les apprenants et la société.
Surmonter le « goulot d’étranglement » grâce à une nouvelle vision
L’éducation au Vietnam se trouve à un tournant décisif : soit poursuivre des ajustements mineurs, soit s’engager résolument dans une phase de développement novatrice, forte d’une vision nouvelle et d’une réflexion stratégique nationale. Les obstacles qui persistent depuis des années – programmes scolaires trop chargés, mécanismes de gestion rigides, manque d’enseignants qualifiés, inégalités régionales – ont tous été clairement identifiés. Mais ce qui nous manque, ce n’est pas une solution, mais une vision ambitieuse, une vision qui ose aller jusqu’au bout, qui ose un changement fondamental.
L'histoire des réformes éducatives ressemble souvent à celle de « rafistoler une vieille chemise avec du fil neuf ». Chaque année voit apparaître des directives et des projets, mais rares sont les politiques mises en œuvre de manière suffisamment continue et durable pour produire des résultats pérennes.
Au niveau local, de nombreuses écoles doivent mener de front deux missions : transmettre des connaissances aux élèves tout en gérant les dossiers, les plans et les rapports. Dans les zones reculées, les enseignants doivent encore donner cours dans des classes sans électricité ni internet, tandis qu'en ville, les élèves subissent la pression des examens, des cours supplémentaires et de la course aux normes internationales. Cette transformation numérique excessive et incohérente, au lieu de permettre aux enseignants de gagner du temps pour se concentrer sur leur expertise, est devenue un fardeau pour les écoles.
Ces problèmes ne peuvent être résolus par de simples ajustements techniques. Il nous faut une vision systémique où l'éducation est perçue comme une chaîne de valeur, de la philosophie aux mécanismes financiers et administratifs, en passant par les programmes, le personnel et les programmes. Si la philosophie de l'éducation reste floue, si les enseignants ne sont pas dignes de confiance, si les apprenants sont encore considérés comme des « objets de communication » plutôt que comme des sujets créatifs, alors, quelles que soient nos innovations, nous reviendrons toujours au point de départ.
Une nouvelle vision de l'éducation vietnamienne doit viser à former des citoyens autonomes, créatifs et capables de s'intégrer à la société mondiale. Cette éducation ne se contente pas d'enseigner des connaissances, mais forme aussi aux méthodes d'apprentissage, à la réflexion et à l'art de vivre. Elle ne se limite pas aux murs de l'école, mais s'étend à la communauté, à la société et aux entreprises, où l'apprentissage tout au long de la vie devient un mode de vie.
Le XIVe Congrès du Parti devrait offrir l'opportunité de concrétiser cette vision. En plaçant l'éducation au cœur de la stratégie nationale de développement, tous les secteurs, de l'économie à la science, en passant par la culture et la défense nationale, bénéficieront de ressources humaines de haute qualité. L'éducation est non seulement le fondement, mais aussi le moteur de la quête de puissance.

Source : https://vietnamnet.vn/giao-duc-can-tu-duy-chien-luoc-va-quan-tri-hien-dai-de-vuot-qua-diem-nghen-2459646.html



![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh participe à une conférence pour examiner une année de déploiement des forces pour participer à la protection de la sécurité et de l'ordre au niveau local.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/12/1762957553775_dsc-2379-jpg.webp)

![[Photo] Autoroutes traversant Dong Nai](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/12/1762940149627_ndo_br_1-resize-5756-jpg.webp)






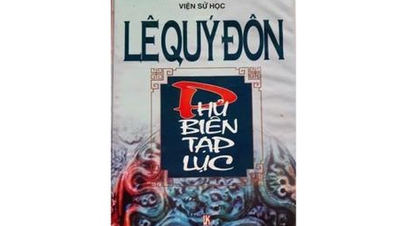

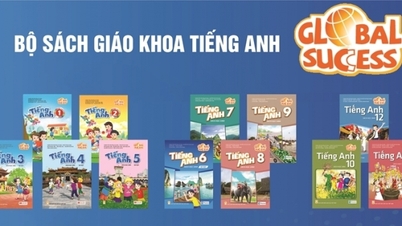

















































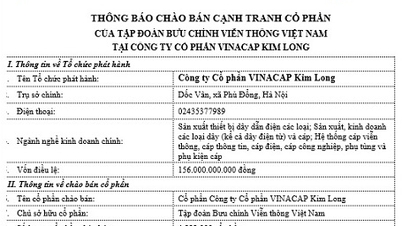








































![Transition de Dong Nai à l'OCOP : [Article 3] Lier le tourisme à la consommation de produits de l'OCOP](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)







Comment (0)