
Chaque pont, chaque ligne de métro, chaque réseau électrique ou chaque donnée nationale est une mesure de la discipline institutionnelle, de la capacité de coordination et de la confiance sociale.
Le contenu des avancées majeures en matière d'infrastructures proposé par le projet de rapport politique soumis au XIVe Congrès est le suivant : « Poursuivre la réalisation simultanée et significative de progrès dans la construction d'infrastructures socio -économiques ; notamment les infrastructures de transport multimodal, les infrastructures technologiques au service de la gestion, de la gouvernance et du processus de création du développement, les infrastructures au service de la transformation numérique, de la transformation verte, de la transformation énergétique et de l'adaptation au changement climatique. »
Cette avancée majeure doit être appréhendée dans une perspective systémique : il ne s’agit pas seulement d’accroître les investissements dans la construction, mais aussi d’améliorer la capacité opérationnelle de l’ensemble des infrastructures nationales. Cet article propose une nouvelle approche pour une transformation profonde des infrastructures, comprenant une méthode scientifique de définition des priorités, cinq piliers d’investissement stratégiques et un mécanisme de mise en œuvre moderne inspiré du modèle du Bureau national de gestion de projets (BNGP).
L’infrastructure – le fondement matériel du développement institutionnel
Après près de quatre décennies de mise en œuvre du processus du Doi Moi, le Vietnam a réalisé de grands progrès sur les plans économique, social et de l'intégration internationale. Cependant, pour entrer dans une nouvelle ère, Dans cette nouvelle ère de développement – l’ère de l’innovation, de l’écologisation et du développement durable –, notre pays a besoin d’un renforcement significatif de ses infrastructures économiques et sociales.
L'infrastructure ne se limite pas aux structures physiques ; elle englobe également la capacité opérationnelle d'un pays, c'est-à-dire son aptitude à relier les personnes, les entreprises, les régions et les chaînes de valeur. Une infrastructure moderne réduit les coûts de transaction, accroît la productivité et ouvre de nouvelles perspectives de développement. À l'inverse, une infrastructure défaillante constitue un frein majeur au développement.
Au cours des dernières années, et plus particulièrement durant la période 2021-2025, de nombreux investissements ont été réalisés dans des projets d'infrastructure d'envergure. Toutefois, il est essentiel de continuer à privilégier les infrastructures stratégiques, notamment en garantissant la synchronisation, la connectivité et les retombées positives. Le moment est venu de passer d'une logique de « construction de projets » à une logique de « construction de systèmes », en considérant l'infrastructure comme une composante institutionnelle des capacités nationales.
La nature de la « percée infrastructurelle » dans la nouvelle phase
« Percée » ne signifie pas seulement accélérer les investissements, mais aussi accroître la capacité opérationnelle de l’ensemble du système – mesurée en termes de temps, de coût et de fiabilité des flux de marchandises, de personnes, d’énergie et de données.
Une route n'a de véritable sens que lorsqu'elle relie des axes économiques, raccourcit les temps de transport et réduit les coûts logistiques. Un réseau électrique n'atteint son plein potentiel que lorsqu'il est capable de gérer intelligemment la production, de connecter les sources d'énergie renouvelables et de garantir la sécurité énergétique nationale. Une infrastructure numérique n'est véritablement utile que lorsqu'elle devient la colonne vertébrale de l'administration publique et de l'innovation.
Il est donc nécessaire de repenser les innovations en matière d'infrastructures : passer d'une approche axée sur l'« investissement d'expansion » à une approche axée sur la « conception opérationnelle », d'une vision sectorielle à une approche systémique, et d'une approche centrée sur le « coût d'investissement » à une approche axée sur l'« efficacité du cycle de vie ». Cette approche témoigne d'une vision institutionnelle et d'une capacité de gouvernance moderne.

La priorité devrait être accordée aux investissements dans (i) les infrastructures énergétiques – réseau électrique – stockage et gestion intelligente de l’énergie
Priorisation – les fondements scientifiques d’une vision à long terme
L’investissement dans les infrastructures est un domaine qui exige toujours des ressources considérables et un long délai de mise en œuvre. Dans un contexte de budget public limité, de maîtrise de la dette publique et de faible capacité de mobilisation des capitaux privés, il est indispensable de définir les priorités et de se concentrer sur les investissements clés afin d’éviter des investissements dispersés, redondants et inefficaces. Cette orientation majeure a été constamment mise en œuvre par le gouvernement durant la période 2021-2025.
Il est tout d'abord nécessaire d'unifier trois principes fondamentaux pour définir les priorités d'investissement dans les infrastructures :
1. Priorité aux goulots d’étranglement : concentrez-vous sur les goulots d’étranglement qui limitent la capacité de l’ensemble du système, tels que les infrastructures de transport d’électricité, les corridors logistiques interrégionaux ou les routes reliant les ports maritimes, les parcs industriels et les postes frontières ;
2. Privilégier les résultats aux projets (les résultats plutôt que les actifs) : ne pas utiliser le nombre de projets comme mesure de réussite, mais évaluer en fonction de résultats spécifiques - temps de trajet, coûts logistiques, réduction de la congestion et efficacité dans le service aux personnes et aux entreprises ;
3. Entretenir avant d’étendre : Investir dans l’entretien, la modernisation et l’optimisation du fonctionnement des ouvrages existants doit être considéré comme une forme d’investissement à haut rendement, contribuant à économiser le budget et à prolonger la durée de vie des biens publics.
Afin de garantir l'objectivité, il est nécessaire d'appliquer le système d'évaluation multicritères (EMC) à la sélection des projets. Chaque projet d'infrastructure doit être évalué selon un ensemble de critères précis, notamment : 1. Niveau d'impact systémique et d'efficacité socio-économique ; 2. Capacité à connecter les chaînes de valeur, les corridors économiques et les régions dynamiques ; 3. Impact sur l'adaptation au changement climatique et la réduction des émissions ; 4. Capacité à mobiliser des capitaux extrabudgétaires, en particulier par le biais de partenariats public-privé (PPP), d'obligations vertes et de crédits carbone ; 5. État de préparation à la mise en œuvre (autorisation foncière, documents de conception, capacité des entreprises) ; 6. Capacité à générer des revenus et à assurer des coûts d'exploitation et de maintenance durables.
Par ailleurs, quatre tests de « filtrage final » devraient être appliqués aux projets nationaux clés : 1. Test de point de blocage : Le projet est-il réellement situé sur un goulot d’étranglement important du réseau ? 2. Test de fiabilité : Le projet contribue-t-il à accroître la stabilité de la chaîne d’approvisionnement, à réduire les délais et les coûts de circulation ? 3. Test de viabilité financière : Le projet garantit-il la capacité d’équilibrer les investissements, de limiter leur augmentation et de maintenir des coûts de maintenance stables ? 4. Test de potentiel d’expansion : Le projet crée-t-il de nouvelles perspectives de développement, ouvrant la voie à de futures applications technologiques et à des investissements ultérieurs ?
L'application de ces principes et de ces tests garantit non seulement la transparence et la cohérence dans la sélection des investissements, mais contribue également à recentrer la gestion publique, passant de l'« approbation des projets » à la « gestion de la performance du portefeuille », c'est-à-dire à un mécanisme de gestion fondé sur des données probantes et des résultats. Ainsi, chaque capital investi dans les infrastructures ne se contente pas de créer un produit ou un projet spécifique, mais apporte également une nouvelle capacité de développement à l'économie nationale.
Cinq piliers stratégiques prioritaires pour la période 2026-2035
(1) Infrastructures énergétiques – réseau – stockage et gestion intelligente de l’énergie. Garantir la sécurité énergétique et promouvoir la transition écologique. Privilégier les investissements dans le transport interrégional, le stockage à grande échelle, la gestion intelligente de l’énergie et un marché de l’électricité pleinement concurrentiel.
Encourager les partenariats public-privé (PPP) dans le secteur de l'électricité et les contrats basés sur la disponibilité afin de mobiliser les capitaux privés.
(2) Corridors logistiques multimodaux et centres logistiques interrégionaux. Développer des corridors Nord-Sud et Est-Ouest reliant les ports maritimes, les postes frontières et les zones industrielles. Créer trois centres logistiques régionaux (Nord, Centre et Sud) au cœur de la coordination de la chaîne d'approvisionnement.
Objectif d'ici 2030 : réduire les coûts logistiques/PIB à un niveau inférieur à 10%.
(3) Transports publics urbains et développement axé sur les transports (DAT). Hanoï et Hô Chi Minh-Ville doivent privilégier les réseaux de métro, les bus à haut niveau de service (BHNS) et les rocades, en combinant la planification du DAT – développement urbain autour des stations – et en exploitant les différences de loyer foncier pour financer les infrastructures et le logement social.
(4) Infrastructure numérique et données ouvertes. L’infrastructure numérique est l’« infrastructure de l’infrastructure ». Investir dans des centres de données nationaux, le cloud computing gouvernemental (GovCloud) et un jumeau numérique national pour gérer les données intégrées relatives aux transports, à l’énergie, à l’eau et aux zones urbaines. La modélisation des données du bâtiment (BIM) doit être appliquée à 100 % des projets clés. (BIM) pour la gestion du cycle de vie des investissements.
(5) Infrastructures de prévention des inondations et d’adaptation aux changements climatiques.
Prioriser Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, le delta du Mékong et la côte centrale. Appliquer des normes de résilience, combiner construction et solutions naturelles et utiliser les crédits carbone comme outil financier complémentaire.
Mécanisme de mise en œuvre – De la détermination à la capacité d’action
Une stratégie d'infrastructure ne devient réalité que lorsqu'il existe un mécanisme de mise en œuvre suffisamment robuste.
En conséquence, il est possible de mettre en place un Bureau national de gestion de portefeuille de projets clés (BPG national), d'exploiter un système de tableau de bord public et de suivre chaque projet selon le modèle « feu tricolore » (rouge - jaune - vert).
Perfectionner le mécanisme de mobilisation des capitaux dans le sens d'un partenariat public-privé moderne, y compris le mécanisme de réexploitation des actifs publics pour réinvestir dans de nouvelles infrastructures (recyclage des actifs), le mécanisme de combinaison des capitaux publics, des capitaux de l'APD et des capitaux privés (financement mixte), ainsi que des formes de PPP et d'obligations vertes, afin d'élargir l'espace financier pour le développement durable des infrastructures.
Infrastructure – une mesure de la capacité de gouvernance
Les avancées majeures en matière d'infrastructures mettent à l'épreuve les capacités d'organisation et de gestion d'un pays. Un pays développé ne se définit pas uniquement par sa puissance économique, mais aussi par sa capacité à mener à bien des projets d'envergure dans les délais impartis, avec le niveau de qualité requis, et à générer une efficacité et des bénéfices durables. Chaque pont, chaque ligne de métro, chaque réseau électrique, chaque donnée nationale témoigne de la rigueur institutionnelle, de la capacité de coordination et de la confiance sociale.
Par conséquent, parallèlement aux avancées en matière d'infrastructures, il est nécessaire de réaliser des avancées institutionnelles (pour supprimer les contraintes juridiques et créer un espace flexible pour l'investissement) et des avancées en matière de ressources humaines (pour disposer d'une équipe d'ingénieurs, d'experts et de chefs de projet professionnels).
Percée majeure en matière d'infrastructures dans le cadre de la vision 2045
Si la Rénovation de 1986 a été une révolution des institutions économiques, alors le XIVe Congrès doit ouvrir une révolution des institutions d'infrastructure – une révolution de la pensée systémique, des normes durables et des capacités de mise en œuvre.
Chaque dollar investi dans les infrastructures doit être évalué en fonction de l'efficacité du système, de la productivité nationale et du bien-être de la population. Lorsque les infrastructures deviendront le moteur du pays, le Vietnam disposera de l'énergie, de la connectivité et de la résilience nécessaires pour entrer dans une ère de développement solide, moderne et durable d'ici 2045.
Dans cet esprit, je souhaiterais proposer de modifier le paragraphe relatif aux avancées en matière de développement des infrastructures dans le projet de rapport politique du XIVe Congrès national :
« (3) Créer une percée substantielle dans l’infrastructure économique et sociale, en assurant la synchronisation, la modernité, la connectivité et la durabilité. L’accent est mis sur le développement d’un système d’infrastructure de transport multimodal selon la logique des corridors - nœuds - liens régionaux, associé à une planification intégrée du territoire - des transports - de l’énergie - du numérique - de l’environnement.
Prioriser les investissements dans (i) l’infrastructure énergétique – réseau électrique – stockage et répartition intelligente ; (ii) les corridors logistiques stratégiques et les centres logistiques interrégionaux ; (iii) les grandes infrastructures urbaines avec des modèles de transport public et de développement axé sur le transport (TOD) ; (iv) l’infrastructure numérique comme base pour la gestion, la gouvernance et l’innovation ; (v) l’infrastructure pour l’adaptation au changement climatique et la prévention des inondations dans les zones vulnérables.
Perfectionner les institutions de mobilisation de capitaux en vue de partenariats public-privé (PPP) standardisés, d'obligations vertes, de crédits carbone, en assurant l'efficacité, la transparence et une capacité de maintenance durable.
Créer un Bureau national de gestion de portefeuille de projets clés (BGP) pour suivre l'avancement et la qualité des investissements. Fixer des objectifs de performance précis d'ici à 2035, tels que la réduction des coûts logistiques aux niveaux de l'ASEAN-4, l'augmentation de la part des transports verts, la garantie d'un approvisionnement stable en électricité et d'une infrastructure numérique couvrant les zones urbaines, en vue de constituer progressivement un réseau d'infrastructures vertes, numériques et résilientes, fondement d'un développement durable.
Nguyen Si Dung
Source : https://baochinhphu.vn/gop-y-du-thao-bao-cao-chinh-tri-dai-hoi-xiv-cua-dang-bai-2-dot-pha-phat-trien-ha-tang-khong-chi-tang-toc-dau-tu-ma-con-can-don-bay-the-che-102251031232724314.htm



![[Photo] Lam Dong : Images des dégâts suite à la rupture présumée d'un lac à Tuy Phong](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762078736805_8e7f5424f473782d2162-5118-jpg.webp)



![[Photo] Le président Luong Cuong reçoit le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762089839868_ndo_br_1-jpg.webp)















































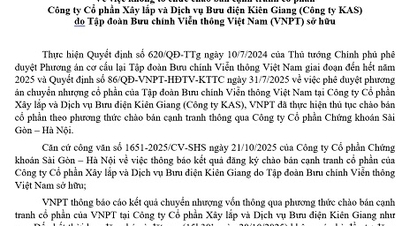







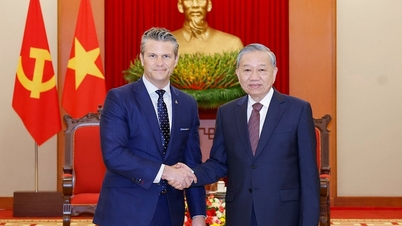
























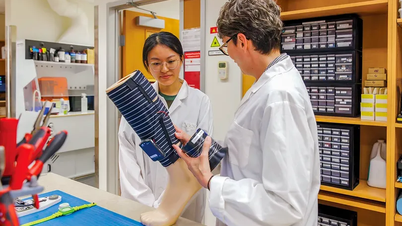















Comment (0)