
Historiquement, les conflits au Moyen-Orient ont été liés aux crises pétrolières mondiales. Lorsque les forces israéliennes, britanniques et françaises ont envahi l'Égypte en 1956, bloquant le canal de Suez, Londres et Paris ont imposé un rationnement du carburant. Pendant la guerre de 1973, un boycott arabe a plus que doublé les prix du pétrole. La révolution iranienne de 1979 a également fait doubler les prix mondiaux du pétrole. Les prix ont également brièvement atteint un pic pendant la guerre Irak-Koweït en 1990.
La crise actuelle de Gaza semblait initialement se dérouler de la même manière : les prix du pétrole sont passés d’environ 70 dollars le baril à plus de 90 dollars le baril après le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre 2023. Cependant, moins de deux semaines plus tard, les prix du brut américain West Texas Intermediate (WTI) sont retombés sous les 74 dollars le baril, tandis que le brut Brent est retombé sous les 80 dollars le baril.
En janvier 2024, les prix du pétrole ont de nouveau grimpé en flèche après une frappe menée par les États-Unis contre des cibles houthies au Yémen, en réponse aux attaques contre des navires commerciaux en mer Rouge. Les prix du brut ont également fluctué, Wall Street évaluant l'évolution des taux d'intérêt, du dollar et des conflits géopolitiques .
Cependant, ils sont encore loin des plus hauts enregistrés en 2022. À la fin de la dernière séance, le 16 février, le prix du brut léger américain (WTI) pour livraison en mars 2024 a augmenté de 1,16 USD (1,5 %) pour atteindre 79,19 USD/baril. Parallèlement, le prix du brut Brent de la mer du Nord pour livraison en avril 2024 a augmenté de 61 USD (0,7 %) pour atteindre 83,47 USD/baril.
L'affaiblissement de la demande pourrait rendre plus difficile la remontée des prix du pétrole. Le dernier rapport mensuel de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), publié le 15 février, prévoit un ralentissement de la croissance de la demande mondiale de pétrole, passant de 2,3 millions de barils par jour en 2023 à 1,2 million de barils par jour cette année. Ces prévisions reposent sur des données indiquant un ralentissement de la croissance de la demande, passant de 2,8 millions de barils par jour au troisième trimestre 2023 à 1,8 million de barils par jour au dernier trimestre de l'année dernière.
Dans le rapport, l’AIE estime que la croissance de la demande de pétrole perd de son élan alors que la phase d’expansion de la demande énergétique post-pandémique est en grande partie terminée.
Mais pour certaines économies , cette période de croissance a été faible. L'économie chinoise devait rebondir fortement en 2023 après un arrêt prolongé dû à la pandémie. Au lieu de cela, une crise du marché immobilier, une faible consommation et un chômage élevé des jeunes ont paralysé la deuxième économie mondiale. Certains économistes estiment que la Chine pourrait connaître des décennies de stagnation.
D'autres pays sont également confrontés à des récessions. Le Royaume-Uni est entré en récession après une baisse de 0,3 % de son produit intérieur brut (PIB) au dernier trimestre 2023, après une baisse de 0,1 % au trimestre précédent. Une récession est généralement définie comme deux trimestres consécutifs de baisse du PIB, mais peut également être définie par d'autres facteurs, comme un chômage élevé.
Le Japon est également entré en récession de manière inattendue, après que la faiblesse de la consommation intérieure a entraîné une contraction de son PIB pendant deux trimestres consécutifs. Cela a suffi à lui faire perdre sa place de troisième économie mondiale , se retrouvant derrière l'Allemagne.
L'économie américaine reste résiliente grâce aux hausses de taux agressives de la Réserve fédérale. Cependant, certains investisseurs et économistes préviennent que la première économie mondiale pourrait sombrer en récession d'ici fin 2024, les Américains réduisant leurs dépenses en raison des taux d'intérêt élevés et de leur épargne post-pandémique.
Alors que la croissance de la demande mondiale de pétrole ralentit, l’offre reste relativement forte, ce qui est susceptible d’exercer une pression à la baisse supplémentaire sur les prix du pétrole.
On estime que les États-Unis ont produit 13,3 millions de barils de pétrole brut et de condensat par jour au quatrième trimestre 2023, soit plus que n’importe quel autre pays de l’histoire.
En outre, plusieurs producteurs clés de l’OPEP et non-OPEP (OPEP+) ont produit plus de pétrole que les objectifs de production du groupe en janvier 2024. L’Irak a pompé 230 000 barils supplémentaires par jour et les Émirats arabes unis (EAU) ont pompé 300 000 barils supplémentaires par jour le mois dernier, selon le rapport de l’AIE.
Le rapport de l'AIE indique que la forte augmentation de l'offre mondiale de pétrole cette année, menée par les États-Unis, le Brésil, la Guyane et le Canada, éclipsera l'augmentation attendue de la demande mondiale de pétrole.
La croissance économique mondiale devrait ralentir cette année, malgré les baisses de taux anticipées, principalement en raison de l'impact sur l'activité commerciale et les dépenses de consommation d'une période prolongée de hausses de taux en 2022 et 2023, selon l'AIE.
Parallèlement, le rapport de l'OPEP publié le 13 février prévoyait une augmentation de la demande mondiale de pétrole de 2,25 millions de barils par jour en 2024 et de 1,85 million de barils par jour en 2025, inchangé par rapport aux prévisions du mois dernier. Ces deux niveaux sont considérés comme élevés par les observateurs du marché.
La divergence entre les prévisions de l'AIE et de l'OPEP rappelle les difficultés inhérentes à la prévision de la demande et des prix du pétrole sur les marchés complexes d'aujourd'hui. Les prévisions à court terme comme les avertissements à leur sujet peuvent être erronés. Jusqu'à présent, la crise de Gaza n'a guère contribué à induire de variations durables des prix, malgré les inquiétudes généralisées quant au scénario inverse.
Source


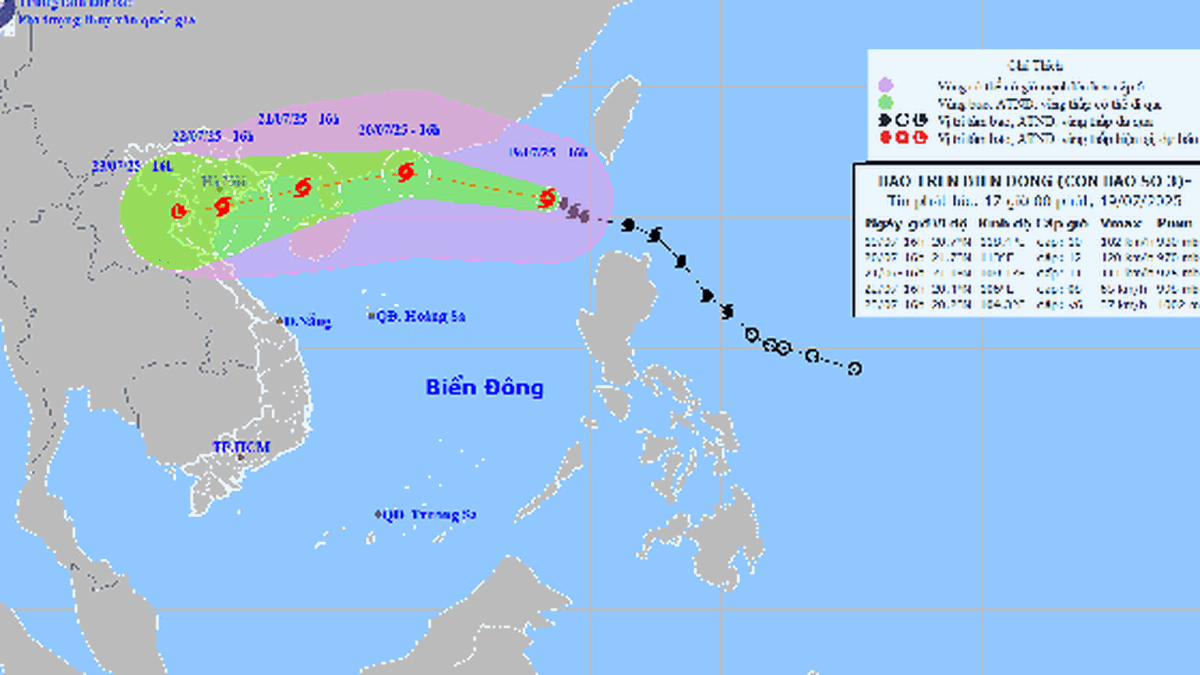

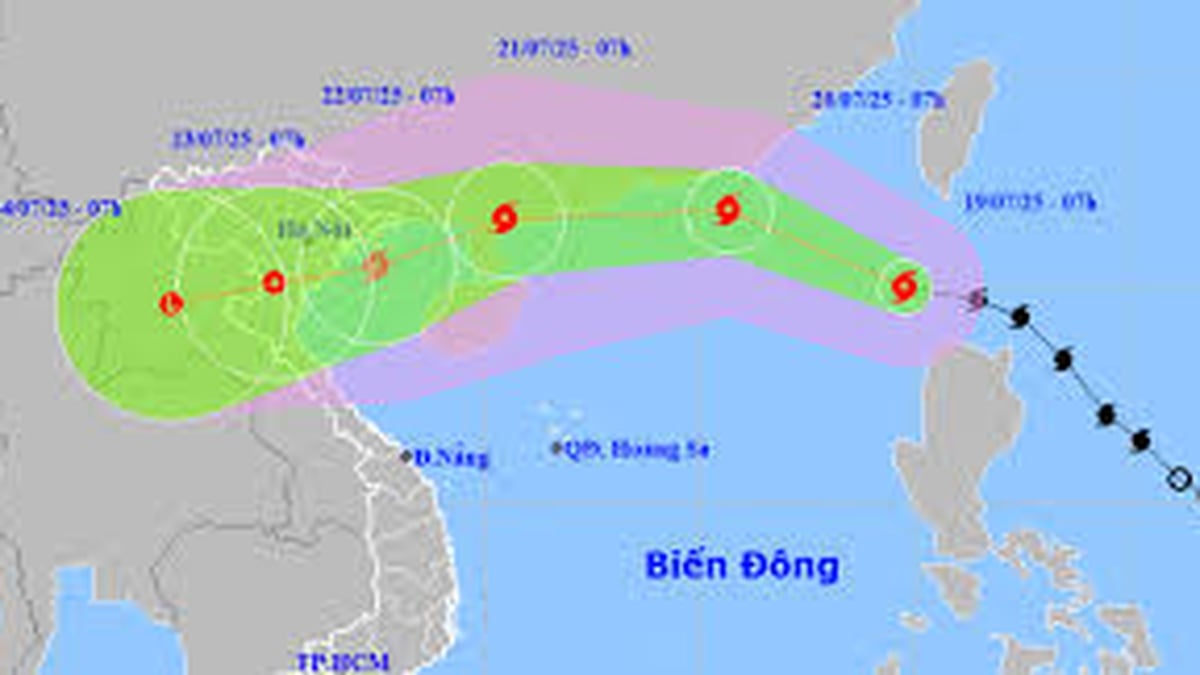






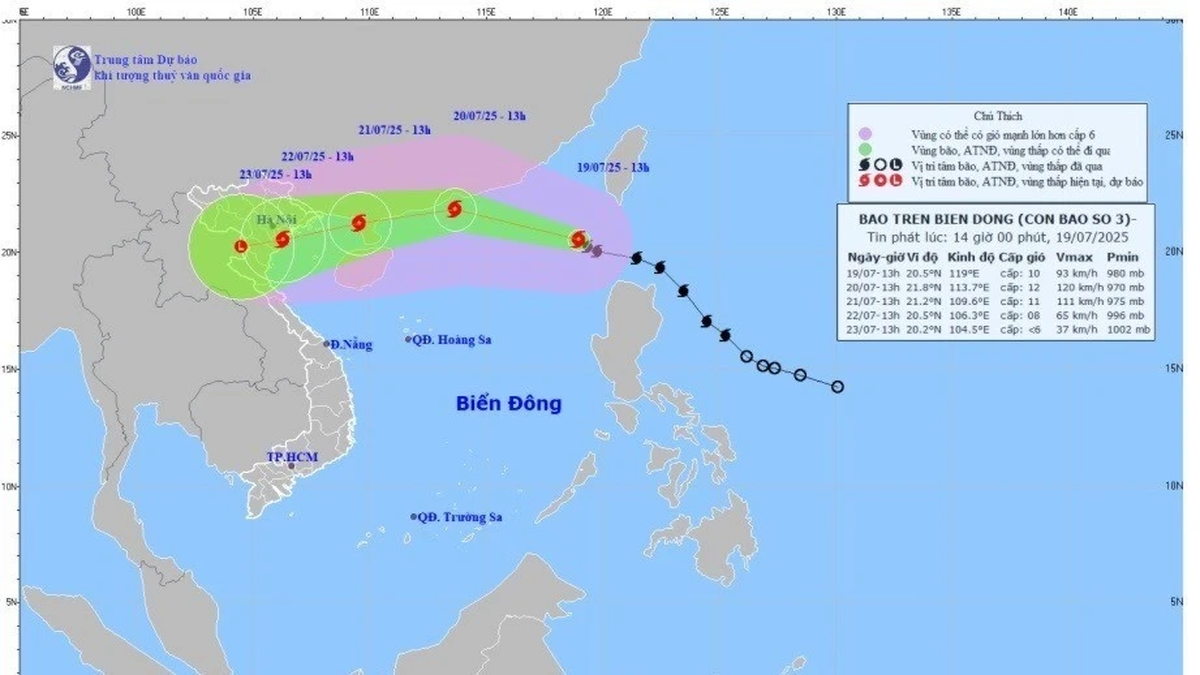






































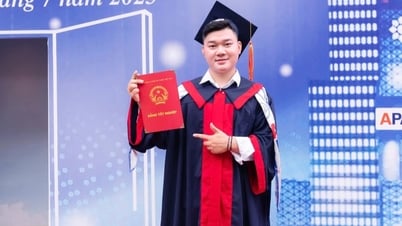
















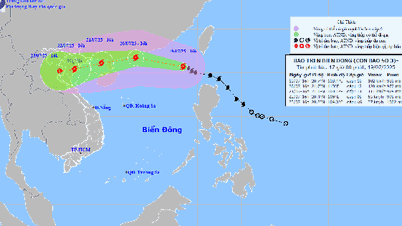































Comment (0)