
Renforcer la résilience de l'éducation dans les zones défavorisées
Au cours des dix premiers mois de 2025 seulement, onze tempêtes ont balayé les provinces et les villes du pays, causant de graves dommages au secteur de l'éducation. Plus de 1 000 établissements ont été touchés, des centaines d'écoles ont vu leurs toits arrachés et des milliers de salles de classe endommagées. La seule tempête n° 10 (Bualoi), fin septembre, a engendré des pertes de plus de 429 milliards de dongs pour Ha Tinh et de plus de 300 milliards de dongs pour Nghe An. De nombreux bâtiments ont subi des effondrements de murs, des arrachements de toits et des inondations qui ont endommagé le matériel situé au rez-de-chaussée.
Dans la région montagneuse du nord, des pluies atteignant 300 mm par jour ont provoqué des glissements de terrain et d'importantes inondations dans des dizaines d'écoles à Lao Cai, Tuyen Quang, Cao Bang et Lang Son. De nombreuses classes ont dû être évacuées et l'enseignement a été dispensé provisoirement, sans électricité ni eau potable. Après la tempête, les toits en tôle ondulée ont pu être reconstruits et de nouvelles salles de classe ont été bâties, mais les profondes séquelles de l'éducation dans ces zones difficiles restent encore visibles. Des milliers de classes de fortune, construites sur des sols instables, et de nombreuses écoles situées dans des zones à risque de glissements de terrain, ne répondent pas aux normes de sécurité ; le matériel, les tables, les chaises et les ordinateurs peuvent être emportés par une simple averse.
De ce constat d'apprentissage découle la leçon suivante : l'éducation dans les zones défavorisées doit s'attacher de manière proactive à renforcer la résilience, en commençant par la planification, les infrastructures, la gouvernance et les personnes.
Après la dixième tempête, le ministère de l'Éducation et de la Formation a demandé aux autorités locales d'évaluer la sécurité de chaque école, de se concerter avec les secteurs de la construction et des ressources environnementales afin de déterminer l'emplacement, les fondations et les matériaux, et d'établir de nouvelles normes pour des « écoles sûres en cas de catastrophe naturelle ». Certaines provinces ont pris l'initiative de relocaliser des écoles situées dans des zones à risque de glissement de terrain, en utilisant des matériaux légers, des toits en pente, des fondations surélevées et un bon drainage, témoignant ainsi d'une approche préventive dès la conception.
Parallèlement, la flexibilité de gestion est considérée comme essentielle au maintien de l'enseignement et de l'apprentissage : de nombreux établissements scolaires ont élaboré des plans d'intervention, basculé rapidement vers l'enseignement en ligne, organisé des classes temporaires et regroupé les élèves afin d'éviter toute interruption des programmes. Toutefois, les disparités observées entre les localités soulignent la nécessité de mettre en place un plan d'intervention unifié et un système d'alerte précoce à l'échelle du secteur.
Outre les infrastructures et la gouvernance, le facteur humain demeure déterminant pour la résilience du système éducatif. La prévention des catastrophes est désormais intégrée aux programmes scolaires ; les élèves doivent être formés à la sensibilisation, à la mise en place d’abris, aux premiers secours et aux techniques d’évacuation ; les enseignants et les personnels administratifs sont formés aux « écoles sûres ».
Lorsque les infrastructures seront renforcées, la gouvernance suffisamment flexible et les populations dotées de compétences, l'éducation dans les zones défavorisées deviendra progressivement plus durable. Toutefois, pour que les efforts déployés ne se limitent pas à « surmonter les difficultés » mais deviennent un véritable moteur de développement durable, un cadre politique solide est indispensable pour soutenir, dynamiser et encourager cet élan, à l'instar de l'ensemble du système politique qui s'est mobilisé face aux récentes crises.
Cette politique a eu un impact, mais n'a pas imprégné les choses.
Ces derniers temps, de nombreuses politiques importantes ont été mises en place pour renforcer la protection et le soutien de l'éducation dans les zones défavorisées. La réflexion politique évolue d'une approche réactive à une approche proactive, d'un soutien individuel et ponctuel à une approche globale et durable. À Tuyen Quang, les premiers résultats sont manifestes : le taux de scolarisation des enfants de 3 à 5 ans en maternelle a dépassé les 99 %, un des plus élevés du pays.
Cependant, derrière ce succès se cachent encore de nombreuses difficultés. L'école maternelle Mau Long (commune de Mau Due, province de Tuyen Quang) compte 12 sites distincts, accueille plus de 660 enfants et ne dispose que de 38 enseignants. Chaque salle de classe mesure environ 42 mètres carrés, soit moins de la moitié de la surface standard prévue par la réglementation. « Avec 160 000 VND par enfant et par mois, nous pouvons seulement assurer des repas suffisants, mais pas une alimentation équilibrée », explique la directrice, Tran Thi Xuyen.
Ces derniers temps, de nombreuses politiques importantes ont été mises en place pour renforcer la protection et le soutien de l'éducation dans les zones défavorisées. La réflexion politique évolue d'une logique de réaction à une logique de création, d'un soutien individuel et ponctuel à une approche globale et durable.
Non seulement l'espace et les ressources humaines font défaut, mais de nombreuses politiques d'aide restent déconnectées de la réalité. L'un des problèmes réside dans le calcul de la distance permettant aux élèves de bénéficier de l'internat. Selon le décret n° 116/2016/ND-CP, les élèves du primaire doivent résider à au moins 4 km de leur établissement scolaire, et ceux du secondaire à au moins 7 km, sauf en cas de terrain difficile ou de problèmes d'accès (traversée de rivières et de ruisseaux sans pont, passage de cols et de hautes montagnes, franchissement de glissements de terrain et d'éboulis). Or, de nombreux enfants vivant en zone montagneuse habitent à seulement 3 km de leur école selon les cartes, mais doivent chaque jour emprunter des chemins de terre boueux et des routes forestières dangereuses. Ces contraintes de distance les empêchent parfois de bénéficier de l'aide.
M. Pham Van Tuong, directeur de l'internat de l'école primaire de Mau Long, a déclaré : « La distance n'est que de quelques kilomètres, mais les jours de pluie, il faut plus d'une heure pour se rendre à l'école. Les enfants ne bénéficient pas des avantages liés à l'internat, et il est difficile de faire l'aller-retour dans la journée. » Ce témoignage montre que si la politique a atteint les zones défavorisées, son efficacité reste limitée, car la distance géographique ne reflète pas pleinement la réalité du terrain.
De même, l'allocation pour l'enseignement du vietnamien n'est actuellement versée qu'aux enseignants exerçant dans des zones reculées, alors que dans les zones principales, les enseignants continuent d'enseigner quotidiennement le vietnamien aux élèves issus des minorités ethniques. La directrice adjointe du Département de l'éducation et de la formation de la province de Tuyen Quang, Hoang Thi Thu Hien, a déclaré : « Nous pouvons garantir la présence d'enseignants là où il y a des enfants, mais deux enseignants par classe, comme prévu, ne suffisent pas. »
Ces problèmes ne se limitent pas aux effectifs, mais concernent également le mécanisme de mise en œuvre. Conformément à la circulaire n° 15/2025/TT-BGDDT, le pouvoir de recrutement et de mutation des enseignants est concentré au niveau provincial, empêchant ainsi les autorités communales de pallier proactivement la pénurie de personnel. M. Le Trung Quyet, vice-président du Comité populaire de la commune de Dong Van, dans la province de Tuyen Quang, a déclaré : « La commune manque actuellement de 28 enseignants par rapport au quota, mais elle ne peut ni les recruter ni les muter elle-même. Toutes les procédures doivent attendre l’aval du Département. » Cette situation engendre un système de personnel « patrimonial », obligeant les enseignants à regrouper leurs classes et à effectuer des heures supplémentaires. Le départ soudain d’un seul enseignant peut entraîner la fermeture de l’établissement scolaire situé en zone montagneuse.
Face à cette réalité difficile, le secteur éducatif local a tiré des enseignements en matière de gestion des risques et d'adaptation durable. Le Département de l'Éducation et de la Formation de la province de Tuyen Quang recommande d'intégrer les critères de « renforcement et de sécurité face aux inondations » au plan d'investissement public à moyen terme, en donnant la priorité aux communes situées dans les zones à haut risque. De nombreuses recommandations ont également été transmises au gouvernement central, proposant de donner davantage d'autonomie aux communes en matière de recrutement et de mutation des enseignants, assorties d'un mécanisme de suivi clair et transparent.
Cette politique a certes abordé les problématiques les plus délicates, mais pour s'ancrer durablement et en profondeur, il est indispensable de mettre en place des politiques nouvelles, plus complètes, plus souples et plus équitables. Ce n'est qu'à cette condition que les classes en pleine nature pourront véritablement bénéficier d'un système suffisamment robuste pour non seulement résister aux catastrophes naturelles, mais aussi accompagner fidèlement et constituer un socle solide pour les aspirations futures de la jeune génération.
Source : https://nhandan.vn/xay-dung-nang-luc-chu-dong-ung-pho-thien-tai-post919921.html


![[Photo] Lam Dong : Images des dégâts suite à la rupture présumée d'un lac à Tuy Phong](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762078736805_8e7f5424f473782d2162-5118-jpg.webp)
![[Photo] Le président Luong Cuong reçoit le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762089839868_ndo_br_1-jpg.webp)




![[Vidéo] De nombreuses mesures spéciales concernant les salaires et les indemnités des enseignants sont attendues.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762099443374_luong-dac-thu-cho-giao-vien-3221-jpg.webp)
















![[Vidéo] L’aménagement du territoire et la planification de la construction sont ajustés conformément à la conclusion n° 202-KL/TW](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762097640952_quyet-dinh-202-bct-1055-jpg.webp)

![[Photo] Diffuser l'esprit de santé et de communauté de la Journée du Tai Chi au Vietnam](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762090137764_ndo_br_img-0886-jpg.webp)
























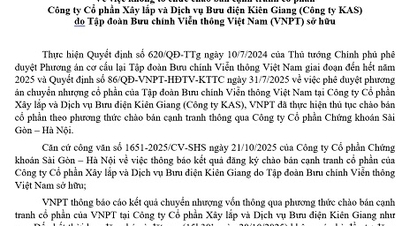







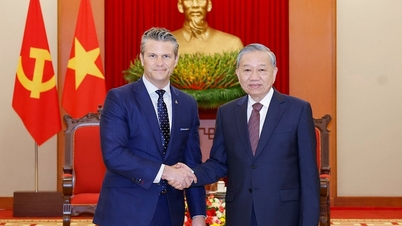
























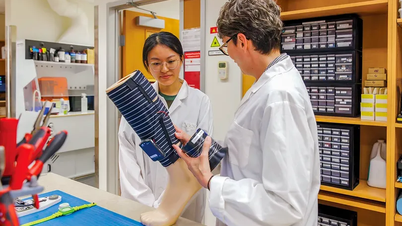
















Comment (0)