En Europe, tous les patients de chaque pays n'ont pas le même accès aux médicaments, les experts comparent cette situation à un programme de « loterie postale ».
En Roumanie, de nombreux médicaments sont distribués deux ans plus tard qu'en Allemagne. Si un patient d'Europe occidentale et un patient d'Europe de l'Est reçoivent un diagnostic de la même maladie grave, leurs pronostics sont très différents, qu'ils survivent ou meurent. Politico a comparé la situation à une loterie postale.
« Les patients d'Europe occidentale et des grands pays ont accès à 90 % des médicaments nouvellement approuvés. En Europe de l'Est et dans les petits pays, ce chiffre n'est que de 10 %. C'est absolument inacceptable », a déclaré la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, lors d'un discours en avril.
De hauts responsables de l'UE présentent des propositions de réforme du marché pharmaceutique du continent afin de remédier aux inégalités d'accès. Ils affirment que les entreprises qui ne parviennent pas à lancer leurs produits sur les 27 marchés de l'UE dans un délai de deux ans devraient être pénalisées. L'objectif est de créer un marché unique garantissant à tous les patients un accès rapide à des médicaments sûrs, efficaces, abordables, justes et équitables.
Cependant, cela se heurte à de nombreux obstacles. Tout d'abord, il y a la question financière . En effet, certains médicaments sont très chers. Par ailleurs, les 27 pays de l'UE présentent d'énormes différences économiques : par exemple, le revenu par habitant de la Bulgarie est près de cinq fois inférieur à celui des Pays-Bas. Cela signifie que certains pays dépensent davantage pour leur système de santé, et notamment pour les médicaments, que d'autres.
Une analyse du marché européen des médicaments contre le cancer réalisée par l'Institut suédois d'économie de la santé (IHE) montre que les plus gros dépensiers sont l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse. Dans ces trois pays, les dépenses par habitant en médicaments contre le cancer s'élèvent à 92 à 108 euros, contre 13 à 16 euros en République tchèque, en Lettonie et en Pologne.
Des dépenses plus faibles se traduisent par une diminution des prescriptions. Par exemple, en ce qui concerne les médicaments anticancéreux gratuits, leur utilisation dans les pays à faible revenu représente un dixième à un cinquième de celle des pays riches.
« En raison de problèmes d’accessibilité financière, une grande partie des patients européens atteints de cancer, notamment en Europe de l’Est, n’ont pas accès à des médicaments efficaces », soulignent les chercheurs.

Médecins travaillant dans un hôpital. Photo : Andreea Campeanu
La raison la plus complexe réside dans la manière opaque et très singulière dont sont fixés les prix des médicaments . Pour négocier les prix, les laboratoires pharmaceutiques négocient directement et secrètement avec les gouvernements, de sorte qu'aucun pays ne sait réellement ce qu'un autre pays paie pour le même médicament. C'est de loin la forme la plus courante.
« Ils (les laboratoires pharmaceutiques) choisissent de lancer de nouveaux médicaments dans des pays où ils savent qu'ils paieront d'abord des prix plus élevés. Dans les pays d'Europe du Sud comme le Portugal, la Grèce et l'Europe de l'Est, les médicaments sont proposés à un stade ultérieur, dans deux ou trois ans », explique Sabine Vogler, responsable de l'économie pharmaceutique à la Fondation publique nationale autrichienne.
Les gouvernements des pays à revenu élevé fixent un « prix de référence », annoncé publiquement. Mais ce prix est préalablement négocié en secret, avec une remise non divulguée. Le processus est répété pour les pays suivants, en utilisant le prix de référence public comme base de négociation. Par conséquent, les pays dont les marchés sont jugés « moins attractifs » se retrouvent en queue de peloton.
Pour l’industrie pharmaceutique, la cause profonde de ce processus est la paperasse qui oblige le gouvernement à payer pour un nouveau médicament.
« Les demandes de négociation de médicaments prennent du temps. Chaque pays exige un ensemble de documents sur mesure, rédigés dans la langue locale, et doit se conformer à la réglementation locale », indique l'analyse réalisée par l'EFPIA, un groupe de pression pharmaceutique.
En théorie, la directive européenne sur la transparence impose aux pays de décider du montant à payer pour un médicament dans un délai de 180 jours. Mais en pratique, dans certains domaines, ce délai peut être prolongé si les autorités réglementaires et les gouvernements demandent aux entreprises de fournir davantage de données.
Une étude sur le délai moyen d'accès aux médicaments anticancéreux personnalisés dans cinq pays a révélé que le Danemark met plus de quatre mois à décider s'il doit payer un médicament. La Pologne met jusqu'à 30 jours.
L'UE prévoit d'introduire une évaluation commune des technologies de la santé (ECT), qui permettrait une évaluation unique, à l'échelle de l'Union, des nouveaux médicaments et aiderait les pays à déterminer le montant à payer. Les entreprises n'auraient qu'à soumettre une seule série de demandes, au lieu de 27 pour chaque médicament comme c'est le cas actuellement. La première évaluation conjointe devrait avoir lieu en 2025.
Les pays membres de l'Initiative Beneluxa pour la politique pharmaceutique, dont la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Autriche et l'Irlande, ont déjà commencé à collaborer pour acheter des médicaments, simplifiant ainsi les négociations pour les fabricants et renforçant le pouvoir de négociation des acheteurs. Cependant, la réforme proposée par la Commission européenne est la plus ambitieuse.
Thuc Linh (selon Politico )
Lien source


















































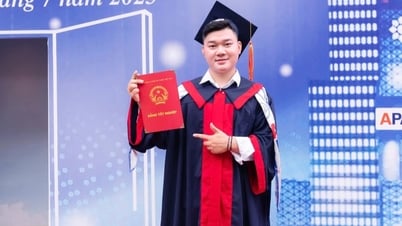



















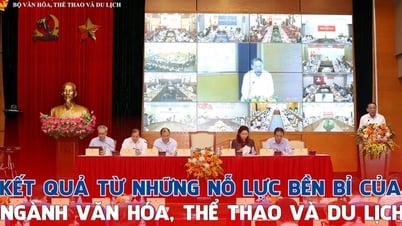

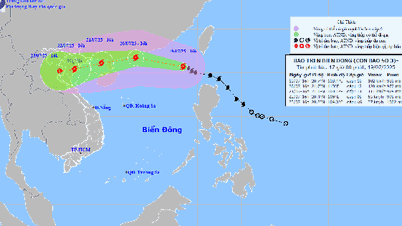

























Comment (0)