Quand le programme nucléaire iranien se réfugie dans « l'obscurité »
Le Moyen-Orient demeure un foyer de tensions internationales. Face à l'échec de la diplomatie avec l'Iran, l'administration du président américain Donald Trump a opté pour l'action militaire , en ciblant des installations nucléaires stratégiques. Bien que cette stratégie n'ait pas entraîné d'escalade majeure du conflit, son efficacité à long terme reste discutable.
Évaluer les conséquences techniques immédiates des frappes sur le programme nucléaire iranien demeure une tâche complexe, même pour les États-Unis. Rien ne prouve clairement que les frappes de missiles américaines et israéliennes aient causé des dommages significatifs à l'infrastructure nucléaire iranienne, et les évaluations détaillées restent sujettes à controverse. En particulier, le sort des stocks d'uranium enrichi – une cible clé de l'opération – demeure incertain.
Il semblerait que même les services de renseignement américains aient admis qu'il est impossible de déterminer avec précision l'emplacement et l'étendue des dégâts causés aux entrepôts radioactifs iraniens. Le directeur général de l'AIEA estime que l'Iran pourrait reprendre ses activités d'enrichissement d'uranium d'ici deux mois, mais il ne s'agit que d'une estimation préliminaire, faute de données fiables sur l'état du programme nucléaire.
Si la campagne militaire américaine a détruit une partie de l'infrastructure nucléaire iranienne, elle a également réduit l'accès à une information transparente, compliquant ainsi une résolution diplomatique de la crise. Ce manque d'information pourrait persister, d'autant plus que Téhéran tend à maintenir son programme nucléaire clandestin pour éviter toute attaque – une situation qui s'est déjà produite, dans une certaine mesure, par le passé.
Les observateurs estiment que le repli de l'Iran sur la voie de la discrétion réduit non seulement l'efficacité de la stratégie coercitive américaine, mais compromet également les perspectives de négociations. Si, auparavant, les parties pouvaient discuter précisément du nombre de centrifugeuses ou du niveau d'enrichissement de l'uranium, le contexte d'instabilité et de manque de transparence rend désormais plus difficile la conclusion d'un nouvel accord.
De la dissuasion à la confrontation : un cycle sans fin en vue
L'administration Trump ne semble plus considérer un nouvel accord nucléaire comme une condition préalable à la résolution de la crise iranienne. Lors du récent sommet de l'OTAN, le président Trump a déclaré qu'un nouvel accord était inutile, laissant entendre que Washington estime que des frappes de missiles, même si elles ne détruisent pas complètement le programme nucléaire iranien, suffisent à atténuer la menace pour longtemps. Et si l'Iran relance son programme, les États-Unis pourraient de nouveau recourir à la force.
Cependant, de nombreuses voix se sont élevées contre cette stratégie américaine. Premièrement, les services de renseignement américains contestent les déclarations du président Trump ; ils estiment que le programme nucléaire iranien n'a pas été totalement anéanti. Deuxièmement, la répétition des frappes est non seulement techniquement inefficace en raison du manque de transparence croissant du programme, mais elle comporte également le risque d'une escalade du conflit. Chaque intervention militaire américaine accroît le risque de guerre régionale. L'absence d'escalade à ce jour ne garantit en rien l'absence d'escalade future.
En réalité, ces attaques pourraient renforcer la détermination de l'Iran à poursuivre son programme nucléaire – ouvertement ou clandestinement – comme moyen de garantir sa sécurité. Les États-Unis seraient alors contraints de recourir à des pressions militaires répétées, sans stratégie claire pour éliminer définitivement le potentiel nucléaire iranien. Parallèlement, le manque croissant de transparence compromettrait toute tentative de négociation future.
Par ailleurs, l’incertitude entourant le programme nucléaire iranien demeure un facteur de déstabilisation dans la région. Moins la transparence est grande, plus le risque est grand que les États du Golfe cherchent à développer leurs propres capacités nucléaires, même potentielles, par précaution. Cela ne conduira peut-être pas immédiatement à l’émergence d’une nouvelle puissance nucléaire, mais suffira à favoriser la prolifération des armes nucléaires dans la région, accentuant ainsi l’instabilité stratégique.
Washington, qui ne peut se permettre de rester à l'écart de toutes les crises majeures au Moyen-Orient, devra constamment investir des ressources militaires, diplomatiques et politiques pour maîtriser la situation – ce que le président Trump a cherché à éviter. Un changement de régime à Téhéran est une option envisagée. Si un gouvernement pro-occidental accède au pouvoir, il pourrait mettre fin à son programme nucléaire et cesser de soutenir des groupes armés régionaux. Mais la perspective d'un changement de régime violent est manifestement irréalisable. Loin de l'affaiblir, les attaques ont uni le peuple iranien face à une menace extérieure. Bien que le système politique iranien ne soit pas totalement stable, surtout en cas de décès du Guide suprême Khamenei, nul ne peut prédire avec exactitude qui lui succédera ni si sa politique évoluera. De plus, les attaques contre les États-Unis et Israël ont affaibli l'influence des forces favorables à la coopération avec l'Occident, rendant ainsi la possibilité d'un changement de politique plus incertaine.
Les perspectives d'un règlement diplomatique de la crise nucléaire iranienne dans un avenir proche restent sombres. Malgré les affrontements militaires entre les États-Unis et l'Iran, les positions des deux parties sont demeurées globalement inchangées : Washington continue d'exiger que l'Iran renonce à son droit d'enrichir l'uranium, tandis que Téhéran considère cela comme une ligne rouge infranchissable.
Même après les frappes de missiles américains, le potentiel d'enrichissement d'uranium est devenu encore plus crucial pour l'Iran, constituant une alternative à ses capacités militaires conventionnelles, qui se sont révélées insuffisantes pour dissuader toute intervention extérieure. Même si Téhéran n'a aucune intention de se doter de l'arme nucléaire, une infrastructure d'enrichissement d'uranium performante est perçue comme le seul moyen de dissuader toute action militaire américaine répétée.
Renoncer au droit d’enrichir l’uranium de manière indépendante serait perçu par l’Iran non seulement comme une concession aux pressions des États-Unis et d’Israël, mais aussi comme l’acceptation d’un statut inférieur dans l’ordre international – une perspective que les dirigeants iraniens ont toujours cherché à éviter, avant comme après le retrait des États-Unis de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien (JCPOA). Signer un tel accord, surtout après les récentes attaques, serait considéré comme une grave défaite politique au niveau national.
Du côté américain, l'administration Trump ne semble pas non plus avoir l'intention de faire des concessions ni de relancer les négociations. M. Trump estime que l'action militaire a sérieusement affaibli le programme nucléaire iranien et que, par conséquent, Téhéran devrait faire des concessions. De toute évidence, la politique actuelle du président Trump privilégie la pression et la coercition à la diplomatie. Washington ne recherche plus activement de négociations et est encore moins disposé à faire des concessions significatives, ce qui rend la perspective d'une solution diplomatique encore plus improbable.
Hung Anh (Contributeur)
Source : https://baothanhhoa.vn/van-de-hat-nhan-iran-khi-suc-manh-khong-khuat-phuc-duoc-y-chi-254704.htm






![[Photo] Foire d'automne 2025 et records impressionnants](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762180761230_ndo_br_tk-hcmt-15-jpg.webp)
![[Photo] Le secrétaire général To Lam reçoit l'ambassadeur de Singapour, Jaya Ratnam](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762171461424_a1-bnd-5309-9100-jpg.webp)
![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le président de l'Association d'amitié Japon-Vietnam dans la région du Kansai](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762176259003_ndo_br_dsc-9224-jpg.webp)
![[Photo] Lam Dong : Gros plan sur un lac illégal au mur brisé](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762166057849_a5018a8dcbd5478b1ec4-jpg.webp)



























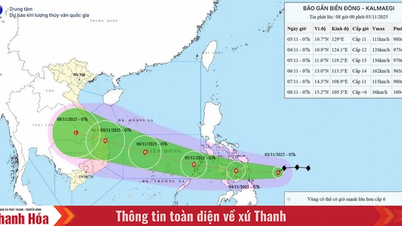









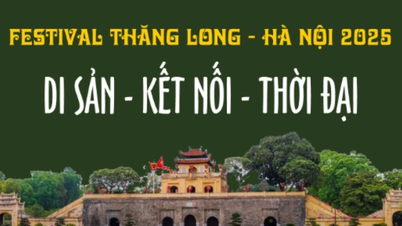


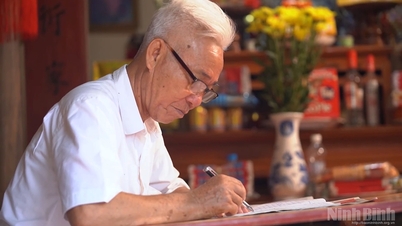





























































Comment (0)