Il y a exactement 80 ans, la conférence de Yalta avait lieu, marquant non seulement la fin de la Seconde Guerre mondiale mais aussi le début d’un ordre mondial bipolaire, les deux pays leaders étant les États-Unis et l’Union soviétique.
 |
| Première rangée, de gauche à droite : le Premier ministre britannique Winston Churchill, le président américain Franklin Roosevelt et le secrétaire général soviétique et président du Conseil des ministres Joseph Staline à la conférence de Yalta, 1945. (Source : US National Archives and Records Administration). |
La conférence de Yalta, qui s'est tenue du 4 au 11 février 1945 dans la station balnéaire de Yalta, sur la péninsule de Crimée, a réuni les dirigeants des trois puissances alliées de la Seconde Guerre mondiale (les « Big 3 »), dont le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique et président du Conseil des ministres Joseph Staline, le président américain Franklin D. Roosevelt et le Premier ministre britannique Winston Churchill.
Cette réunion eut lieu alors que la Seconde Guerre mondiale entrait dans sa phase finale. Les Alliés avaient remporté d'importantes victoires en Europe et l'effondrement des puissances de l'Axe (Allemagne, Japon, Italie) n'était qu'une question de temps. Cependant, des défis majeurs subsistaient, notamment l'organisation du monde, le partage des fruits de la victoire et le maintien d'une paix durable après la guerre.
Accords importants
Selon le Bureau de l’historien du Département d’État américain, la Conférence de Yalta a pris des décisions importantes concernant le cours futur de la Seconde Guerre mondiale et du monde d’après-guerre.
Le communiqué final de la conférence (11 février 1945), publié par le Bureau de l'Historien, affirmait clairement la défaite de l'Allemagne nazie. L'un des accords les plus importants de la conférence était la division de l'Allemagne en quatre zones contrôlées par les grandes puissances : les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique. L'administration et le contrôle de ces zones étaient coordonnés par la Commission centrale de contrôle, basée à Berlin et composée des commandants en chef des trois puissances.
Les dirigeants ont convenu qu’il était nécessaire d’éradiquer le fascisme, de désarmer complètement l’Allemagne, de détruire son industrie de défense et de limiter sa capacité à restaurer sa force militaire, de punir les criminels de guerre et de forcer l’Allemagne à payer des réparations pour les dommages de guerre.
Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont généralement convenu que les futurs gouvernements des pays d’Europe de l’Est limitrophes de l’Union soviétique devraient être « amicaux » envers ce régime, tandis que l’Union soviétique s’est engagée à autoriser des élections libres dans tous les territoires libérés de l’Allemagne nazie.
Entre-temps, selon l'article « Comment Churchill, Roosevelt et Staline ont planifié la fin de la Seconde Guerre mondiale ? » publié sur le site Internet de l'Imperial War Museum (iwm.org.uk), la question de l'avenir de la Pologne était un point central de la conférence de Yalta.
Plus précisément, les dirigeants des « Trois Grands » ont convenu que la frontière soviétique avec la Pologne soit déplacée vers l’ouest jusqu’à la ligne Curzon, une frontière proposée après la Première Guerre mondiale. Les discussions ont abouti à un accord sur les conditions d’établissement d’un nouveau gouvernement provisoire polonais d’une manière qui pourrait être reconnue par les trois puissances.
Par ailleurs, la Conférence de Yalta a marqué une étape importante dans la création de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Les dirigeants se sont initialement mis d'accord sur la Charte des Nations Unies, ainsi que sur la structure organisationnelle et le droit de veto du Conseil de sécurité, alors composé de cinq membres permanents.
Dans la région asiatique, conformément à l'Accord sur la participation soviétique à la guerre contre le Japon publié par le Bureau de l'historien du Département d'État américain, les trois pays ont signé un protocole dans lequel l'Union soviétique s'engageait à participer à la lutte contre le militarisme japonais avec les conditions suivantes : protéger le statu quo en Mongolie extérieure (ou République populaire de Mongolie), restituer à l'Union soviétique les droits en Extrême-Orient avant la guerre russo-japonaise (1904-1905) et les îles Kouriles.
Fondation pour la paix ?
La conférence de Yalta a réaffirmé la détermination commune des « Big 3 » à maintenir et à renforcer la paix mondiale d’après-guerre, en fournissant « la garantie que les peuples de tous les pays puissent vivre toute leur vie en liberté, sans peur ni besoin », bien que chaque dirigeant soit venu à la conférence avec ses propres idées pour reconstruire l’ordre dans l’Europe d’après-guerre, indique le communiqué de presse de la conférence.
Selon un article intitulé « La fin de la Seconde Guerre mondiale et la division de l'Europe » publié par le Centre d'études européennes (CES) de l'Université de Caroline du Nord, le président américain Roosevelt souhaitait l'aide de l'Union soviétique dans la lutte contre le militarisme japonais et son adhésion aux Nations unies. Le Premier ministre britannique Churchill a appelé à des élections libres et à l'instauration de gouvernements démocratiques en Europe centrale et orientale, notamment en Pologne.
Entre-temps, le secrétaire général Staline souhaitait que l'Union soviétique étende son influence en Europe centrale et orientale, considérant cela comme un élément important de la stratégie de défense de l'État fédéral. Sa position était si ferme que, comme le remarqua le secrétaire d'État américain de 1945 à 1947, James F. Byrnes (1882-1972) : « La question n'est pas de savoir ce que nous laisserons faire aux Russes, mais ce que nous pourrons les persuader de faire. »
C'est pourquoi la conférence de Yalta s'est déroulée dans une atmosphère tendue et acharnée. Cependant, les décisions finales ont été prises après accord et contrôle entre les deux superpuissances, l'Union soviétique et les États-Unis.
Dans ce nouvel ordre, l'Union soviétique a réussi à préserver l'existence et le développement de l'État socialiste, à reconquérir les territoires perdus lors de la guerre russo-japonaise (1904-1905) et, parallèlement, à étendre son influence en Europe et en Asie, construisant une ceinture de sécurité autour du pays. Parallèlement, les États-Unis, dans ce nouvel ordre, dominaient et exerçaient une profonde influence sur les puissances d'Europe occidentale et le Japon, dominaient la situation internationale et réalisaient progressivement leur ambition d'« hégémonie mondiale ».
Selon le Bureau de l'historien, la réaction initiale aux accords de Yalta fut une forme de célébration. Le président Roosevelt, comme beaucoup d'autres Américains, y voyait la preuve que l'esprit de coopération entre les États-Unis et l'Union soviétique en temps de guerre se maintiendrait après la guerre.
Le magazine Time affirmait à l'époque que : « Tous les doutes sur la capacité des « Big 3 » à coopérer en temps de paix comme en temps de guerre semblent désormais dissipés », tandis que l'ancien secrétaire d'État James F. Byrnes commentait : « La vague d'amitié entre la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et l'Amérique a atteint de nouveaux sommets ».
L'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger (1923-2023) a salué Yalta, la qualifiant d'excellente stratégie diplomatique des dirigeants alliés, notamment du président Roosevelt, malgré de nombreux facteurs complexes. Selon lui, Yalta était le fruit d'une coopération concrète et nécessaire pour assurer la stabilité après la guerre.
Le succès de Yalta réside dans le fait que les trois superpuissances ont pu coexister et gérer les problèmes majeurs tout en préservant leurs intérêts distincts.
L'expert de la guerre froide John Lewis Gaddis, actuellement professeur d'histoire militaire et navale à l'Université de Yale (États-Unis), a commenté dans son livre Les États-Unis et les origines de la guerre froide, 1941-1947 que la conférence de Yalta était une étape importante dans le maintien de la coopération entre les puissances alliées alors que la guerre touchait à sa fin.
Cependant, le Bureau de l'historien du Département d'État américain lui-même a admis que ce « sentiment d'alliance » n'a pas duré longtemps. À la mort du président Roosevelt le 12 avril 1945, Harry S. Truman est devenu le 33e président des États-Unis et, fin avril 1945, la nouvelle administration était en conflit avec l'Union soviétique au sujet de son influence en Europe de l'Est et à l'ONU.
Dès lors, de nombreux Américains, préoccupés par le manque de coopération de l'Union soviétique, ont commencé à critiquer la manière dont le président Roosevelt a mené les négociations de Yalta. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui l'accusent d'avoir « livré » l'Europe de l'Est à l'Union soviétique, malgré les nombreuses concessions importantes faites par ce dernier.
L’historien britannique AJP Taylor (1906-1990) a commenté dans son ouvrage English History 1914-1945 que la conférence de Yalta a laissé derrière elle « une Europe divisée et un monde instable ».
Le professeur Gaddis partage ce point de vue, affirmant que la décision de permettre à l’Union soviétique d’étendre son influence en Europe de l’Est a facilité la formation du « rideau de fer » qui a séparé l’Europe centrale et orientale du reste du continent, ainsi que le début de la guerre froide en 1947.
Du côté russe, dans une interview accordée au site d'information russe Top War en 2015, l'historien et diplomate soviétique Valentin Falin (1926-2018) a estimé que la conférence de Yalta était la meilleure opportunité pour les peuples depuis l'Antiquité.
Il a cité le discours du président américain Roosevelt au Congrès le 1er mars 1945, à propos des accords de Yalta entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique : « Il ne peut s'agir d'une paix entre grands ou petits pays. Il doit s'agir d'une paix fondée sur les efforts communs du monde entier. » Cependant, selon M. Falin, le monde décrit par le président Roosevelt ne répondait pas aux attentes des éléments hostiles à Washington, ce qui risquait de briser la coopération entre l'Union soviétique et les États-Unis…
Même le secrétaire général Staline avait mis en garde contre ce problème lors de la conférence de Yalta en déclarant : « Nous ne pouvons pas laisser surgir de dangereuses divergences… Mais dix ans encore s’écouleront, peut-être moins. Une nouvelle génération apparaîtra, qui n’aura pas vécu tout ce que nous avons vécu et qui pourrait percevoir de nombreux problèmes différemment de nous. »
Et de toute évidence, les Alliés n’ont pas réussi à préserver jusqu’au bout les relations de la Conférence de Yalta, puisque deux ans plus tard, la Guerre froide éclatait entre les deux superpuissances, les États-Unis et l’Union soviétique.
Source : https://baoquocte.vn/hoi-nghi-yalta-cuoc-gap-go-quyet-dinh-van-menh-the-gioi-303400.html







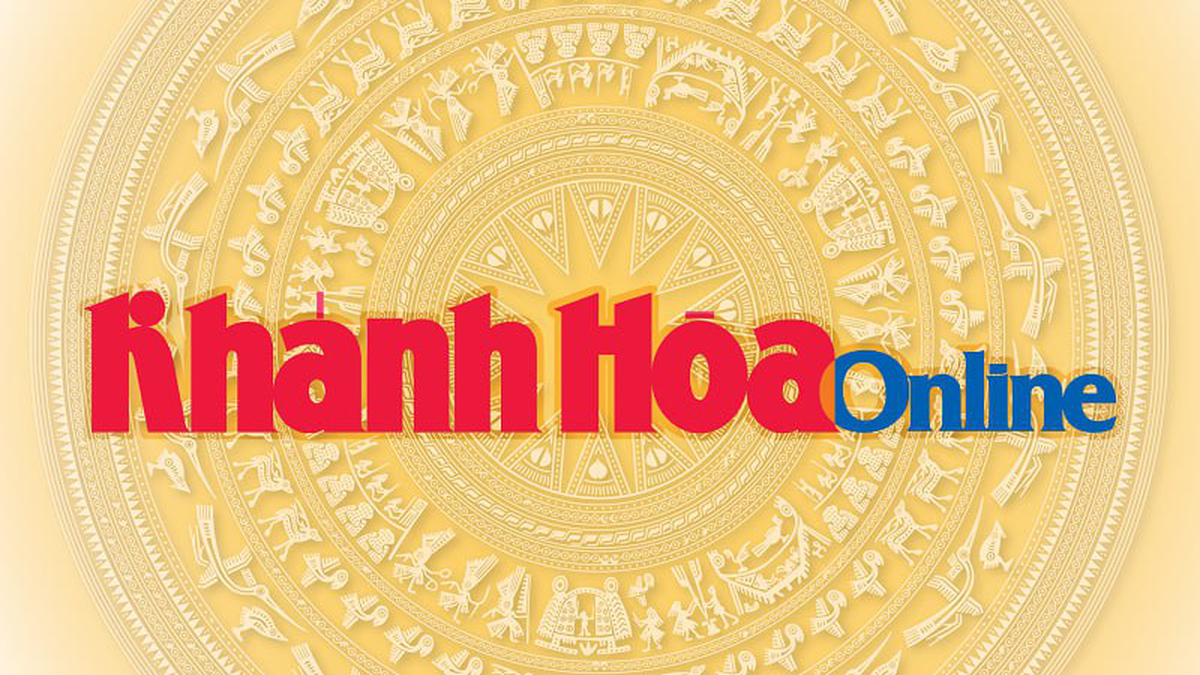


























































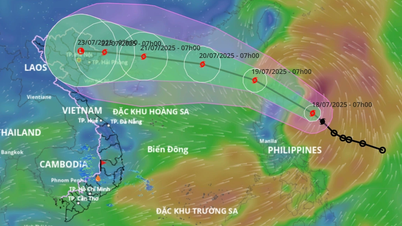



























![[Infographie] En 2025, 47 produits obtiendront l'OCOP national](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)





Comment (0)