Des peintures anciennes, chefs-d'œuvre artistiques reflétant toute une période de civilisation développée, aux précieux manuscrits historiques, tous sont soigneusement conservés dans des milliers de musées à travers la France.
Derrière la magnificence et la paix de ces objets, documents et œuvres se cache l’effort de toute la France pour protéger le patrimoine d’innombrables menaces, des catastrophes naturelles, des incidents techniques aux crimes sophistiqués et aux nouveaux défis de l’époque.
Sécurité et sûreté pour tout le patrimoine
En France, tous les experts, étudiants et personnels de la protection et de la valorisation du patrimoine maîtrisent parfaitement deux notions clés : « sécurité » et « sûreté ».
La « sécurité » désigne la prévention des risques naturels et des accidents techniques, dangers pouvant survenir involontairement ou en raison de facteurs objectifs. Toute situation, telle qu'un incendie, une inondation, un dommage structurel ou un problème avec les systèmes électriques et hydrauliques, doit être anticipée.
Une préparation minutieuse des questions de « sécurité » permet de garantir l’intégrité de l’espace et des objets exposés à l’intérieur contre tout dommage involontaire.
Le concept de « sécurité » est tout autre. Il s'agit de se préparer et de réagir aux menaces intentionnelles, telles que le sabotage, le vol, le commerce illégal ou le terrorisme. Par essence, les musées sont des lieux de préservation, de promotion de l'image et de valorisation de toutes les œuvres, antiquités, documents et constructions.
 |
| Riches en trésors d'antiquités, les musées et galeries sont toujours au centre de la curiosité des touristes et des criminels. (Photo : MINH DUY) |
De plus, les musées attirent non seulement des visiteurs nationaux et internationaux, mais constituent également des cibles privilégiées pour la criminalité patrimoniale. Le facteur « sécurité » comprend donc trois composantes : le public, le bâtiment et l'œuvre d'art, ce qui nécessite la mise en place de stratégies globales de prévention et de réponse, ne laissant aucun aspect inexploré.
Protéger le patrimoine grâce à une base juridique solide
Pour protéger au maximum le patrimoine culturel, il est nécessaire de bâtir un système juridique solide. La loi du 4 janvier 2002 constitue une étape importante, démontrant clairement que la France y est parvenue.
La loi fournit la première définition juridique des musées, clarifiant le rôle multidimensionnel de ces institutions culturelles dans la société.
La mission du musée est également clairement mentionnée, depuis les activités de conservation, de recherche et d'enrichissement des collections jusqu'à la promotion de la fonction éducative et de diffusion des connaissances auprès du public. Les musées reconnus par l'État, qu'ils soient publics ou privés, doivent respecter le principe fondamental de « propriété publique » pour la protection des biens nationaux.
Le label « Musée français », reconnu par l'État, contribue notamment à accroître le prestige de ces établissements. À ce titre, le musée doit s'engager à fournir des installations adaptées à l'accueil du public, une équipe d'experts qualifiés, un fonctionnement continu et des exigences strictes en matière de conservation et de sécurité.
À ce jour, plus de 1 200 musées à travers la France ont reçu ce titre.
Par ailleurs, la France dispose d'autres réglementations qui contribuent indirectement, mais non moins importantes, à la protection du patrimoine. Le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005, relatif à la création de l'Organisation d'Intervention de Sécurité Civile (ORSEC), en est un exemple typique.
Ce décret précise la structure et les principes de fonctionnement des ORSEC du niveau central au niveau provincial, et doit disposer de plans spécifiques pour protéger le patrimoine en cas de catastrophes naturelles ou d'incidents majeurs.
 |
| L'espace exposant le tableau « Mona Lisa » ne désemplit jamais. (Photo : KHAI HOAN) |
Les réglementations en matière de sécurité incendie applicables aux différents types de bâtiments, bien que non directement liées à la protection du patrimoine culturel, constituent également un élément important de la protection et de la conservation du patrimoine. L'une des réglementations importantes concerne la sécurité incendie des bâtiments.
Les mesures de sécurité telles que l’isolement, l’évacuation des fumées, la fermeture des cages d’escalier, l’utilisation de matériaux résistants au feu ou encore les exigences en matière de systèmes d’alarme incendie automatiques contribuent toutes de manière significative à la protection du bâtiment, de la vie humaine et bien sûr des œuvres exposées à l’intérieur.
Coordination interdisciplinaire et spécialisation approfondie
La protection du patrimoine culturel en France est une collaboration entre de nombreux organismes et niveaux différents, des ministères centraux et des collectivités locales aux institutions culturelles et aux forces d'intervention d'urgence.
La Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture joue un rôle central et de premier plan dans la protection du patrimoine, dont la Direction de la sécurité, de la sûreté et de l'inspection (Missa) a les missions les plus spécialisées.
L'équipe de Missa comprend des officiers supérieurs et des experts de la police nationale et des sapeurs-pompiers. Elle compte également des ingénieurs des services culturels et patrimoniaux, des experts en protection des entreprises et en intelligence économique , ainsi que des consultants spécialisés dans des domaines spécifiques comme la sécurité incendie des musées et du patrimoine.
 |
| Protéger le patrimoine, c'est préserver la culture pour les générations futures. (Photo : MINH DUY) |
Outre le ministère de la Culture, le ministère de l’Intérieur, le ministère du Développement durable et le ministère de la Défense sont également impliqués dans la sécurité civile et la gestion des risques, créant ainsi un solide réseau interdisciplinaire.
En cas d'urgence, le Service provincial d'incendie et de secours (SDIS) est un bras armé qui effectue des évaluations des risques pour la sécurité civile, prépare des mesures de protection et organise les véhicules de secours.
Par ailleurs, dans la capitale Paris, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) dispose d'unités spécialisées sur des sites culturels importants tels que le Musée du Louvre, le Musée d'Orsay, la Bibliothèque Nationale de France, etc. Cette unité est en service 24h/24 et 7j/7, permettant une intervention rapide et spécialisée en cas de situation d'urgence dans les lieux les plus sensibles.
Les collectivités locales sont également directement responsables de la gestion et de la protection des installations muséales. Chaque localité est tenue de mettre en œuvre un Plan de Protection Communautaire (PCS) pour se préparer aux risques naturels, sanitaires ou technologiques.
Dans les institutions culturelles telles que les musées ou les galeries, le directeur ou le propriétaire de l'institution est globalement responsable de la sécurité et de la sûreté. Le conservateur de la collection est directement responsable de la protection et de l'entretien des collections. Le personnel d'exploitation des installations est en première ligne pour la prévention et les premières interventions.
Une coopération étroite, une compréhension mutuelle et une communication fluide entre toutes les parties prenantes sont essentielles pour garantir la sécurité et la sûreté efficaces du patrimoine.
La combinaison parfaite de la technologie, du processus et des personnes
Avec plus de 72 000 mètres carrés d'espace d'exposition, soit l'équivalent de dix terrains de football, le Louvre est non seulement le plus grand musée d'art du monde, mais aussi une véritable forteresse artistique. La sécurité y est poussée à son maximum, grâce à un système de surveillance électronique de grande envergure.
Un réseau de caméras à ultra haute résolution couvre chaque recoin, intégrant l'intelligence artificielle, analysant les images pour détecter les comportements suspects ou toute personne s'approchant trop près des artefacts et transmettant en continu des données à un centre de contrôle de sécurité 24h/24 et 7j/7.
Selon la direction du musée du Louvre, en cas de mouvement au-delà des limites de la « zone de sécurité », le signal d'alerte retentira immédiatement, activant l'équipe de sécurité du personnel interne à la Brigade spécialisée des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).
 |
| Après de nombreux événements inattendus, « Mona Lisa » a été protégée par des vitres pare-balles et des barrières physiques. (Photo : KHAI HOAN) |
Toutes les entrées et sorties sont strictement contrôlées par des portiques de sécurité, des détecteurs de métaux et des scanners à bagages. En particulier, les zones de stockage secrètes et les bureaux internes ne sont accessibles qu'avec des cartes d'accès et une technologie biométrique moderne, garantissant une sécurité absolue.
Plus précisément, le chef-d'œuvre artistique Mona Lisa, qui est le centre de toutes les attentions, est placé dans une cage en verre épais, résistant aux chocs et au feu, pare-balles, entourée d'une barrière physique pour maintenir une distance de sécurité entre les visiteurs et l'œuvre, avec de nombreux agents de sécurité toujours en service.
Le système automatique d'alarme et d'extinction d'incendie du musée du Louvre est parmi les plus avancés, comprenant des détecteurs de fumée et de chaleur, des systèmes de brouillard fin ou d'air pur dans les zones sensibles, prêts à éteindre les incendies sans endommager les œuvres.
Situé sur les bords de Seine, le musée du Louvre est également équipé d'un système de pompage de secours et de barrières d'eau automatiques pour faire face aux risques d'inondation.
De l'autre côté de la Seine, le musée d'Orsay abrite une collection d'art du XIXe et du début du XXe siècle, notamment impressionniste. L'intérieur du musée est également équipé d'un système de contrôle climatique pour maintenir une température, une humidité et une qualité de l'air optimales, protégeant ainsi les objets fragiles de toute détérioration.
 |
| En plus des cours en classe, les sorties dans les musées et les galeries aident les jeunes à mieux comprendre la culture. (Photo : MINH DUY) |
Non loin de là, la Bibliothèque nationale de France abrite un vaste dépôt de documents rares, bénéficiant ainsi d'un système de protection de très haut niveau. Contenant de nombreux manuscrits historiques précieux, ses archives sont spécialement conçues pour contrôler avec précision l'air, la température, l'humidité et la lumière.
La Bibliothèque nationale de France investit également massivement dans la numérisation et la sauvegarde des données, tant pour le stockage que pour la recherche documentaire et la création d'espaces de visite virtuelle avancés. Par ailleurs, un système de contrôle multicouche des entrées et sorties sur le site ou des accès en ligne, ainsi qu'une surveillance continue, créent une « membrane anti-criminalité ». Le public n'est autorisé à effectuer des fouilles sur le site que sous surveillance, afin d'éviter tout dommage ou perte.
 |
| La France est un modèle en matière de protection du patrimoine culturel. (Photo : MINH DUY) |
En France, protéger le patrimoine culturel, les bâtiments, les œuvres, les antiquités et les documents dans les musées et les galeries ne consiste pas seulement à protéger les objets physiques, mais aussi à protéger l’histoire, le savoir et l’identité de la nation et de l’humanité.
Face à de nouveaux défis tels que le changement climatique ou les risques et incidents d’origine humaine, la France révise en permanence les réglementations juridiques, les processus de surveillance et modernise les systèmes de protection pour préserver le patrimoine, car chaque collection patrimoniale est unique, originale et irremplaçable.
Source : https://nhandan.vn/kinh-nghiem-bao-ve-di-san-cua-nuoc-phap-post883611.html

























![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rend visite à la mère héroïque vietnamienne, Ta Thi Tran](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/20/765c0bd057dd44ad83ab89fe0255b783)




























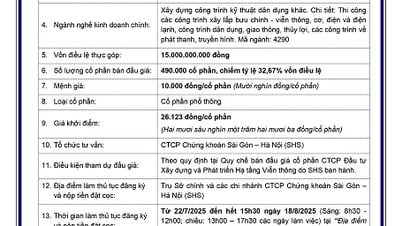












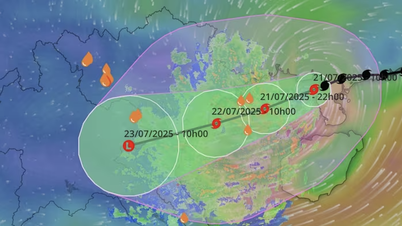





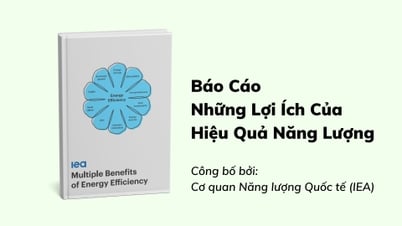





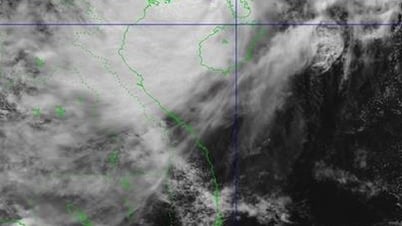























Comment (0)