Cette élection présidentielle américaine ne semble pas se dérouler sans heurts, et elle réunit presque toutes les coïncidences et anomalies de l'histoire.
La loi électorale présidentielle américaine est vaste et complexe, tant dans son processus que dans la relation entre le vote populaire et le vote des grands électeurs. Le chiffre 60, associé à l'élection de 2024, symbolise un cycle naturel et social.
 |
| L’élection présidentielle américaine de cette année réunit presque toutes les coïncidences et anomalies historiques… (Source : BBC) |
De nombreuses histoires en double et inhabituelles
Tout comme il y a 56 ans (1968), un candidat républicain s'est présenté à sa réélection après avoir perdu les élections précédentes. Après 68 ans (1956), les électeurs américains ont de nouveau dû choisir entre deux candidats s'affrontant pour la seconde fois. Plusieurs présidents et candidats à la présidence des États-Unis ont été assassinés, comme John F. Kennedy en 1963, Robert F. Kennedy en 1968 et Ronald Reagan en 1981. Cette fois-ci, l'ancien président Donald Trump a été la cible d'une tentative d'assassinat. Plus récemment, le 15 septembre, le candidat républicain a été attaqué par arme à feu alors qu'il jouait au golf à West Palm Beach, en Floride, mais il s'en est sorti indemne.
Dans l'histoire américaine, au moins quatre candidats à la présidence ont surmonté des scandales pour remporter l'élection (Andrew Johnson en 1828, Richard Nixon en 1972...). Cette fois-ci, Donald Trump est impliqué dans quatre affaires criminelles, et s'il est élu, une affaire supplémentaire s'y ajoutera. Auparavant, deux présidents américains sortants avaient décidé de ne pas briguer un second mandat (Harry Truman en 1952, Lyndon Johnson en 1968) pour des raisons différentes. Le président Joe Biden se trouve dans la même situation, mais il ne reste qu'un peu plus de 100 jours avant l'élection, ce qui désavantage son successeur dans la dernière ligne droite de la campagne.
Si Kamala Harris est élue, ce sera la première fois que les États-Unis auront une femme à la tête de la Maison-Blanche. Cependant, d'ici la fin de l'élection présidentielle de 2024, qui sait ce qui pourrait se produire, comme les émeutes du Capitole en 2020 ? Le processus électoral présidentiel a mis en lumière de nombreux problèmes majeurs au sein de la société américaine.
La confrontation tendue et la division de l'Amérique
Au début du débat télévisé, les deux candidats à la présidence se sont serré la main amicalement, mais l'atmosphère restait empreinte d'une vive confrontation, tant sur le plan du style et du langage que sur celui des valeurs fondamentales américaines. Le débat a révélé que les deux candidats, et plus largement les partis républicain et démocrate, avaient des visions divergentes en matière de politique intérieure et étrangère.
La question qui préoccupe le plus les Américains, et qui est au cœur des débats, est celle de l'économie et de la vie sociale. Mme Kamala Harris a affirmé que le « taux de chômage le plus élevé depuis la Grande Dépression » a contraint le président Joe Biden à « réparer les dégâts laissés par Donald Trump » ! En retour, M. Donald Trump a qualifié la forte inflation sous la présidence de Joe Biden de « désastre » pour l'économie. Les deux candidats ont également des opinions divergentes et s'affrontent sur l'avortement, l'immigration et son impact sur l'économie et la société.
L'ancien président et l'actuel vice-président se sont également opposés sur la politique étrangère, notamment sur les questions liées aux points chauds et à la rivalité entre grandes puissances. Donald Trump a affirmé avec force que s'il était au pouvoir, « les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient n'auraient pas lieu » et que, s'il était élu, il contribuerait à mettre fin immédiatement au conflit. Pour l'ancien président, Pékin est le principal rival et il est « le seul capable de tenir tête à la Chine ». Mais l'essentiel, c'est que, comment, il a passé sous silence la question cruciale.
La plupart des Américains perçoivent la politique étrangère des présidents en fonction de leurs intérêts, notamment leur capacité à gérer la concurrence entre grandes puissances et son impact sur l'emploi, les prix à la consommation et les dépenses publiques, ainsi que sur le soutien et la gestion des conflits et différends extérieurs. Sur ce point, Donald Trump s'en sort légèrement mieux.
Le point marquant de ce débat a été que les deux candidats ont profité de l'occasion pour critiquer durement leurs adversaires et mettre l'accent sur leurs faiblesses, plutôt que de présenter leurs propres idées et orientations. L'économie était au cœur des discussions, la priorité absolue, mais ni Donald Trump ni Kamala Harris n'ont présenté de programme politique clair.
Cela se comprend aisément, car proposer de nouvelles politiques et stratégies est complexe, source de conflits, et gagner le soutien de certains électeurs peut entraîner la perte de voix d'autres. L'objectif principal du débat direct est de critiquer les adversaires et d'obtenir l'appui des électeurs, notamment des modérés, qui n'ont pas d'opinion tranchée.
De l'avis général, la vice-présidente actuelle s'est montrée plus confiante, proactive, a su exprimer son message et a mis en œuvre des stratégies pertinentes, empêchant ainsi l'ancien président de tirer profit de son expérience et le contraignant à se défendre face aux attaques de son adversaire. Un sondage CNN réalisé juste après le débat a révélé que plus de 63 % des Américains interrogés estimaient que Kamala Harris avait été plus convaincante.
Le débat en direct, peut-être la seule occasion de mettre en évidence le contraste entre les deux candidats, a été crucial et a attiré 67,135 millions de téléspectateurs américains, un chiffre largement supérieur aux débats précédents. Cependant, les experts estiment qu'il n'a souvent qu'une influence limitée sur le résultat final. L'élection présidentielle, les débats en direct et l'opinion des électeurs montrent que même le pouvoir suprême est confronté à des difficultés : l'Amérique est profondément divisée.
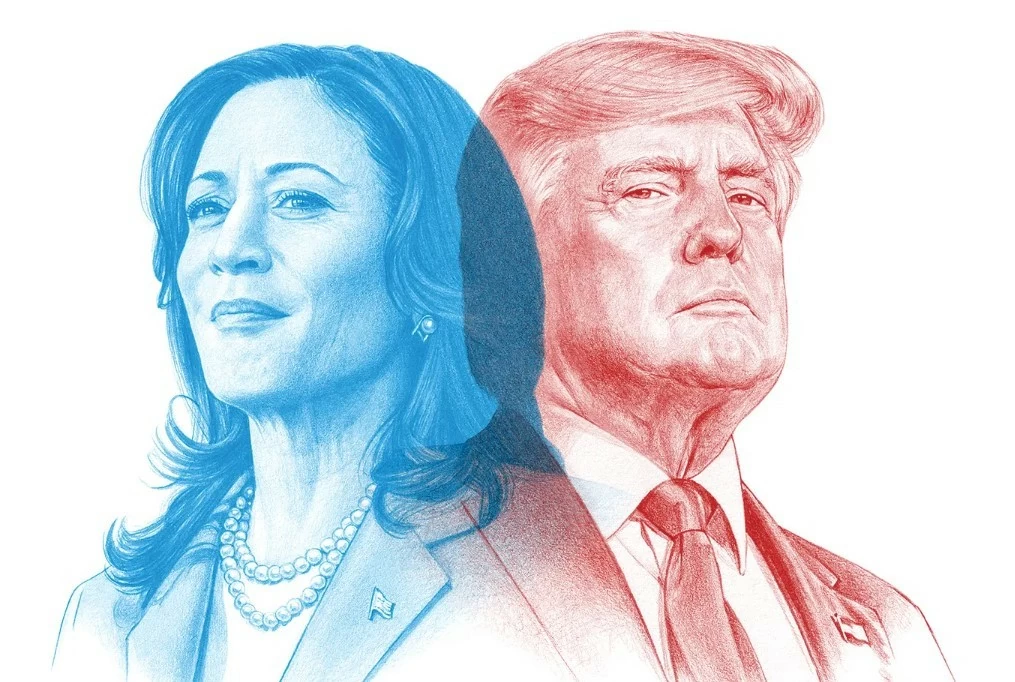 |
| Actuellement, l'opinion publique penche légèrement en faveur du vice-président sortant, mais le taux de soutien des deux candidats reste assez proche. (Source : Foreign Policy) |
L'imprévisibilité et le point de vue du monde
Pour l'instant, la balance penche légèrement en faveur de la vice-présidente Kamala Harris, mais les taux de soutien aux deux candidats sont assez proches. « Trente jours, ce n'est pas encore le Têt ». Plus de cinquante jours laissent largement le temps à Donald Trump et à son équipe de conseillers de renverser la situation. De plus, de nombreux facteurs, internes et externes, entrent en jeu, rendant les résultats de l'élection difficiles à prévoir.
Quatre enjeux majeurs pourraient fortement influencer les résultats des élections. Premièrement, le conflit russo-ukrainien s'est propagé soudainement et de manière inattendue au Moyen-Orient. Deuxièmement, les États-Unis sont confrontés à des actes de terrorisme et à d'importantes émeutes. Troisièmement, la confrontation entre deux pôles, l'ordre mondial unipolaire et multipolaire, est de plus en plus vive : d'un côté, les États-Unis dominent l'ordre mondial, de l'autre, la Chine et la Russie. Quatrièmement, l'économie américaine traverse une période difficile, voire de récession.
Les trois premiers points sont plus ou moins liés entre eux et pourraient avoir une incidence sur le quatrième. L'administration Biden tentera d'éviter ces changements brusques jusqu'à l'élection. Cependant, la décision finale ne relève pas entièrement des États-Unis. De plus, les résultats de l'élection sont également liés aux intérêts et aux opinions des principales communautés ethniques américaines. Par conséquent, les sondages et les prévisions pourraient être remis en question, et l'issue du scrutin reste incertaine.
Non seulement les Américains, mais aussi la communauté internationale suivent de près l'élection du 5 novembre. Les États-Unis, première puissance mondiale, exercent une influence considérable dans de nombreux domaines et régions. Compte tenu de leurs relations et intérêts respectifs, chaque alliance et chaque pays a une perspective différente sur les résultats de cette élection. De nombreux pays occidentaux et l'Union européenne craignent qu'en cas de victoire de Donald Trump, l'aide à l'Ukraine soit réduite et que les États-Unis exigent une plus grande implication de leur part, ainsi qu'une contribution accrue à l'aide internationale.
En réalité, Donald Trump n'apprécie ni la Russie ni le président Vladimir Poutine. Son souci principal est la défense des intérêts des États-Unis ; affirmer que les contribuables ne dépenseront pas d'argent pour un pays sans importance (l'Ukraine) est un moyen de gagner le soutien des électeurs. Lors du débat télévisé, la question asiatique a été à peine évoquée, mais cette région demeure un sujet de préoccupation, car elle met en jeu les intérêts stratégiques américains.
On peut affirmer que, quel que soit le président élu, les États-Unis poursuivront les politiques des partis républicain ou démocrate. Le nouveau président pourra certes ajuster ces politiques aux niveaux tactique et stratégique, mais les objectifs nationaux fondamentaux, tels que le maintien de la première puissance mondiale, le rôle de premier plan, l'influence et les intérêts stratégiques des États-Unis à l'échelle internationale, demeureront inchangés.
Chaque pays et organisation peut se réjouir des aspects positifs des politiques du candidat à la présidence américaine. Mais fondamentalement, la décision reste de préserver l'indépendance, l'autonomie, le multilatéralisme, la diversification des relations et de réagir de manière proactive à toutes les fluctuations.
Source : https://baoquocte.vn/nuoc-my-qua-lang-kinh-bau-cu-tong-thong-nam-2024-286386.html




![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la deuxième réunion du Comité directeur sur le développement économique privé.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1762006716873_dsc-9145-jpg.webp)























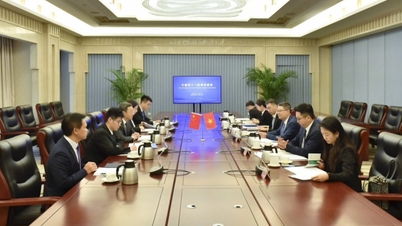




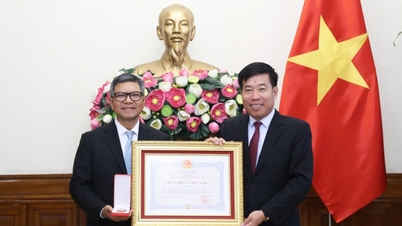




























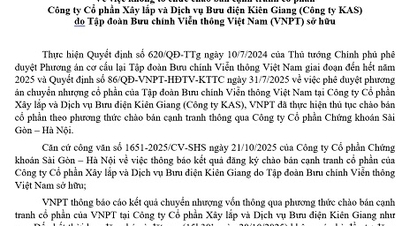

















































Comment (0)