Lors de sa première session, la Douma d'État russe a adopté une loi annulant la ratification du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. 423 députés ont voté à l'unanimité en faveur de ce texte. Que signifie refuser de le ratifier ?
 |
Il n'y a pas un, mais deux traités.
Le premier traité est intitulé « Traité d’interdiction des essais nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace et sous l’eau » (également connu sous le nom de « Traité de Moscou », du nom du lieu de sa signature). Il a été signé le 5 août 1963 à Moscou.
Les parties à l'accord, c'est-à-dire les pays initiateurs, étaient l'Union soviétique, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Le traité est entré en vigueur le 10 octobre 1963 et compte aujourd'hui 131 États membres.
Il convient de noter que la signature du traité ne constitue que la moitié du processus ; les documents les plus importants doivent être ratifiés, c’est-à-dire approuvés par les plus hautes instances législatives et exécutives du pays signataire. Autrement dit, la personne compétente de l’État (président, Premier ministre, ministre des Affaires étrangères ) signe le document. Mais pour que le traité entre en vigueur, il doit être ratifié par l’Assemblée nationale et adopté comme loi.
Le Parlement vote la ratification du traité et confirme ainsi l'engagement de l'État à respecter ses dispositions. La ratification est formalisée par un document spécifique appelé instrument de ratification. Dans le traité de Moscou, l'Union soviétique, les États-Unis et le Royaume-Uni sont les dépositaires. Les pays parties au traité transmettent respectivement leur instrument de ratification à Moscou, Washington ou Londres.
Il convient de souligner un point important. L'adhésion à un traité de ce type se déroule en deux étapes ; certains pays peuvent donc l'avoir signé sans l'avoir ratifié. Par exemple, le traité de Moscou n'a pas été signé par la Chine, la France, la Corée du Nord, la Corée du Sud et Israël. Ce traité est fondamentalement vicié, car certains pays souhaitaient se doter de l'arme nucléaire et ont donc refusé de le signer.
C’est ainsi qu’est né le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires – un traité international multilatéral qui interdit les essais d’armes nucléaires et toute autre explosion nucléaire à des fins civiles ou militaires , où que ce soit.
Ce traité n'a plus été initié par quelques pays, mais a été adopté lors de la 50e session de l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 septembre 1996 et signé le 24 septembre 1996. Ce traité a été préparé avec beaucoup plus de soin, car l'une de ses annexes définit clairement la liste des 44 pays capables de fabriquer des armes nucléaires et de l'énergie atomique.
En 2023, le traité avait été signé par 187 pays et ratifié par 178 d'entre eux.
Mais la question n'est pas de savoir qui a signé, mais qui n'a pas signé. Il a été indiqué plus haut que l'une des conditions d'entrée en vigueur du Traité est que chacun des 44 pays énumérés à l'Annexe 2 le signe et le ratifie.
Cette liste n'est pas aléatoire. Elle comprend 44 pays, établis par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), en fonction de la présence de pays exploitant des réacteurs nucléaires sur leur territoire au moment de la signature du Traité.
Tout est clair : s’il existe un réacteur nucléaire, il est possible d’obtenir du plutonium pour fabriquer des armes, ce qui signifie qu’il est théoriquement possible de fabriquer des armes nucléaires. De fait, de nombreux pays l’ont fait.
 |
Sur les 44 États dotés de l'arme nucléaire au moment de l'élaboration du traité, seuls trois ne l'ont pas signé : l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. Autrement dit, la première condition d'entrée en vigueur du traité n'était pas remplie, puisque seuls 41 des 44 États l'ont signé.
Le nombre de pays ayant ratifié le traité est encore plus faible, à seulement 36 sur 44. Parmi les pays n'ayant pas ratifié le traité figurent les États-Unis, la Chine, Israël, l'Iran et l'Égypte.
L’ONU n’a pas renoncé. Le 6 décembre 2006, l’Assemblée générale a adopté une résolution soulignant la nécessité d’une signature et d’une ratification rapides du Traité. 172 pays ont voté pour la résolution, et deux ont voté contre : la République populaire démocratique de Corée et les États-Unis.
Le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires n'est donc pas en vigueur, ce qui signifie qu'il reste, dans les faits, un vœu pieux. Cependant, ce n'est pas tout à fait le cas : de nombreux pays ont respecté les termes du Traité et n'ont procédé à aucun essai. Les États-Unis n'ont effectué aucun essai depuis 1992. La Russie a fait de même. Qu'il s'agisse d'un accord tacite ou d'un accord sincère importe peu ; l'essentiel est que les parties aient respecté les termes du Traité.
essais nucléaires russes
Il est impossible de retirer la signature, mais il est possible de retirer la ratification. La Russie restera signataire du traité, mais, de fait, partie à un traité invalide.
Entre 1949 et 1990, l'Union soviétique a procédé à 715 essais nucléaires, utilisant 969 engins nucléaires. Parmi ceux-ci, 124 ont été menés à des fins pacifiques .
La plupart des essais nucléaires en Union soviétique ont eu lieu sur le site d'essais nucléaires de Semipalatinsk et dans l'archipel de Nouvelle-Zemble.
Le 30 octobre 1961, la bombe à hydrogène la plus puissante de l'histoire, la Tsar Bomba, d'une puissance de 58 mégatonnes, explosa au centre d'essais de Novaya Zemlya.
Les ondes sismiques créées par l'explosion ont fait trois fois le tour de la Terre et les ondes sonores ont atteint une distance de 800 km.
Sur le site d'essais de Semipalatinsk, le 11 octobre 1961, a eu lieu la première explosion nucléaire souterraine.
 |
Le traité de Moscou « Interdiction des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace et sous l’eau », entré en vigueur fin 1963, ne mentionnait pas les essais souterrains. Cependant, l’une de ses conditions était que les retombées radioactives des explosions nucléaires à l’intérieur de la Terre ne devaient pas se propager au-delà du territoire du pays où les essais avaient été effectués.
De nombreux autres essais ont eu lieu sur le site d'essais de Semipalatinsk. De 1949 à 1989, 468 essais nucléaires y ont été menés, dont 616 ont été déclenchés par des engins nucléaires et thermonucléaires : 125 atmosphériques (26 au sol, 91 aéroportés, 8 en haute altitude) et 343 souterrains.
Le site d'essais de Semipalatinsk a été fermé le 29 août 1991. Il ne restait plus à la Russie qu'un seul site d'essais, à Novaya Zemlya.
À Novaya Zemlya, entre 1955 et 1990, 132 explosions nucléaires ont été réalisées, atmosphériques, terrestres, sous-marines et souterraines. Ce site a permis de tester différents dispositifs nucléaires.
 |
Essais nucléaires dans les pays
En termes de nombre d'essais nucléaires, ce ne sont pas les États-Unis qui occupent la première place, mais la Russie. De 1945 à 1992, les États-Unis ont officiellement mené 1 054 essais de tous types : atmosphériques, souterrains, de surface, sous-marins et spatiaux.
La plupart des essais ont été menés sur le site d'essais du Nevada (NTS), dans les îles Marshall, à la frontière des océans Pacifique et Atlantique. La dernière explosion nucléaire aux États-Unis a eu lieu sur ce site le 23 septembre 1992. Le site est depuis fermé, mais reste opérationnel.
La Chine a procédé à 45 essais d'armes nucléaires (23 atmosphériques et 22 souterrains) entre 1964 et 1996. Ces essais ont cessé en 1996, suite à la signature par la Chine du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Depuis 2007, par décret du gouvernement chinois, le site d'essais nucléaires de Lop Nur est totalement fermé et transformé en site touristique.
La France a effectué 210 essais nucléaires entre 1960 et 1996, mais pas sur son propre territoire : 17 essais ont été réalisés dans le désert du Sahara, en Algérie (ancien territoire français), 46 essais atmosphériques et 147 essais au sol et souterrains sur les atolls de Fangataufa et de Mururoa en Polynésie française.
 |
Le Royaume-Uni a procédé à son premier essai nucléaire le 3 octobre 1952, en faisant exploser un engin nucléaire à bord d'un navire ancré dans l'archipel de Monte Bello (au large de la pointe ouest de l'Australie). Au total, le Royaume-Uni a mené 88 essais nucléaires entre 1952 et 1991.
La Corée du Nord a procédé à six essais nucléaires sur le site d'essais nucléaires de Punggye-ri.
L'Inde a procédé à son premier essai nucléaire en 1974. En 1998, cinq explosions nucléaires souterraines avaient été réalisées sur un site d'essais situé dans le désert du Rajasthan, près de la ville de Pokhran. Depuis lors, l'Inde a été officiellement reconnue comme puissance nucléaire, mais deux jours plus tard, Delhi a annoncé son refus de procéder à de nouveaux essais.
Le Pakistan n'était pas loin derrière son rival. Le 28 mai 1998, il a fait exploser cinq bombes souterraines et une autre le 30 mai.
 |
Quel intérêt y aurait-il pour la Russie à retirer sa ratification du traité ?
Les armes nucléaires ont des propriétés très différentes des armes conventionnelles. Une balle conventionnelle peut rester inerte dans un entrepôt sec pendant des décennies sans perdre sa létalité.
Mais dans un dispositif nucléaire, des processus complexes de désintégration radioactive se produisent constamment. Autrement dit, au fil du temps, la composition isotopique de la charge change et peut se dégrader dans une certaine mesure.
De nos jours, de nombreux médias de pays hostiles affirment souvent que la Russie est un géant aux pieds d'argile, et que l'armée qui a semé la terreur pendant les 30 dernières années est en réalité loin d'être parfaite.
Par conséquent, le potentiel nucléaire russe se heurte aux mêmes problèmes que l'armée russe en général. Les missiles et les ogives datent de l'époque soviétique ; il y a donc lieu de penser que les capacités nucléaires de la Russie ne sont qu'un potentiel, à l'image de l'« épée rustique » de l'ère soviétique. Le plutonium est ancien et ne peut plus servir à fabriquer de nouvelles munitions, car ses propriétés isotopiques ont changé.
 |
Une telle idée risquerait d'affaiblir encore davantage la Russie, déjà en difficulté. Autrefois redoutée par l'Occident, la Russie inspire aujourd'hui beaucoup moins de crainte. Certes, le nucléaire n'est pas en cause, mais d'autres facteurs entrent en jeu. Or, la dissuasion nucléaire doit constituer une menace pour les adversaires de la Russie.
La levée unilatérale de l'interdiction est une option envisageable. Toutefois, le fait que le traité ne soit pas encore entré en vigueur, faute de ratification par de nombreux pays, lui confère une faible valeur juridique, même si tous les pays n'ont pas procédé à des essais par le passé.
Le retrait unilatéral de la Russie du Traité pour inspecter son arsenal nucléaire est une mesure nécessaire, indépendamment de la position des États-Unis et de l'Europe. Que les États-Unis procèdent ou non à des essais nucléaires en représailles est également sans importance. Et tester quelques missiles à ogives nucléaires sur le site d'essais de Nouvelle-Zemble ne présenterait absolument aucun risque.
Quoi qu’il en soit, de telles actions susciteront inévitablement une nouvelle vague d’indignation et de condamnation de la part de la communauté internationale, le mot clé étant ici « prochain » essai. Mais elles permettront de tirer des conclusions sur l’état du bouclier nucléaire russe.
Source




![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, assiste à la cérémonie de remise des prix VinFuture 2025](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F05%2F1764951162416_2628509768338816493-6995-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Photo] 60e anniversaire de la fondation de l'Association vietnamienne des artistes photographes](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F05%2F1764935864512_a1-bnd-0841-9740-jpg.webp&w=3840&q=75)






















































































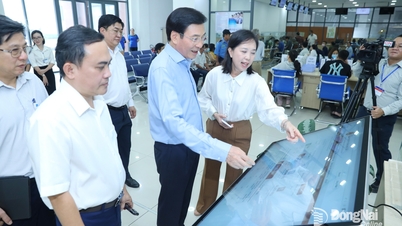


















Comment (0)