Au fil du temps, la lampe à huile fumante reste gravée dans la mémoire de chacun, même s'il a atteint l'âge de l'oubli. Sa faible lumière semble brûler éternellement, nous éclairant et nous guidant vers les années difficiles.
Avant l'arrivée de l'électricité dans la commune, les familles pauvres disposaient d'une ou deux lampes à huile, généralement des lampes en forme d'œuf de canard, car elles étaient bon marché et consommaient moins de combustible. Les familles aisées possédaient cinq ou sept lampes, et les grandes lampes étaient indispensables. Le jour, le travail était incessant ; la nuit, toutes les activités, du battage du riz à la fermentation des graines, en passant par le concassage des bananes pour les cochons et la consommation du riz, se déroulaient à la lumière vacillante des lampes à huile.
Au crépuscule, avant d'allumer la lampe, il faut nettoyer l'ampoule de la suie et de la fumée pour qu'elle soit plus lumineuse ; en même temps, il faut ajouter de l'huile et vérifier si la mèche est longue ou courte. Seuls les enfants de la maison s'en chargent, comme « les jeunes font de petits boulots ». Les jours de pluie ou lorsqu'on oublie d'acheter du pétrole, il faut aller chez le voisin pour en emprunter. Comme lorsqu'on manque de riz, on prend une bassine à emprunter ; le voisin est très généreux, prêt à nous prêter un pot de pétrole, un briquet ou un peu d'huile de cuisson… sans compter. « Amour du prochain », « quartier et pauvreté » sont ainsi.

Illustration : HOANG DANG
Dans les années qui ont suivi l'unification du pays, mon père était le chef de l'équipe de production agricole de la coopérative ; le jour, il contrôlait le travail et, le soir, il allumait une lampe pour tenir les comptes afin de savoir, à la saison des récoltes, comment mesurer le riz pour les membres. Mes frères et sœurs profitaient également de l'occasion pour s'asseoir à leur bureau et étudier à la lumière de la lampe de mon père, également pour économiser de l'huile. Le soir de la réunion d'équipe, lorsque j'entendais le gong, je sautais de joie car je pouvais suivre mon père jusqu'à la cour de l'entrepôt pour la réunion. Mon père portait une lampe, du genre à pied. Il me laissa la porter en premier, et j'étais très heureux. Depuis les routes, de nombreuses lumières vacillantes, telles des braises rouges, se rapprochaient de plus en plus. Arrivés au lieu de réunion, des dizaines de lampes étaient placées devant chaque groupe. Ces nuits étaient comme un festival de lumières scintillantes pour nous, les enfants.
Maintenant, chaque fois que je retourne dans ma ville natale et que je sors le soir, je vois parfois des lampes à huile dans les snacks vendant des produits comme du balut, des escargots bouillis, du maïs grillé, de la viande séchée grillée, etc. Les villageois connaissent ce spectacle et, de loin, lorsqu'ils voient les lumières allumées, ils peuvent identifier l'emplacement du magasin. Le bus de nuit traverse la ville, il ne reste que quelques kilomètres pour rentrer, mais la vue des lampes en forme d'œuf de canard de loin me donne une boule au ventre, impatient de rentrer.
Même si le stand d'œufs de cane est éclairé par la lumière vive de la rue, le propriétaire continue d'allumer la lampe en forme d'œuf de cane. Je me suis posé la question, et le propriétaire m'a expliqué : « C'est comme ça depuis que ma mère a commencé à vendre. Sans la lampe en forme d'œuf de cane, on a l'impression qu'il manque quelque chose, qu'il n'y aura plus de clients. Plus tard, les vendeurs de maïs et d'escargots ont aussi utilisé des lampes à huile, mais jusqu'à présent, les seules lampes en forme d'œuf de cane servaient à vendre des œufs de cane, c'est indéniable. »
À cette époque, pour économiser, chaque famille conservait des boules de coton séchées pour rembourrer ses oreillers et fabriquer des mèches pour ses lampes ou ses briquets. Fabriquer des mèches de lampe n'était pas chose aisée : trop petites, trop grandes, c'était mauvais. Fabriquer des mèches qui brûlaient lentement, consommaient peu d'huile et ne dégageaient pas beaucoup de fumée était un savoir-faire que tout le monde ne pouvait pas maîtriser.
Au plus fort de la saison des récoltes, le travail de la journée n'est pas terminé et la lampe doit rester allumée la nuit. On la place sur un tabouret haut pour que la lumière se diffuse plus largement et plus loin. Une fois tout terminé, la lampe œuf de canard est déplacée sur le porche pour le repas tardif. Elle est placée dans un coin du plateau, donnant la priorité à la lumière des enfants. Les sœurs se rendent également à la table d'étude avec cette lampe.
Certaines familles rurales ont désormais des maisons plus spacieuses. Les autels ancestraux sont également équipés de lumières électriques colorées, mais continuent d'allumer des lampes à huile à la pleine lune, au premier jour du mois, aux anniversaires de décès et surtout au Têt. À la vue des lampes en forme d'œuf de canard, les enfants et petits-enfants venus de la ville les contemplent comme s'ils étaient dans un monde étrange, assis joyeusement par terre, regardant les adultes nettoyer les ampoules, choisir la mèche, la percer, allumer les lampes… Peut-être n'imaginent-ils pas les jours difficiles, mais demain, ils comprendront et sympathiseront avec la vie difficile de leurs grands-parents et de leurs parents. Dans cet espace, la lumière de la lampe à huile leur rappelle les histoires anciennes qu'ils ont entendues, vécues et racontées au fil du temps. Comme les histoires tristes et joyeuses des cours d'éducation populaire, l'histoire des lampes allumées pour dire au revoir aux gens, l'attente de leur retour, l'histoire des études à la lumière de la lampe à huile…
Il y a eu une panne de courant, les enfants grimaçaient de chaleur. J'ai eu un moment de nostalgie et je me suis dit que si seulement une lampe à huile était allumée au milieu de la maison en ce moment, cette faible lumière me suffirait pour distinguer l'obscurité de la lumière, même si je ne voulais pas que l'époque des lampes à huile revienne.
Source








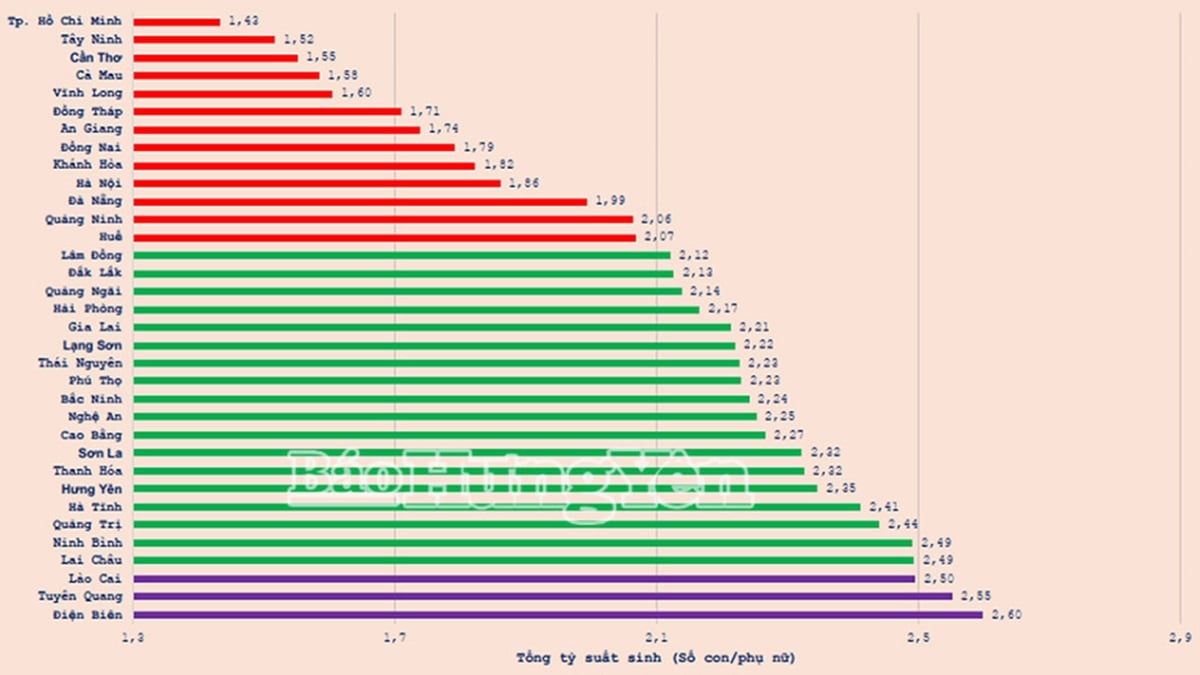











































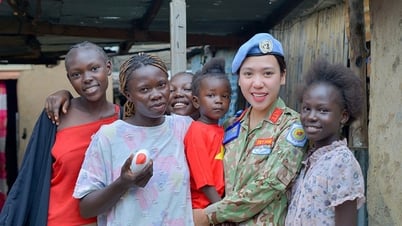
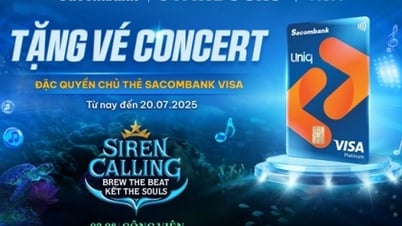







![[Maritime News] Plus de 80 % de la capacité mondiale de transport maritime par conteneurs est entre les mains de MSC et des principales alliances maritimes](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/6b4d586c984b4cbf8c5680352b9eaeb0)






















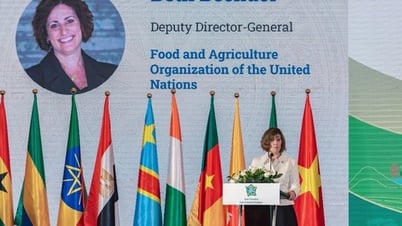















Comment (0)