
Le marché des crypto-actifs offre à la fois des opportunités d'innovation et de profits, mais aussi des risques - (Photo : Kaspersky)
Du Bitcoin à l'Ethereum en passant par les stablecoins et les NFT, le marché des crypto-actifs ouvre des perspectives d'innovation tout en présentant des risques pour la stabilité macroéconomique, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la protection des consommateurs. La question qui se pose aux pays est la suivante : comment réguler et autoriser le commerce des crypto-actifs de manière à encourager l'innovation tout en limitant le risque systémique.
Tout d'abord, pour réglementer les cryptoactifs, chaque pays doit définir juridiquement cette nouvelle classe d'actifs. Certains pays les considèrent comme une marchandise, d'autres comme des actifs incorporels, et d'autres encore classent certains jetons (actifs numériques) comme des titres s'ils sont de qualité investissement et susceptibles de générer des profits. Quelques pays vont plus loin et considèrent les cryptoactifs comme une monnaie, bien que la plupart ne les reconnaissent pas encore comme moyen de paiement légal. Cette définition juridique a entraîné une série d'exigences en matière de licences pour les plateformes d'échange, les portefeuilles électroniques et les services de garde, ainsi que des réglementations en matière de transparence, de lutte contre le blanchiment d'argent et d'obligations fiscales.
L'Union européenne (UE) est actuellement à l'avant-garde de l'élaboration d'un cadre juridique complet pour la gestion des cryptoactifs. La loi sur les marchés de cryptoactifs (MiCA) est considérée comme une étape importante, définissant clairement les responsabilités et obligations des émetteurs de jetons, des plateformes d'échange, des fournisseurs de portefeuilles électroniques et, plus particulièrement, des émetteurs de stablecoins. La MiCA exige des réserves pour garantir les stablecoins et la transparence financière afin de protéger les investisseurs. Grâce à ce cadre juridique, l'UE espère instaurer la stabilité et ouvrir un environnement concurrentiel équitable au sein de l'Union, permettant aux startups d'opérer au-delà des frontières sans se heurter aux différents obstacles juridiques entre les pays membres. Cependant, le coût de la mise en conformité avec la MiCA est important, en particulier pour les petits projets. On craint donc qu'une réglementation trop stricte ne freine l'innovation.

Chaque pays possède son propre modèle de gestion des crypto-actifs - (Photo : Bankless Times)
Contrairement à l'UE, les États-Unis adoptent une approche plus fragmentée, avec différentes agences impliquées dans la surveillance. La Securities and Exchange Commission (SEC) traite souvent de nombreux jetons comme des valeurs mobilières et impose des exigences d'enregistrement, tandis que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) les réglemente comme des matières premières. De plus, l'Internal Revenue Service (IRS) exige des particuliers et des organisations qu'ils déclarent les bénéfices issus du trading de cryptoactifs comme revenus imposables. Ces dernières années, les États-Unis ont connu de nouveaux progrès, avec l'approbation par la SEC des fonds négociés en bourse (ETF) au comptant basés sur Bitcoin et Ethereum, ouvrant la voie à davantage de capitaux institutionnels. Les points forts du modèle américain résident dans la transparence, la protection des investisseurs et la profondeur des marchés financiers. Cependant, parallèlement, la surveillance fragmentée et les différences entre les États compliquent la détermination des obligations légales des entreprises, tandis qu'une prudence excessive a également laissé les États-Unis à la traîne dans l'expérimentation de produits financiers décentralisés.
Le Japon a été l'un des premiers pays asiatiques à intégrer les cryptomonnaies à son système juridique. Après l'effondrement de Mt. Gox, le pays a modifié sa loi sur les services de paiement afin de considérer les cryptomonnaies comme des actifs virtuels légaux et a exigé des plateformes d'échange qu'elles s'enregistrent et se conforment strictement à la réglementation anti-blanchiment. L'Agence japonaise des services financiers (FSA) assure la supervision et taxe fortement les revenus des transactions en cryptomonnaies. Grâce à ce cadre juridique strict, le Japon est devenu un marché des cryptomonnaies plus stable et transparent, même si la charge fiscale et réglementaire demeure un obstacle pour de nombreux investisseurs particuliers.
Singapour a quant à elle adopté une approche plus équilibrée. Le pays ne considère pas les cryptomonnaies comme une monnaie légale, mais les reconnaît comme des actifs négociables. La loi sur les services de paiement (PSA) impose un agrément et une supervision stricts aux plateformes d'échange et aux fournisseurs de portefeuilles, ainsi que des exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) fixe des normes pour les stablecoins, ne reconnaissant que ceux disposant de réserves et de transparence. Son environnement réglementaire ouvert mais étroitement contrôlé a fait de Singapour une destination attractive pour les entreprises mondiales de blockchain et de fintech.

L'industrie des cryptomonnaies a investi des dizaines de millions de dollars dans l'élection présidentielle américaine de 2024 - (Photo : Getty Images)
La Corée du Sud est également en passe de devenir une plaque tournante du trading de cryptomonnaies en Asie. Le gouvernement exige de tous les fournisseurs de services d'actifs virtuels qu'ils s'enregistrent et se conforment aux réglementations AML/KYC. Après les scandales Terra-Luna, la Corée du Sud a renforcé la surveillance, interdit les cryptomonnaies anonymes et renforcé la protection des investisseurs individuels. Cela a permis de sécuriser le marché des cryptomonnaies en Corée du Sud, mais aussi de réduire considérablement le nombre de cryptomonnaies légalement cotées en bourse.
Plusieurs pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Afrique ont interdit les cryptomonnaies par crainte d'une perte de contrôle des flux de capitaux. Le Salvador, quant à lui, a reconnu le Bitcoin comme monnaie légale pour attirer les investissements, mais ce modèle est controversé car les fortes fluctuations de son cours peuvent accroître les risques macroéconomiques.
En observant la carte mondiale de la gestion des crypto-actifs, on constate que chaque modèle présente ses propres avantages et inconvénients. Des politiques strictes contribuent à limiter les risques macroéconomiques, mais peuvent freiner l'innovation, tandis que des cadres juridiques ouverts sont facilement exploités à des fins illégales. Par conséquent, l'approche la plus efficace consiste à mettre en place un système juridique clair mais flexible, combinant une supervision stricte, des mécanismes de test et la protection des investisseurs. Les pays doivent également privilégier la coordination internationale : les cryptomonnaies n'ayant pas de frontières, toute faille juridique peut devenir un point faible à exploiter.
Ces dernières années, plusieurs tendances importantes ont façonné le paysage mondial de la gestion des actifs cryptographiques. Ces mesures comprennent : la réglementation des stablecoins et la tokenisation des actifs ; la coopération internationale en matière de cryptomonnaies transfrontalières ; les tests en sandbox ; et la réforme fiscale visant à accroître les recettes. Par ailleurs, les pays s'efforcent d'améliorer leurs cadres fiscaux et comptables afin d'accroître les recettes budgétaires et de réduire la fraude.
L'essor des cryptoactifs représente à la fois un problème complexe et une formidable opportunité pour les économies . Régulée efficacement, la cryptomonnaie peut devenir un moteur d'innovation financière, soutenir le commerce mondial et multiplier les opportunités d'investissement. À l'inverse, si elle est laxiste ou trop rigide, les risques financiers et sociaux peuvent augmenter, ou des opportunités de développement peuvent être manquées. L'important n'est pas de choisir un « modèle standard », mais de trouver un équilibre entre innovation et contrôle, encouragement et supervision, afin de construire un écosystème financier numérique durable.
Source : https://vtv.vn/giao-dich-tai-san-ma-hoa-duoi-lang-kinh-quan-ly-toan-cau-100251003105215767.htm



![[Photo] Le secrétaire général To Lam assiste au 8e Congrès du Comité central du Parti de la sécurité publique](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/79fadf490f674dc483794f2d955f6045)
![[Photo] Ouverture solennelle du 8e Congrès du Comité central du Parti de la sécurité publique, mandat 2025-2030](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/f3b00fb779f44979809441a4dac5c7df)

![[Photo] Fête animée de la mi-automne au Musée d'ethnologie](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/da8d5927734d4ca58e3eced14bc435a3)


























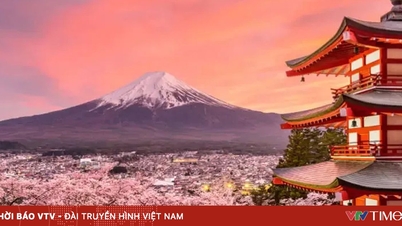



























![[VIDÉO] Résumé de la cérémonie du 50e anniversaire du Petrovietnam](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/abe133bdb8114793a16d4fe3e5bd0f12)

![[VIDÉO] LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA LAM DÉCERNE À PETROVIETNAM 8 MOTS D'OR : « PIONNIER - EXCELLENT - DURABLE - MONDIAL »](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/23/c2fdb48863e846cfa9fb8e6ea9cf44e7)


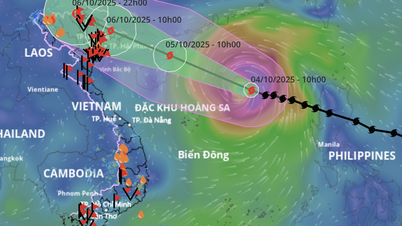

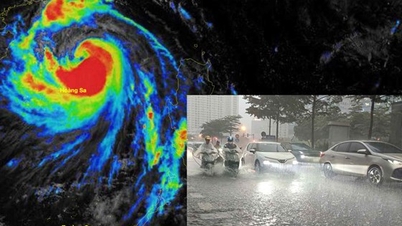

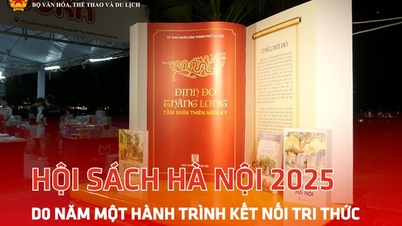









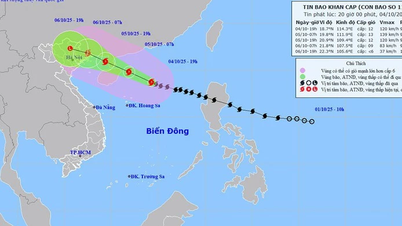












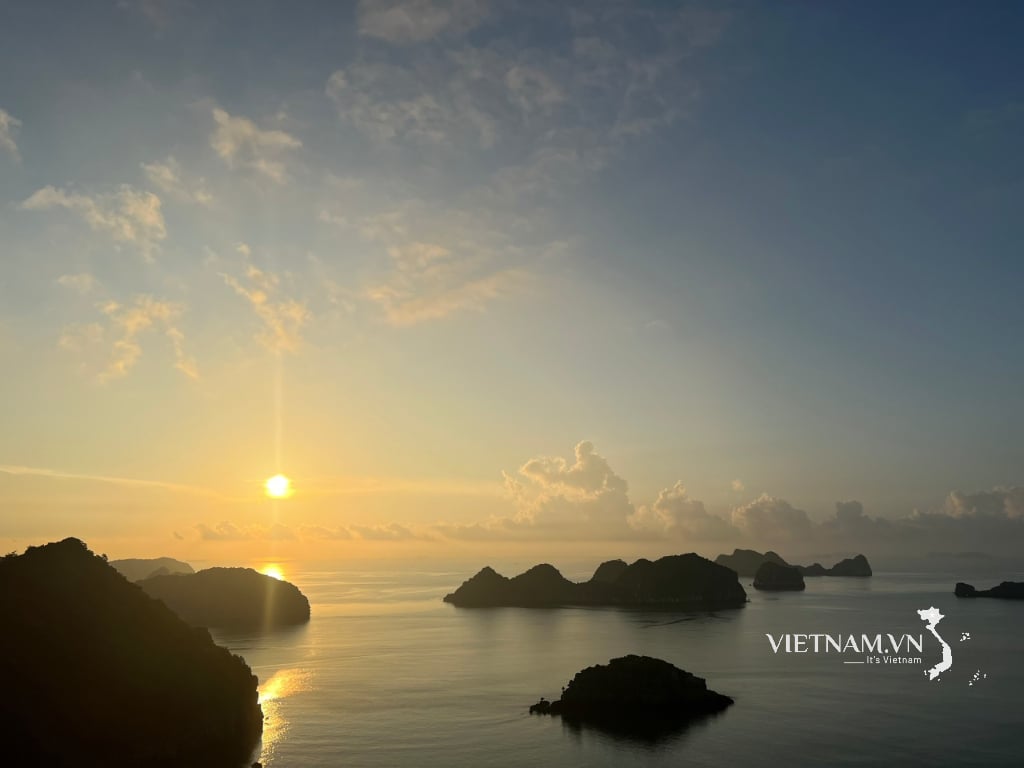


Comment (0)