Espace d'influence ne signifie pas contrôle
Contrairement au modèle hégémonique classique, la Russie ne peut pas (et ne pourra jamais) exercer un contrôle total sur ses voisins comme elle le faisait à l'époque soviétique. Cependant, son influence demeure présente à travers quatre axes principaux :
(1) Le système éducatif , le droit, la langue et la pensée administrative de nombreux pays portent encore la marque russe/soviétique.
(2) Les communautés russes, ethniques russes et de la diaspora post-soviétique continuent de créer des canaux d’influence transnationaux informels.
(3) Dépendances en matière d’infrastructures et de sécurité économique : notamment dans les domaines de l’énergie, des transports et de la défense.
(4) Stratégies de puissance douce et dure : De la présence militaire (comme en Arménie, en Biélorussie, au Tadjikistan) aux outils d’influence douce par le biais des médias et de la culture.
Cependant, l’influence ne se confond pas avec la confiance. Au contraire, la crainte des intentions de la Russie s’accroît avec la proximité historique et géographique. Les pays les plus proches de la Russie cherchent de plus en plus à « élargir leurs options », notamment par la coopération avec la Turquie, la Chine, l’Occident, voire des organisations multilatérales comme les BRICS.
Les analystes soulignent que le phénomène de « superpuissance de proximité » constitue une particularité du cas russe. Contrairement aux États-Unis, géographiquement isolés et sans voisins puissants, la Russie partage une longue frontière avec de nombreux petits pays faibles, mais souvent méfiants. Il en résulte une tension stratégique particulière : les petits pays se sentent constamment menacés par une éventuelle intervention, tandis que la Russie se sent cernée par la volonté de se désengager et de coopérer avec l’extérieur.
Cette crainte ne repose pas seulement sur l'histoire, mais aussi sur la réalité : la Russie a eu recours à la force en Géorgie (2008), en Ukraine (de 2022 à aujourd'hui) et a exercé une influence considérable dans la crise arméno-azerbaïdjanaise. Par conséquent, aussi bien intentionnée soit-elle, Moscou aura bien du mal à convaincre ses voisins qu'elle est un « partenaire normal ».
La Russie ne possède pas de frontières naturelles facilement défendables comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Avec des frontières continentales ouvertes et s'étendant sur de nombreuses régions instables, le contrôle de la sécurité ne peut être assuré uniquement par des moyens militaires, mais doit s'appuyer sur une influence socio-politique dans l'espace environnant.
Dans le même temps, la structure ethno-sociale de la Russie empêche l'érection d'une barrière totale. Se couper de l'espace post-soviétique entraînerait non seulement un éclatement géopolitique, mais aussi un risque de fragmentation interne : Russes, Tatars, Daghestanais, Bachkirs, Tchétchènes et migrants d'Asie centrale formeraient des réseaux de liens transfrontaliers, tant culturels qu'économiques. Il ne s'agit pas seulement d'une question de sécurité, mais aussi d'une question d'existence pour la Fédération de Russie.
De l'asymétrie à l'équilibre souple
La présence de la Turquie dans le Caucase ou en Asie centrale ne saurait éclipser le rôle traditionnel de la Russie, mais elle suffit à conférer aux petits pays un léger pouvoir d’influence dans les négociations avec Moscou. Il s’agit là d’un exemple typique de stratégie d’« équilibrage souple » : non pas une confrontation directe avec la puissance centrale, mais la recherche d’un élargissement des options stratégiques par l’encouragement de la participation de pays tiers.
Cependant, la Turquie n'est pas le seul acteur. Au cours de la dernière décennie, la présence et l'influence croissantes des États-Unis, de l'Union européenne (UE) et surtout de la Chine ont modifié l'équilibre des pouvoirs dans l'espace post-soviétique. Tandis que les États-Unis privilégient l'assistance militaire, la formation et la coopération en matière de sécurité avec des pays comme la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie et certains pays baltes, principalement pour contenir l'influence militaro-stratégique de la Russie, l'UE investit massivement dans la réforme institutionnelle, les infrastructures et le commerce, notamment par le biais du Partenariat oriental – un mécanisme souple mais de long terme visant à intégrer progressivement des pays comme l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie à l'espace européen, non pas géographiquement, mais en termes de modèle opérationnel.
La Chine étend son influence dans une direction différente : principalement grâce à sa puissance économique et à ses investissements stratégiques, notamment en Asie centrale. Pékin a évité la confrontation directe avec la Russie, mais a renforcé son influence par le biais de l’initiative « la Ceinture et la Route », de projets énergétiques et du rôle croissant de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).
Il en résulte un espace post-soviétique qui n'est plus la seule « cour arrière » de la Russie, mais une arène multipolaire où s'affrontent les rivalités d'influence. Les pays de la région, notamment les plus petits et les plus vulnérables, diversifient de plus en plus leurs partenaires, non pas pour se couper de la Russie, mais pour éviter une dépendance absolue. Le réseau de relations dans la région est ainsi plus multidimensionnel et complexe que jamais : la Russie n'en est plus le seul centre névralgique, mais demeure un axe incontournable. Les pays de la région cherchent à étendre leur marge de manœuvre stratégique sans rompre complètement les liens avec Moscou. Ces nouveaux liens avec la Chine, la Turquie, l'UE ou les États-Unis sont de nature tactique et flexible, et servent souvent d'instruments pour accroître leur pouvoir de négociation au sein de cercles stratégiques plus larges.
Dans ce contexte, la diplomatie devient l'outil central, et toute solution de politique étrangère exige de l'ingéniosité, prenant en compte les conséquences interrégionales et à long terme. Les solutions unilatérales ou à sens unique n'ont plus lieu d'être, même face à une puissance comme la Russie.
Il est clair que l'espace post-soviétique s'est complexifié ces dernières années ; si l'influence de la Russie persiste, son contrôle s'en trouve amoindri. Toute politique étrangère efficace dans la région doit reposer sur une compréhension approfondie des vulnérabilités des petits États, de l'ouverture de cet espace géographique et des limites de la structure étatique russe elle-même. Une stabilité durable ne pourra advenir que lorsque la Russie passera d'une logique de « protection de son influence » à une logique de « gestion des relations », où la puissance s'exprime non par la coercition, mais par la fiabilité de son rôle de partenaire régional.
Hung Anh (Contributeur)
Source : https://baothanhhoa.vn/khong-gian-hau-xo-viet-va-nghich-ly-anh-huong-cua-nga-253898.htm






![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le président de l'Agence de presse latino-américaine de Cuba](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F01%2F1764569497815_dsc-2890-jpg.webp&w=3840&q=75)






























































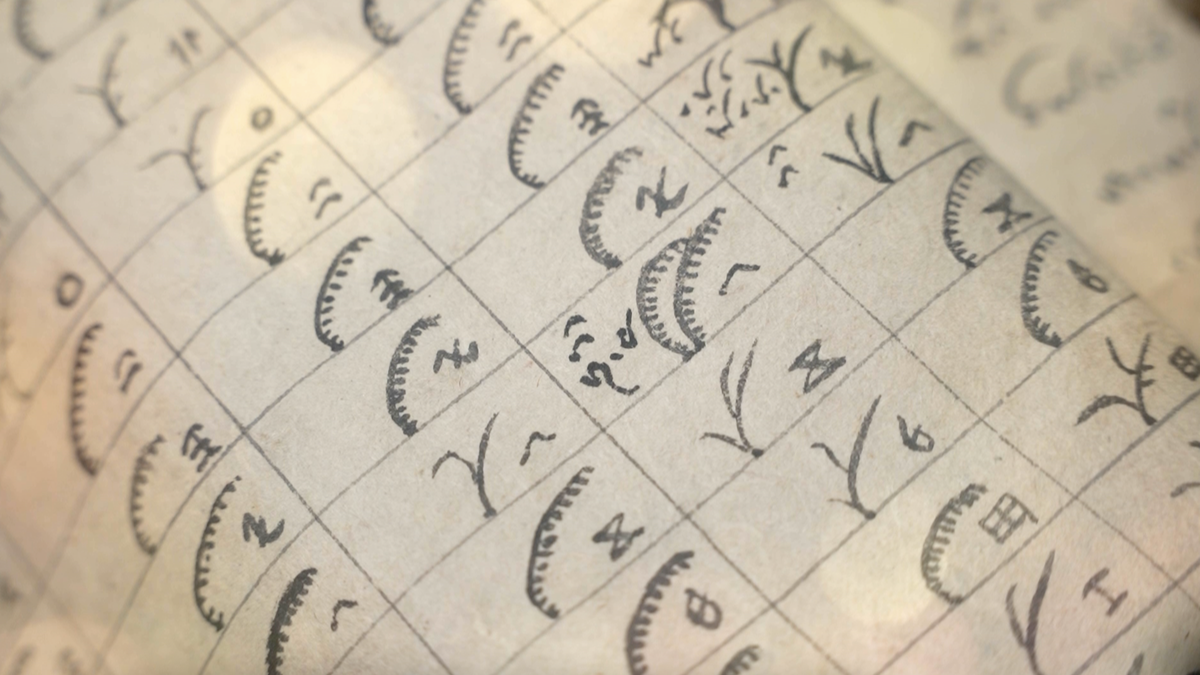







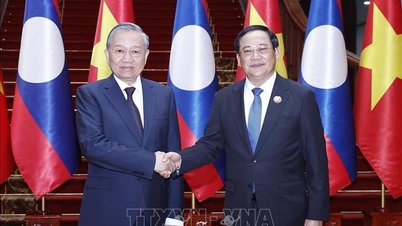




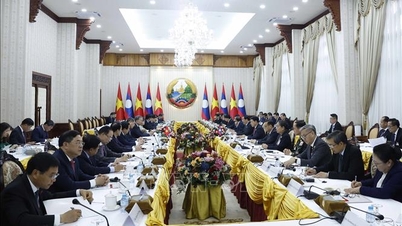






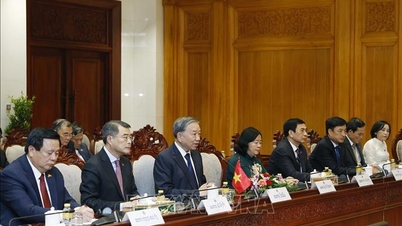























Comment (0)