Les trois genres du roman, du théâtre et de la poésie ont émergé au cours de cette période, avec trois représentants éminents : Ihara Saikaku, Chikamatsu Monzaemon et Matsuo Bashō.
Littérature urbaine et populaire
La renaissance littéraire débuta au XVIIe siècle, au début de la période où le shogunat Tokugawa établit sa seigneurie à Edo (aujourd'hui Tokyo). La littérature marchande et civile des débuts se développa selon le modèle du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle.
Durant deux siècles et demi d'isolement, sans aucune relation avec le monde extérieur, cette littérature manqua de ferment nouveau et perdit peu à peu sa vitalité, surtout à l'entrée du XIXe siècle.
Les personnages centraux de la littérature ne sont plus les princes, les dames et les dames de la cour royale de la dynastie Heian ; ils ne sont pas non plus les guerriers qui combattaient sur les champs de bataille du haut Moyen Âge ; mais plutôt les riches marchands, les petits commerçants, les artisans, les prostituées, etc. des classes urbaines.
Les trois genres du roman, du théâtre et de la poésie ont émergé au cours de cette période, avec trois représentants éminents : Ihara Saikaku, Chikamatsu Monzaemon et Matsuo Bashō.
 |
| Poète Ihara Saikaku (1642-1693). |
Ihara Saikaku (1642-1693) était un poète et romancier, l'une des figures les plus marquantes de la littérature japonaise de l'époque d'Edo. Riche marchand d'Osaka, il se consacra à l'écriture à l'âge de quarante ans. Voyageur invétéré et auteur d'observations subtiles, il écrivait dans un style réaliste, humoristique et précis, à l'image des haïkus qu'il maîtrisait parfaitement.
Il a écrit Ukiyo-zōshi (Ukiyo-zoshi – Monde flottant) pendant douze ans. Il n'abordait que des sujets contemporains : histoires d'amour passionnées ou érotiques, guerre, histoires du monde des affaires, créant des « comiques de la vie » en ville et à la campagne. Il racontait des histoires drôles.
On raconte l'histoire d'une belle épouse d'un petit maître qui tend un piège à un serviteur amoureux du serviteur de son mari ; elle finit par s'endormir dans ses bras. Elle doit ensuite s'exiler avec lui ; tous deux sont capturés et punis. Une autre histoire raconte que, dans un village reculé, des habitants adorent un parapluie venu de nulle part. Le dieu du parapluie exige d'être sacrifié à une femme ; une jeune veuve se porte volontaire ; après une longue attente, le dieu ne venant pas, elle se met en colère et déchire le parapluie en morceaux…
Ihara Saikaku composa environ 12 volumes de poésie et de critiques poétiques à la fin de sa vie, dont un recueil de poèmes (environ 23 500 poèmes) composé en une seule journée. Après la mort de sa femme (1675), il composa un haïkai (long poème du genre japonais waka – Hoa ca) de plusieurs milliers de vers en douze heures (Haikai Dokugin Ichinichi – Haikai Un jour de célibat, mille poèmes). Parallèlement, il décida de se faire moine laïc et entreprit de voyager à travers le Japon.
Il a écrit de nombreux romans célèbres tels que : La Vie d'un homme passionné (Koshuku Ichidai otoko, 1682), Cinq femmes qui aiment l'amour (Koshoku Gonin Onna, 1686)...
* * *
Chikamatsu Monzaemon (1653-1725) était un dramaturge de marionnettes et de théâtre vivant considéré comme le « plus grand dramaturge japonais » et le Shakespeare du Japon. Issu d'une famille de samouraïs, il était un fin connaisseur des études chinoises et fut moine bouddhiste pendant un certain temps.
Ses pièces ont largement dépassé la littérature contemporaine, même si, en raison d'une trop grande attention portée aux caractéristiques du théâtre de marionnettes, leur valeur littéraire a parfois été réduite. Aujourd'hui encore, ses pièces conservent des traits modernes ; elles présentent le destin humain à travers des personnages de classes populaires, maltraités par le destin, avec un réalisme et un lyrisme à la fois.
Il ne louait ni ne condamnait les chefs de famille adonnés aux femmes, ni les prostituées, mais les plaignait. La vertu exaltée était Giri (qui signifie « Justice » en chinois) ; le mot « Justice » désigne ici un devoir, une dette spirituelle à payer. Parmi les pièces célèbres de Chikamatsu, on peut citer Le Double Suicide de Sonezaki (Sonezaki Shinju, 1703), Le Suicide d'amour à Amijima (Shinju Ten no Amijima, 1721) et Le Messager de l'Enfer (Meido no Hikyaku, 1711)…
* * *
Matsuo Bashō (1644-1694), également connu sous le nom de Maître Zen Ba Tieu, était un poète et un peintre célèbre. Issu d'une famille paysanne, il s'est passionné pour la littérature dès son plus jeune âge. Il était un fin connaisseur de la poésie chinoise. Après avoir travaillé comme fonctionnaire pendant un certain temps, il a pratiqué le Zen. Il a fondé le Tao Dan Sofu (Tieu Phong – métaphore de la vie d'un artiste, comme les feuilles de Ba Tieu déchirées par le vent lors des nuits d'orage), prônant l'expression des sentiments véritables, sans se laisser contraindre par les règles et les formes.
Il voyagea dans de nombreux endroits, puis revint dans une simple maison près d'Edo, au bord de la rivière. Devant la maison se trouvait une bananeraie, d'où le nom de Bashō-am. Sa maison brûla, et il voyagea de nouveau vers des lieux magnifiques, écrivit des poèmes et peignit à l'encre, affinant son esprit et son art poétique.
Il a grandement contribué à réformer la poésie haïku, une forme poétique humoristique courante, aux règles strictes et aux jeux de mots intenses. Chaque poème haïku ne comportait que trois vers de 5 + 7 + 5 syllabes.
Il a élargi le thème du haïku, intégrant à ses poèmes des expressions familières et un contenu philosophique, un lyrisme libre et de nombreuses émotions subtiles. Son dernier haïku raconte une nuit où le poète et ses compagnons dormirent dans une auberge avec deux prostituées. Les deux jeunes filles demandèrent à se joindre au groupe, mais le moine n'osa pas les accepter, car elles avaient de nombreux autres endroits où aller.
Il les aimait et écrivit des poèmes à ce sujet. Parmi ses œuvres principales, on peut citer : Journal d'exposition sur le terrain (Nozarashi Kikō, 1685), Jour de printemps (Haru ni Hi, 1686), Journal de voyage à Kashima (Kashima Kikō, 1687), Le Chemin vers Oku (Oku no Hoshomichi, 1689), Journal de saga (Saga Nikki, 1691)…
Pour apprécier chaque poème Haïku, il est nécessaire de comprendre le contexte dans lequel le poème a été créé et le contexte historique qui sous-tend le poème.
Source

























![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rend visite à la mère héroïque vietnamienne, Ta Thi Tran](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/20/765c0bd057dd44ad83ab89fe0255b783)





























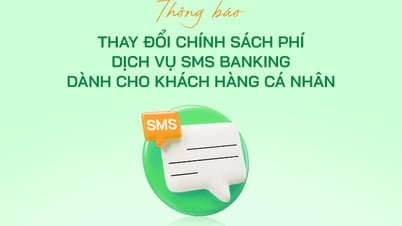

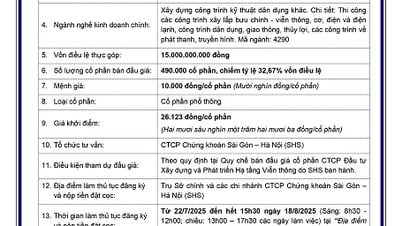








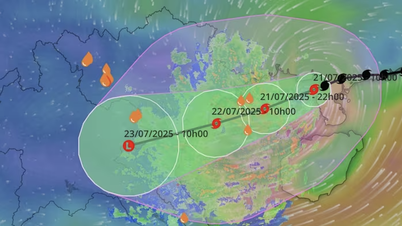





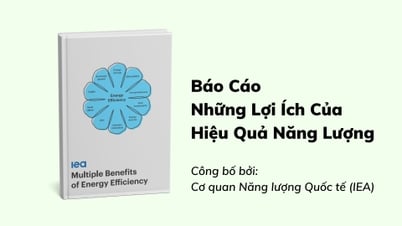





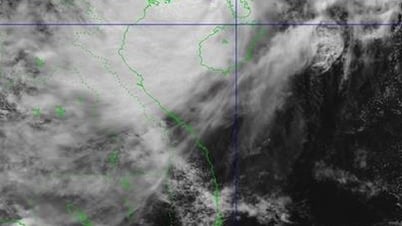























Comment (0)