De nombreux pays d'Asie- Pacifique ont commencé à se préparer à l'éventualité d'un retour de M. Trump à la Maison Blanche. Pour le Vietnam, l'impact le plus important d'un éventuel retour de M. Trump pourrait provenir du secteur commercial.
Le président américain Donald Trump à Hanoï , le 11 novembre 2017, lors de sa visite officielle au Vietnam. Photo : Jonathan Ernst / Reuters
Les récents développements politiques aux États-Unis, notamment après le débat entre Donald Trump et Joe Biden, incitent de nombreux observateurs à prédire un possible retour de M. Trump. Même de grands journaux américains réputés, comme le New York Times et CNN, qui ont tendance à soutenir le candidat démocrate, ont commencé à mettre en garde contre une possible défaite du président Biden lors des prochaines élections de novembre.
Face à cette perspective, de nombreux pays d'Asie-Pacifique ont élaboré des scénarios pour le retour de M. Trump. De Manille à Tokyo, une série de conférences organisées par les gouvernements asiatiques en 2024 a attiré des experts pour prédire l'orientation de la politique américaine en cas de retour de Donald Trump à la Maison Blanche.
Parmi les intervenants de ces conférences figuraient d'anciens responsables de l'administration Trump et des personnalités susceptibles d'être nommées à des postes clés au sein de la prochaine administration Trump. Par exemple, l'Asia Leadership Conference (ALC) a invité Mike Pompeo, ancien secrétaire d'État américain sous Trump, à prendre la parole. Le World Knowledge Forum 2024, en Corée du Sud, a également accueilli John Kelly, ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche. Leurs interventions, axées sur « l'Amérique d'abord », ont fourni des indications précieuses sur la politique américaine potentielle des quatre prochaines années, aidant les pays de la région à s'y préparer.
Les alliés qui s'appuient sur le réseau de sécurité américain en Asie-Pacifique, comme le Japon et la Corée du Sud, intensifient leurs négociations pour restructurer leurs accords de partage des charges de défense. L'objectif est de réduire le risque que le président Trump exige des coupes dans le budget de défense américain pour la région, qui s'élève à des milliards de dollars par an. Cet effort conjoint comprend également le renforcement de l'accord de sécurité AUKUS entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis pour le développement de sous-marins nucléaires ; et la promotion du Cadre économique indo-pacifique pour bâtir des chaînes d'approvisionnement résilientes et durables dans la région.
Pour le Vietnam, l’impact le plus significatif du retour potentiel de M. Trump pourrait provenir du commerce, une préoccupation partagée par de nombreux pays de la région qui ont des liens commerciaux bilatéraux forts avec les États-Unis, comme la Thaïlande, la Malaisie et surtout le Vietnam – le pays ayant le plus grand chiffre d’affaires commercial avec les États-Unis en Asie du Sud-Est.
Source : Francesco Guarascio / Reuters
Notes sur les échanges commerciaux entre le Vietnam et les États-Unis
Sous l'administration Biden, les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour réduire leur dépendance commerciale à l'égard de la Chine en adoptant des mesures telles que l'augmentation des droits de douane et le contrôle des exportations. Plus récemment, en mai 2024, le président Biden a annoncé son intention d'augmenter les droits de douane sur les véhicules électriques chinois de plus de 100 %, sur les semi-conducteurs de 50 % et sur plusieurs autres produits dominés par la Chine, tels que les panneaux solaires, les batteries au lithium pour véhicules électriques et les minéraux critiques.
Ces évolutions ont fait du Vietnam l'un des pays les plus attractifs pour les investissements étrangers. Cependant, cet avantage pourrait être considérablement réduit si M. Trump est réélu. Bien que de plus en plus d'entreprises développent leurs activités au Vietnam, la majorité des entreprises étrangères dépendent encore de pièces et composants fabriqués en Chine.
Les données de la Banque asiatique de développement (BAD) montrent que les composants importés représentaient environ 80 % des exportations d’électronique du Vietnam – un produit d’exportation clé vers les États-Unis – en 2022. Un rapport de 2020 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a également montré qu’environ 90 % des biens intermédiaires importés par les industries électroniques et textiles du Vietnam pour la production sont ensuite devenus des composants de produits d’exportation, un chiffre bien supérieur à la moyenne des pays développés.
Pour Biden, le maintien de bonnes relations avec le Vietnam est l'une des priorités absolues de sa stratégie régionale. En témoignent la volonté constante des États-Unis d'améliorer leurs relations avec le Vietnam en 2023, notamment la visite de Biden en septembre dernier et l'élévation des relations entre les deux pays au rang de partenariat stratégique global.
Toutefois, sous l’administration Trump, le paysage commercial actuel pourrait devenir l’un des axes clés de la stratégie commerciale des États-Unis en Asie-Pacifique, d’autant plus que le Vietnam continue de jouer un rôle important dans la chaîne d’approvisionnement mondiale et reprend certaines activités de fabrication de la Chine.
Donald Trump signe un décret ordonnant le retrait des États-Unis du Partenariat transpacifique (TPP) ; Photo : Ron Sachs / Getty Images
Tout au long de son premier mandat, Donald Trump a exprimé son mécontentement face au déficit commercial bilatéral croissant des États-Unis, y voyant un signe de faiblesse de l'économie nationale et d'exploitation de ses partenaires économiques. Fort de ce constat, Trump a mis en œuvre une série de politiques visant à rééquilibrer les relations commerciales, protégeant ainsi les industries nationales, tout en exacerbant les tensions et l'instabilité sur les marchés mondiaux.
Dès son entrée en fonction, Trump a retiré les États-Unis du Partenariat transpacifique (TPP), affirmant que les États-Unis souffraient d'excédents commerciaux avec leurs partenaires. Il a même exigé que tous les documents d'information, avant chaque rencontre ou échange avec un dirigeant étranger, indiquent clairement si ce pays affichait un excédent commercial avec les États-Unis.
Le déficit commercial des États-Unis a considérablement augmenté au cours des 30 dernières années ; Graphique : The Real Economy Blog
L’accent mis par Trump sur la réduction du déficit commercial a conduit à une série d’actions agressives contre la Chine qui ont marqué le début de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en 2018. En mars de cette année-là, Trump a signé un mémorandum ordonnant au représentant américain au Commerce (USTR) d’imposer des droits de douane sur jusqu’à 60 milliards de dollars d’importations chinoises, après qu’une enquête en vertu de l’article 301 a conclu que la Chine s’était livrée à des « pratiques commerciales déloyales », notamment le vol de propriété intellectuelle et les transferts de technologie forcés.
La première vague de droits de douane a été lancée en juillet 2018, imposant un droit de douane de 25 % sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises. En réponse, Pékin a imposé des droits de douane sur la même quantité de produits américains. La guerre commerciale a continué de s'intensifier et, en septembre 2018, les États-Unis avaient imposé des droits de douane sur 200 milliards de dollars supplémentaires de marchandises chinoises, initialement de 10 %, puis portés à 25 % en mai 2019.
Outre les droits de douane, Trump a imposé d'importantes restrictions aux activités commerciales des entreprises technologiques chinoises. En mai 2019, le Département du Commerce américain a notamment inscrit Huawei sur la « Liste des entités », interdisant au géant technologique d'acheter des technologies américaines sans l'approbation du gouvernement.
La politique commerciale de Trump n'a pas seulement ciblé ses principaux concurrents comme la Chine, mais s'est également étendue à des pays plus petits qui affichent d'importants excédents commerciaux avec les États-Unis, notamment ceux qui sont perçus comme bénéficiant des performances économiques de la Chine. Les droits de douane imposés par l'administration Trump en 2018 sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du monde entier, qui ont affecté des alliés proches comme l'Union européenne, le Canada, l'Australie et le Mexique, en sont un parfait exemple.
La même année, Trump a également fait pression sur la Corée du Sud pour qu'elle renégocie l'accord de libre-échange entre les États-Unis et la Corée du Sud (KORUS), ce qui a entraîné la prolongation des droits de douane sur les pick-up de fabrication coréenne et une augmentation des exportations automobiles américaines vers le marché sud-coréen. Ces actions ont démontré la volonté de Trump d'utiliser les mesures commerciales pour protéger les intérêts économiques des États-Unis, même avec des partenaires avec lesquels il entretient des liens étroits et de longue date.
Photo d'illustration : Getty Images
Les échanges commerciaux entre le Vietnam et les États-Unis sous Trump et Biden
Malgré de bonnes relations, le Vietnam n'a pu éviter les tensions commerciales avec l'administration Trump durant la période 2018-2020, principalement en raison de l'important déficit commercial des États-Unis avec le Vietnam, qui a atteint 49,5 milliards de dollars en septembre 2020, juste derrière la Chine et le Mexique. En octobre 2020, le Bureau du Représentant américain au Commerce (USTR) a ouvert deux enquêtes afin de déterminer si le Vietnam avait manipulé sa monnaie pour subventionner ses exportations, désavantageant ainsi les entreprises américaines.
Cette décision fait suite à la décision antérieure du Département du Trésor américain d'accuser le Vietnam de sous-évaluer sa monnaie et d'ouvrir une enquête sur l'imposition de droits compensateurs sur les pneus pour véhicules de tourisme et utilitaires légers importés du Vietnam. Cependant, le dernier jour du mandat de l'ancien président Trump, l'USTR a déclaré que les pratiques monétaires du Vietnam étaient « déraisonnables », mais les États-Unis n'imposeraient pas de sanctions.
Depuis lors, l'administration Biden s'est abstenue de toute déclaration publique ou de toute action spécifique liée aux enquêtes précédentes menées sous Trump. Biden s'est plutôt concentré sur la réduction du déficit commercial et la promotion de l'intégration économique entre les deux pays, contribuant ainsi à la stabilité de leurs relations au cours des quatre dernières années.
Le Mexique est lui aussi confronté à une situation similaire, avec d'importants investissements chinois dans ses activités manufacturières, et se trouve dans le collimateur de Trump. En mars 2024, lors d'un discours devant les électeurs de l'Ohio, Trump a adressé un message à la Chine : « Les usines automobiles géantes que vous construisez au Mexique ne doivent pas s'attendre à pouvoir vendre leurs produits aux États-Unis sans embaucher des Américains. »
Peut-être cette déclaration doit-elle être comprise comme un avertissement adressé aux pays qui se trouvent dans des situations similaires.
Trump s'exprime lors d'un événement de campagne à Houston en novembre 2023. Photo : Michael Wyke / AP
Les mesures antidumping ont été fréquemment utilisées durant le premier mandat du président Trump. En 2018, le Département du Commerce des États-Unis a lancé 122 enquêtes et proposé des droits antidumping et compensateurs sur diverses importations. Ces mesures ont touché 31 pays et des importations de marchandises d'une valeur d'environ 12 milliards de dollars aux États-Unis.
Les administrations américaines précédentes, tant démocrates que républicaines, ont eu recours à des restrictions commerciales similaires. En 1990, l'administration Clinton a invoqué l'article 301 du Trade Act pour imposer des droits de douane sur les importations japonaises afin de remédier aux déséquilibres commerciaux et aux atteintes à la propriété intellectuelle. En 2002, l'administration Bush a invoqué l'article 201 pour imposer des droits de douane sur toutes les importations d'acier aux États-Unis afin de protéger l'industrie sidérurgique nationale. En 2009, l'administration Obama a imposé des droits de douane sur les pneus en provenance de Chine en vertu de l'article 421, également pour protéger les fabricants américains.
Toutefois, l'approche de l'administration Trump sera probablement plus agressive et globale, ciblant un éventail plus large d'importations et imposant des droits de douane plus élevés. À l'instar de l'administration Biden, s'il est réélu, Trump invoquera également des préoccupations de sécurité nationale pour justifier l'imposition de barrières commerciales, et le risque que le Vietnam soit affecté par ces politiques est très élevé.
Photo : Centre de l'OMC / VCCI
Comment le Vietnam doit-il se préparer ?
Pour faire face au paysage géopolitique complexe au cours des quatre prochaines années et assurer la croissance et la stabilité économiques, le Vietnam doit mettre en œuvre une stratégie de développement économique à multiples facettes, notamment la diversification des chaînes d’approvisionnement, le renforcement des relations commerciales régionales et la promotion de la production nationale.
Une étape importante consiste à diversifier sa chaîne d'approvisionnement, réduisant ainsi sa dépendance excessive aux biens et matières intermédiaires en provenance de Chine. Le Vietnam peut rechercher des sources alternatives de composants et de matières premières de haute technologie auprès de pays de la région comme la Corée du Sud, le Japon et l'Inde. Bien que ces pays ne soient pas en mesure de concurrencer la Chine en termes de coûts de production et de transport, la diversification des sources d'approvisionnement aidera le Vietnam à réduire les risques et à accroître sa résilience aux fluctuations du marché international, notamment lorsqu'il exporte vers le marché américain.
Par ailleurs, le Vietnam doit renforcer ses relations commerciales avec d'autres grandes économies telles que l'Inde, les pays de l'ASEAN et la Chine afin de réduire sa dépendance au marché américain et de diversifier ses exportations. L'élargissement de son marché aux économies dynamiques et en forte croissance de la région, comme l'Inde, offrira au Vietnam de nombreuses opportunités de coopération et d'investissement. Par exemple, l'Inde devrait devenir une puissance économique majeure en Asie à l'avenir, et la politique « Agir vers l'Est » du gouvernement indien favorisera une coopération accrue en matière de commerce et d'investissement entre les deux pays.
L'augmentation des investissements dans la production nationale de biens intermédiaires constitue une autre stratégie importante. Le développement des capacités de production nationales aidera le Vietnam à bâtir une base industrielle plus autonome, réduisant ainsi sa dépendance aux composants importés. Les efforts actuels du gouvernement pour encourager les IDE dans les secteurs de haute technologie tels que les semi-conducteurs et pour améliorer les compétences des travailleurs locaux vont dans la bonne direction pour atteindre cet objectif.
L'expérience régionale et la position unique du Vietnam
Le Vietnam pourrait peut-être s'inspirer des autres pays asiatiques pour savoir comment il a su exploiter ses bonnes relations personnelles avec Donald Trump afin de promouvoir ses intérêts nationaux. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'est lié d'amitié avec Trump pendant la période de transition entre son élection en 2016 et son investiture début 2017, puis a profité de l'appel de ce dernier à un plus grand partage des coûts de défense entre ses alliés en matière de sécurité pour accélérer le renforcement de sa puissance militaire. L'ancien président sud-coréen Moon Jae-in a utilisé les relations de Trump avec Kim Jong-un comme tremplin pour poursuivre une stratégie d'engagement avec la Corée du Nord.
Cependant, le Vietnam et les autres pays de la région Asie-Pacifique devraient noter que l'équipe de responsables du second mandat de Trump sera probablement complètement différente. Lors de son premier mandat, Trump avait fait appel à de nombreux décideurs expérimentés ayant servi sous les administrations des précédents présidents républicains. Cependant, comme le montrent les ouvrages sur le fonctionnement interne de la Maison-Blanche de Trump, de « Fire and Fury » de Michael Wolff à « Breaking History » de Jared Kushner, ils dressent un tableau chaotique, avec des personnels constamment remplacés après seulement un ou deux ans de service.
Cela signifie que les « vétérans de la politique » ont peu de chances de revenir. Trump pourrait abandonner les critères d'expérience et d'expertise lors du recrutement, privilégiant la loyauté lors de la sélection des membres de son cabinet et de son équipe de sécurité nationale. Une administration Trump composée de personnes lui étant absolument fidèles constituera un défi de taille pour les partenaires souhaitant négocier pour des bénéfices mutuels entre les deux pays, car ces personnes auront moins d'expérience politique et s'appuieront davantage sur les valeurs de « l'Amérique d'abord » et de « Trump d'abord » dans le dialogue bilatéral.
Cependant, le Vietnam doit également garder à l'esprit son avantage géostratégique, qui joue un rôle clé dans les négociations avec les États-Unis et continuera de le faire quelle que soit la victoire de M. Trump. La stratégie diplomatique équilibrée et autonome du Vietnam continuera de servir d'argument de négociation à Washington, encourageant toute administration présidentielle à maintenir la coopération et à renforcer le partenariat stratégique global entre les deux pays.
Enfin, un facteur important que le Vietnam devrait également prendre en compte est l'évolution des rapports de force en Asie-Pacifique. Durant le premier mandat de Trump, les États-Unis disposaient d'une influence considérable sur la Chine, qui demeurait la première puissance commerciale mondiale. Cependant, la Chine est devenue le principal partenaire commercial de la plupart des pays de la région, ce qui a permis à Pékin de renforcer son influence dans la politique américaine et d'asseoir sa position de force dans la région. Par conséquent, la nouvelle administration Trump sera confrontée à davantage de difficultés dans ses efforts pour imposer des restrictions commerciales à la Chine et à ses partenaires régionaux.
De plus, les politiques protectionnistes américaines contribuent à la hausse des prix sur le marché intérieur, surtout après des années où les consommateurs américains ont bénéficié de produits bon marché en provenance d'Asie en général, et de Chine en particulier. Les industries américaines conservent une influence forte à Washington, ce qui incite l'administration Biden à maintenir la position protectionniste de Trump. Cependant, cette situation pourrait évoluer dans les années à venir, la pression sur le marché de consommation américain continuant de s'accroître.
Des centaines de millions d'Américains sont-ils prêts à échanger des produits asiatiques bon marché et de haute qualité pour les intérêts politiques d'un petit groupe à Washington ? C'est peut-être la question la plus importante que nous devons observer du côté du Vietnam et de l'Asie pour déterminer les risques et les potentiels du commerce avec les États-Unis sous un second mandat de Donald Trump.































![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rend visite à la mère héroïque vietnamienne, Ta Thi Tran](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/20/765c0bd057dd44ad83ab89fe0255b783)



























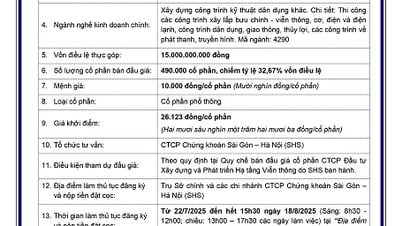








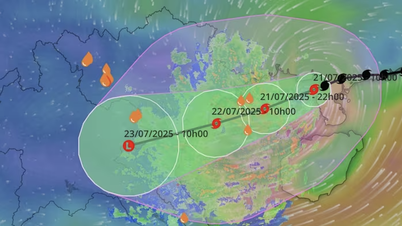





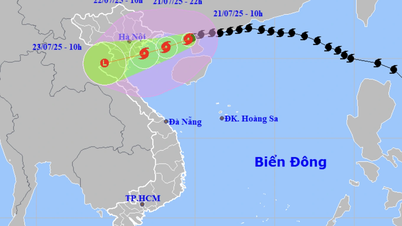



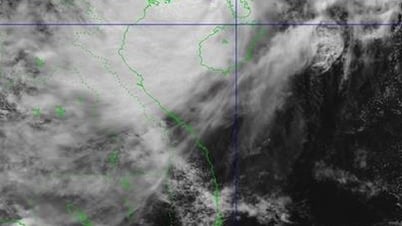

























Comment (0)