
Plus grave encore, certains endroits ont dû mobiliser des centaines d’officiers et de soldats pour protéger les barrages d’irrigation menacés d’effondrement.
Les lourdes pertes sont principalement dues à la subjectivité, fruit de l'expérience – qui faisait autrefois la force des habitants de la région centrale face aux catastrophes naturelles, mais qui est aujourd'hui devenue une routine qui entrave l'adaptation. Dans la tradition populaire, le cinquième mois lunaire est la « saison calme » : la tempête n'est pas encore arrivée, le soleil vient de se lever et la saison des récoltes est terminée. Des agriculteurs aux autorités locales, chacun pense que la période n'est pas inquiétante. Ainsi, lorsque la tempête arrive, on est surpris ou on la prend à la légère. Nombreux sont ceux qui travaillent encore aux champs sous la tempête, sans couvrir leurs granges ni mettre leurs bateaux à l'abri. Dans certains endroits, le plan de prévention des catastrophes naturelles vient d'être lancé alors que de fortes pluies s'abattent déjà.
Il est indéniable qu'il existe une certaine passivité et une certaine confusion dans la gestion de certaines localités, depuis les alertes jusqu'à la mise en œuvre de mesures de protection des digues, d'évacuation des populations et de protection de la production. Bien que rare, cette situation est lourde de conséquences. Et si nous n'y prêtons pas attention et ne nous adaptons pas à temps, les prochaines tempêtes, qu'elles soient de petite ou de grande ampleur, peuvent entraîner de lourdes pertes.
Après une tempête précoce comme la récente tempête n° 1, il faut prendre du recul : nous vivons une époque climatique inhabituelle. Contrairement à avant, le temps est aujourd'hui incertain : chaleur jusqu'à la fin de l'année, froid en plein été… et maintenant, la tempête arrive juste au moment où personne n'a le temps d'y penser.
Il n'existe plus de « saison sans danger ». Les règles autrefois considérées comme « standard », comme les typhons en juillet, les fortes pluies en août et les inondations en octobre, ne sont plus que des références au passé. Si la prévention des catastrophes repose encore sur l'ancien calendrier, si les instructions d'intervention dépendent encore des émotions et des habitudes administratives, nous serons certainement perdants, même dans les situations qui semblent les plus faciles à maîtriser.
S'adapter au changement climatique ne se résume donc pas à s'adapter aux conditions météorologiques, mais aussi à changer de mentalité, d'actions et de systèmes. L'agriculture doit également adopter un modèle intelligent, s'adapter au climat, utiliser des cultures à court terme, résistantes à la sécheresse, à la salinité et aux inondations, cultiver en fonction des prévisions météorologiques et réduire sa dépendance aux calendriers culturals traditionnels.
Un autre enjeu crucial est que l'adaptation au changement climatique doit être une réforme de la conscience de toute la société. Non seulement les citoyens, mais aussi les managers et les dirigeants à tous les niveaux doivent changer leur façon de penser, passant d'une attitude passive à une attitude proactive. Il est nécessaire d'instaurer une culture de la gestion des catastrophes naturelles, non pas par la résignation, mais par le courage, la connaissance et une préparation rigoureuse.
La tempête n° 1 n'est pas seulement un avertissement, elle met aussi clairement en évidence les lacunes de la réflexion et des mesures d'intervention actuelles. Si chaque citoyen considère encore les tempêtes comme une question de chance, si chaque gouvernement attend encore un « télégramme urgent » pour commencer à donner des instructions, alors nous devrons en payer le prix. Mais si nous savons nous préparer correctement et nous adapter proactivement, chaque saison peut être une saison sûre.
Source : https://nhandan.vn/thay-doi-nhan-thuc-thich-ung-bien-doi-khi-hau-post887142.html



































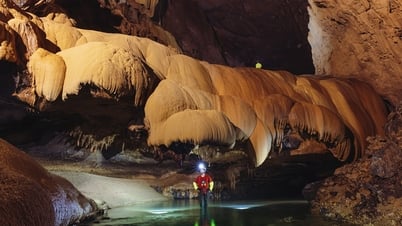

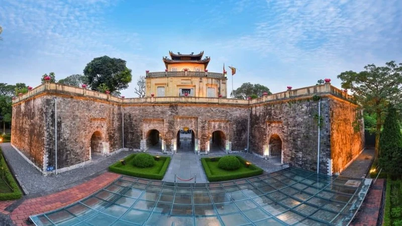




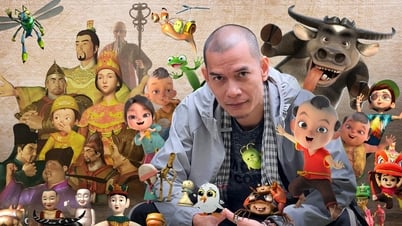














![[Nouvelles maritimes] Le Trésor cible divers réseaux facilitant le commerce du pétrole iranien](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/14/43150a0498234eeb8b127905d27f00b6)







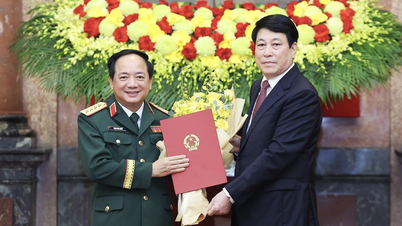




















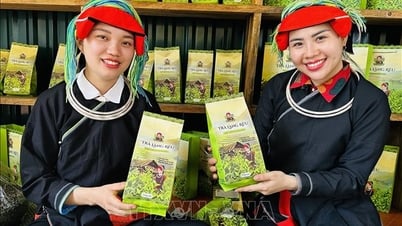









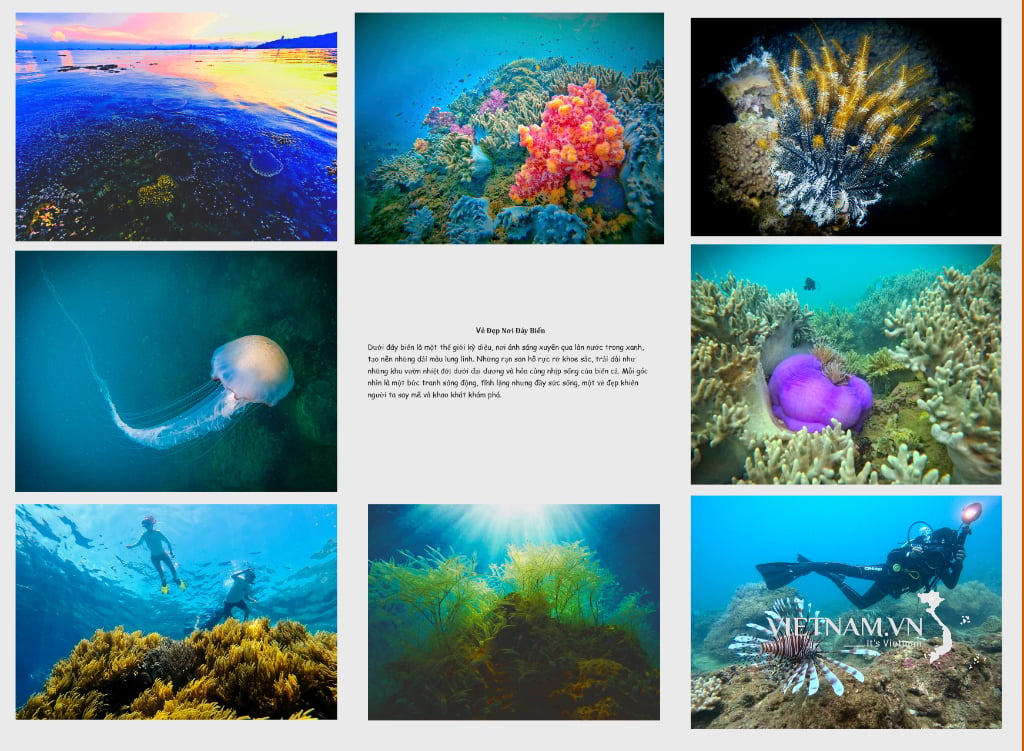


Comment (0)