Absences notables à La Haye : le président Zelensky et le problème de confiance de l'OTAN
L'absence du président ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet de l'OTAN prévu le 25 juin à La Haye est perçue comme un net revers dans les relations entre Kiev et ses partenaires occidentaux. C'est la première fois depuis 2022 que M. Zelensky n'est pas présent – virtuellement ou en personne – à un événement de l'OTAN d'un tel niveau.
Selon des médias occidentaux, cette décision a été largement motivée par la prudence de la Maison-Blanche. Le président Donald Trump étant sceptique à l'égard de l'OTAN et ayant souvent critiqué ses membres pour leur incapacité à assurer leur propre sécurité, la présence de Zelensky risque de devenir un sujet de discorde. Les membres de l'OTAN semblent s'accorder sur le fait qu'une invitation officielle pourrait exacerber les tensions au sein de l'alliance et révéler des divergences stratégiques non résolues.
Si Kiev peut encore être représentée au niveau ministériel et participer à des événements publics en marge du sommet, l'absence du président Zelensky à une session formelle du Conseil OTAN-Ukraine a montré les limites actuelles des relations entre les deux parties.
Plus important encore, cette absence intervient alors qu'un nombre croissant d'États membres de l'OTAN expriment leur prudence, voire leur opposition ouverte, à l'adhésion prochaine de l'Ukraine à l'alliance. Selon Izvestia, le ministre polonais de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, a récemment déclaré sans ambages que l'Ukraine ne serait pas invitée à rejoindre l'OTAN dans les années à venir. La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a également exprimé sa désapprobation quant à la perspective d'une adhésion pleine et entière de Kiev. Par ailleurs, des signaux similaires sont envoyés par plusieurs autres États membres, bien qu'à un niveau informel.
Le choix de l’OTAN de déclasser la représentation de l’Ukraine tout en évitant de prendre des engagements spécifiques sur son adhésion reflète une réalité politique complexe : alors que l’Occident continue de soutenir Kiev militairement et financièrement, l’étendue de l’engagement stratégique à long terme des deux parties devient un sujet de débat interne, et le président Zelensky, autrefois symbole d’unité, est désormais un facteur sensible dans ces calculs.
Adhésion à l'UE : le rêve de l'Ukraine au milieu des troubles politiques
Dans le contexte du conflit persistant avec la Russie, la candidature de l'Ukraine à l'UE suscite des réactions mitigées de la part de ses propres États membres. Si certains pays, comme l'Estonie, la Pologne, le Portugal, la Suède, les Pays-Bas et l'Espagne, ont exprimé un soutien vigoureux à l'adhésion de Kiev, on observe également une vague de scepticisme et d'opposition de la part d'autres pays, notamment l'Allemagne, la Bulgarie et la République tchèque.
Les préoccupations dominantes de l'opinion publique européenne tournent autour de deux facteurs principaux : la sécurité de l'Ukraine et sa capacité à s'intégrer véritablement. Pour beaucoup en Allemagne, en Italie, en Grèce et en Espagne, l'entrée de l'Ukraine dans l'UE en temps de guerre est perçue comme un risque géopolitique susceptible d'entraîner le bloc dans une confrontation directe avec la Russie. Par conséquent, ils s'opposent à l'augmentation des dépenses de défense, condition quasi obligatoire à l'élargissement de l'UE à un pays en guerre.
Outre les préoccupations sécuritaires, un autre problème interne continue de freiner Kiev : la corruption. Selon des sondages menés en Allemagne, en Bulgarie et en République tchèque, une majorité de personnes estiment que l’Ukraine ne pourra adhérer à l’UE que dans plus de cinq ans, voire jamais. Elles estiment que le niveau actuel de corruption en Ukraine est trop élevé et que les réformes nécessaires pour se conformer aux normes européennes seront longues et exigeront un effort politique soutenu de la part du gouvernement de Kiev, ce qui est peu probable en temps de guerre.
La réticence de certains États membres de l'UE ne reflète pas seulement l'opinion publique interne, mais témoigne également de la prudence de l'Union dans sa stratégie d'élargissement. L'admission d'un pays en situation de conflit exige que l'Union soit prête à assumer la responsabilité de la sécurité, de la reconstruction et de la stabilité économique de l'un des plus grands pays d'Europe de l'Est.
Face à ces obstacles, le chemin de l'Ukraine vers l'adhésion à l'UE reste semé d'embûches, malgré le soutien politique de certains dirigeants européens. Cette réalité reflète un paradoxe : si l'Occident soutient publiquement l'Ukraine dans sa lutte pour la défense de sa souveraineté, lorsqu'il s'agit d'une intégration institutionnelle profonde comme l'UE ou l'OTAN, les considérations stratégiques et les réalités géopolitiques ne peuvent être ignorées.
Changements à Washington, défis à Kiev : relations personnelles et destin national
L'une des principales raisons du récent changement d'attitude de l'Occident envers l'Ukraine réside dans les relations difficiles entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump. Si M. Zelensky avait établi des liens assez étroits avec l'administration précédente du président Joe Biden, ses relations avec M. Trump n'ont pas connu la même dynamique positive.
Au début de sa présidence, Trump s'est présenté comme un dirigeant imprévisible et franc, peu respectueux des protocoles diplomatiques conventionnels. Il a donc été plus difficile pour Zelensky de nouer des relations personnelles, élément clé de la politique étrangère ukrainienne. De plus, Zelensky a été entraîné par inadvertance dans des controverses politiques intérieures aux États-Unis, notamment l'enquête sur les liens du président Trump avec la Russie, auparavant menée par les démocrates, ce qui a encore compliqué les relations entre les deux dirigeants.
Selon certains médias occidentaux, depuis le retour du président Trump sur la scène politique américaine, M. Zelensky s'est activement employé à améliorer les relations, accusant même l'administration Biden de retarder les décisions et de ne pas apporter un soutien adéquat à l'Ukraine. Cependant, ces efforts ne semblent pas avoir produit de résultats significatifs. Le président Trump a non seulement semblé peu impressionné, mais a également continué d'exprimer son scepticisme quant au maintien du soutien militaire et financier à Kiev.
La relation fracturée ou déconnectée entre les présidents Zelensky et Trump, sur fond de manque de confiance des pays européens, est devenue un risque stratégique pour l'Ukraine. De fait, au cours des 100 premiers jours du mandat de Trump, Kiev a été confrontée à un contexte politique radicalement différent, où les principes d'aide, les engagements en matière de sécurité et le soutien financier sont réexaminés sous l'angle de la priorité donnée aux intérêts américains.
« Est-il temps de discuter ? » – L’évolution de l’attitude de l’Europe envers l’Ukraine
Le soutien autrefois solide dont bénéficiait l'Ukraine auprès des pays européens semble s'affaiblir, non seulement parmi les responsables politiques, mais aussi dans l'opinion publique. Au cours de l'année écoulée, le slogan « Soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire » a perdu de son importance. Une enquête menée en décembre 2024 dans sept pays européens – la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suède, le Danemark et le Royaume-Uni – a révélé une baisse significative du soutien à Kiev.
Même dans les pays considérés comme les plus « pro-ukrainiens », comme la Suède, le Danemark et le Royaume-Uni, selon Izvestia, le soutien a chuté en moyenne de 14 %. Parallèlement, dans des pays comme l'Italie, plus de la moitié des personnes interrogées se sont déclarées favorables à une solution de paix négociée, plutôt qu'à un soutien militaire continu.
Selon une étude du Conseil européen des relations étrangères (ECFR), l'écart se creuse entre les opinions des dirigeants européens et l'opinion publique. En Grèce, en Bulgarie et en Italie, où la lassitude à l'égard de la guerre s'accroît, une majorité de citoyens s'opposent à la poursuite des livraisons d'armes et de munitions à Kiev. Parallèlement, ils sont sceptiques quant à la capacité de l'Ukraine à remporter une victoire militaire dans un avenir proche.
La polarisation de l'opinion publique est manifeste dans des pays comme la République tchèque, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse, où la population est divisée entre un soutien continu à l'Ukraine et une volonté de faire avancer les négociations de paix. Notamment, la position conflictuelle constante du président Volodymyr Zelensky, saluée au début du conflit, commence à devenir un sujet de discorde. Pour beaucoup, l'accent persistant mis par Kiev sur la victoire totale, au détriment d'une solution diplomatique, est perçu comme irréaliste et risque de prolonger les souffrances des deux camps.
Cette situation pose un problème complexe aux gouvernements européens : comment concilier leur engagement politique envers l’Ukraine avec le désir de plus en plus manifeste de leur population d’une solution pacifique ? Face à l’augmentation des coûts de la guerre et à l’aggravation des pressions économiques intérieures, l’évolution de l’opinion publique pourrait avoir un impact direct sur la politique étrangère européenne dans les années à venir.
Hung Anh (Contributeur)
Source : https://baothanhhoa.vn/tin-hieu-lanh-lung-tu-phuong-tay-ukraine-co-dang-danh-mat-dong-minh-249339.htm




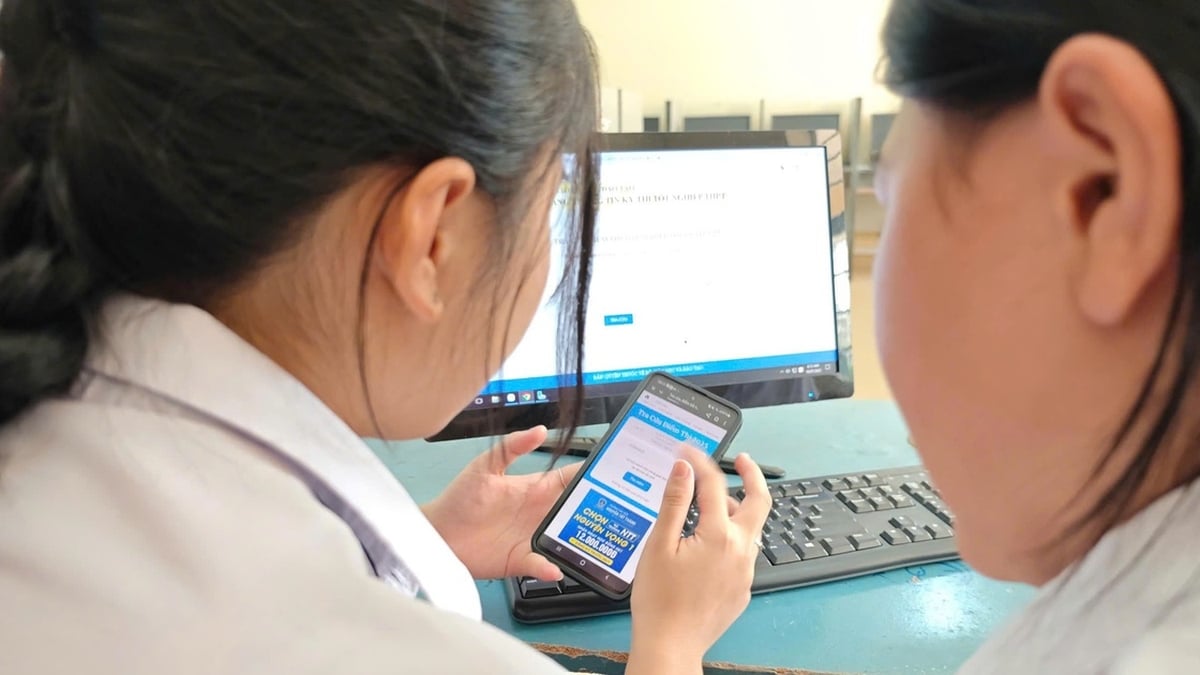







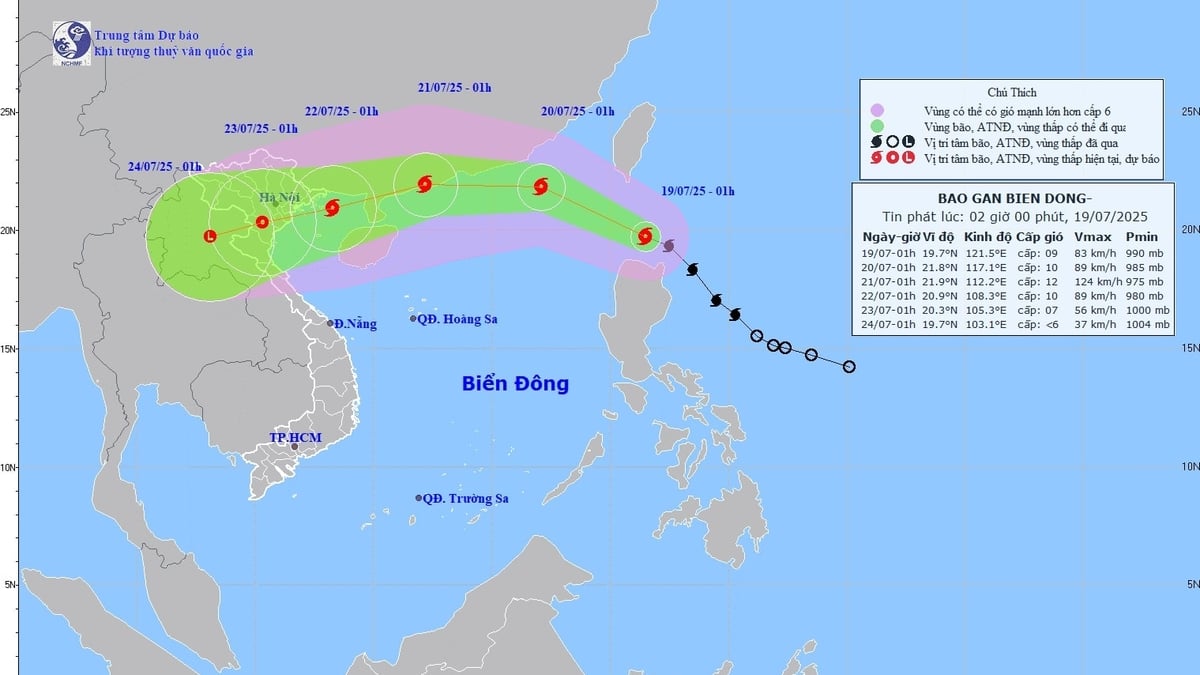























































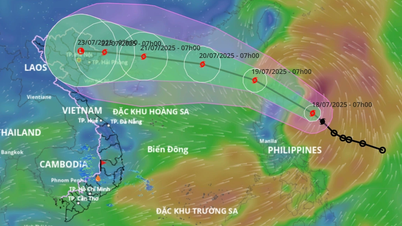



























![[Infographie] En 2025, 47 produits obtiendront l'OCOP national](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)





Comment (0)