Journaliste (PV) : Pourriez-vous nous parler un peu des impacts récents du changement climatique sur Ninh Binh ainsi que des tendances de ces impacts à l'avenir ?
Camarade Nguyen Tien Dung : Le changement climatique est l’un des plus grands défis auxquels l’humanité est confrontée aujourd’hui, en raison de sa complexité et de son impact croissant à l’échelle mondiale. On peut affirmer que le changement climatique a eu, a et aura un impact sur presque tous les aspects de la vie sociale.
Pour la province de Ninh Binh, le changement climatique a eu ces dernières années de multiples impacts notables. L'augmentation des températures mondiales a entraîné une élévation du niveau de la mer, affectant considérablement les zones côtières et les principaux cours d'eau de Ninh Binh, tels que le Gia Vien, le Kim Son et le Nho Quan. L'intrusion d'eau salée s'est aggravée au cours des dix dernières années, pénétrant plus profondément et persistant plus longtemps. Dans la zone côtière du Kim Son, l'eau salée a atteint une profondeur de 20 à 30 km à l'embouchure du fleuve Day et de 10 à 15 km à l'embouchure du fleuve Vac.
D'après les statistiques de 2010 à nos jours, la plupart des localités de la province ont subi des sécheresses durant la période d'irrigation du riz en hiver et au printemps, notamment dans les districts de Nho Quan et Gia Vien, ainsi que dans la ville de Tam Diep. La superficie touchée par la sécheresse et le manque d'eau représente en moyenne 15 à 20 % des surfaces cultivées. Par ailleurs, la province de Ninh Binh est fréquemment sujette à des phénomènes météorologiques extrêmes tels que des vagues de chaleur intenses et prolongées ou des épisodes de grêle.
Il est évident que le changement climatique peut entraîner des modifications des régimes de précipitations et du volume d'eau, perturbant ainsi le système d'irrigation de Ninh Binh. Ces changements de précipitations et de saisons des pluies peuvent accroître le risque d'inondations ou de sécheresses, rendant difficile la gestion et l'utilisation des ressources en eau dans la région. À titre d'exemple, au cours des 30 dernières années, les communes situées dans les zones de dérivation et d'évacuation des eaux de crue des districts de Nho Quan et Gia Vien ont subi 15 inondations, la zone située à droite de Hoang Long 10 fois, et les communes situées hors des digues sont inondées chaque année, ce qui affecte considérablement la vie économique des populations locales.
De plus, le changement climatique affecte les écosystèmes, la faune et la flore ; il a un impact négatif sur la production agricole ; il affecte les ressources en eau ; il affecte les écosystèmes forestiers ; il a un impact sur les ressources foncières… L’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes a également un impact certain sur les activités touristiques et les festivals, notamment en début d’année…
PV : Monsieur, face à l’évolution de plus en plus complexe du changement climatique, quelles solutions spécifiques la province de Ninh Binh a-t-elle dû mettre en œuvre ?
M. Nguyen Tien Dung : Ces derniers temps, la province a mis en œuvre plusieurs solutions concrètes pour minimiser les impacts et renforcer sa résilience. Sous l'égide de ses dirigeants et responsables, à tous les niveaux, dans tous les secteurs et toutes les localités, la lutte contre le changement climatique a été mobilisée. Les unités placées sous leur autorité ont été chargées de renforcer la coordination afin d'intégrer les actions de lutte contre le changement climatique dans leurs activités de gestion spécialisées. Des solutions proactives ont été élaborées pour prévenir, éviter et atténuer les catastrophes naturelles et s'adapter au changement climatique. Des plans et des mesures ont été mis en place pour prévenir, éviter et atténuer les catastrophes naturelles, et pour gérer de manière proactive les scénarios les plus pessimistes susceptibles d'affecter la production, la vie des populations et la sécurité nationale.
Les efforts de sensibilisation, de diffusion d'informations, d'éducation juridique et de renforcement du sens des responsabilités en matière de protection de l'environnement, de prévention des catastrophes naturelles et de lutte contre le changement climatique ont été intensifiés. Les districts et les villes ont revu, complété et ajusté leurs plans de développement sectoriel, agricole et socio-économique. Ils ont activement mis en œuvre des projets et des actions visant à s'adapter proactivement au changement climatique dans les zones côtières et à prévenir les catastrophes naturelles dans les zones montagneuses, notamment : la plantation de mangroves pour protéger le littoral de l'érosion ; la construction d'un système de digues, de remblais et de ponceaux, ainsi que d'un système de surveillance et d'alerte aux crues soudaines et aux glissements de terrain ; et la planification et la construction de centrales électriques flexibles utilisant du gaz liquéfié, l'énergie éolienne, la valorisation énergétique des déchets, etc.
La province s'est également attachée à protéger et à restaurer les ressources en eau, notamment en maintenant l'équilibre des réservoirs, en contrôlant la pollution de l'eau et en construisant des systèmes de collecte et de stockage des eaux pluviales. De plus, elle a promu la protection et la restauration des forêts et limité la déforestation illégale. Parallèlement, elle a mis en œuvre des programmes de formation, d'accompagnement et de soutien pour renforcer la résilience des agriculteurs face aux changements climatiques, notamment en leur fournissant des connaissances sur les méthodes agricoles durables, l'utilisation efficace de l'eau et l'application des technologies à la production agricole, la protection de l'environnement et l'adaptation aux changements climatiques. Elle a également investi dans la mise en place d'un système de surveillance, d'alerte et d'intervention pour les incidents et les catastrophes liés aux changements climatiques, tels que les inondations et les sécheresses, afin de permettre une alerte précoce et une intervention efficace pour minimiser les pertes et les risques pour la collectivité.
Par ailleurs, afin de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, la province encourage le recours à des énergies telles que l'énergie solaire et éolienne, contribuant ainsi à réduire la dépendance aux énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. Elle mène activement des recherches, sélectionne et introduit de nouvelles variétés végétales et animales adaptées à son environnement naturel ; elle adapte la structure des espèces végétales et animales ; elle applique des technologies de pointe en matière de production, privilégie des procédés biologiques et s'oriente vers une agriculture biologique afin d'accroître la productivité et de préserver les ressources ; enfin, elle recense et évalue les principales sources d'émissions de la région.

PV : Beaucoup pensent que la participation de la communauté est primordiale et qu’il faut privilégier les savoirs autochtones pour trouver des solutions d’adaptation aux changements climatiques. Quel est votre avis sur ce sujet ?
M. Nguyen Tien Dung : Il est vrai que la participation communautaire et l’utilisation des savoirs autochtones sont essentielles pour lutter contre les changements climatiques. La participation communautaire permet de garantir que les solutions soient adaptées aux besoins et aux situations spécifiques de chaque localité, et favorise l’engagement et le consensus dans la mise en œuvre des mesures d’intervention. L’utilisation des savoirs autochtones est un facteur important dans l’élaboration de solutions d’adaptation aux changements climatiques. Chaque zone géographique présente ses propres caractéristiques et des problématiques différentes liées aux changements climatiques.
Le recours aux savoirs autochtones permet de mieux comprendre les impacts spécifiques et les solutions adaptées à chaque zone géographique. De plus, il favorise l'adhésion et l'acceptation des communautés locales.
Chaque communauté et région possède une diversité de cultures, de savoirs et de technologies. L'utilisation et la combinaison de ces ressources pour lutter contre les changements climatiques renforcent la résilience et la créativité dans la recherche de solutions efficaces. Se fier uniquement à des solutions externes, sans exploiter le potentiel interne de la communauté et de la région, risque de rendre difficile la mise en œuvre et la pérennisation des réponses.
En résumé, la participation communautaire et le recours aux connaissances autochtones contribuent à garantir la durabilité et l’efficacité des mesures d’intervention et à créer un consensus et un engagement en faveur de l’atténuation des impacts des changements climatiques.
Journaliste : On peut affirmer que les changements climatiques et la montée du niveau de la mer sont des phénomènes inévitables auxquels nous devons nous adapter. Monsieur, en tant qu’organisme permanent chargé de fournir des conseils dans ce domaine, comment le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement continuera-t-il à conseiller et à planifier des actions pour répondre à ce problème ?
M. Nguyen Tien Dung : En tant qu’organisme permanent chargé du conseil en matière de changement climatique, le Département des ressources naturelles et de l’environnement de Ninh Binh continuera de conseiller la province afin d’orienter et de renforcer la coordination, et d’exhorter les départements et services à mettre en œuvre efficacement le Plan d’action de lutte contre le changement climatique approuvé par le Comité populaire provincial pour la période 2021-2030, avec une perspective à l’horizon 2050. Parallèlement, il conseillera au Comité populaire provincial d’évaluer les résultats de la mise en œuvre de ce plan d’action pour la période en cours et d’élaborer et de mettre à jour des scénarios de changement climatique pour la province de Ninh Binh, sur la base des scénarios les plus récents concernant le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer publiés par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement.
L'objectif principal est d'enquêter, de réaliser des études, d'établir des statistiques et un inventaire des gaz à effet de serre, de recenser les installations émettrices et de mettre en œuvre des actions pour réduire ces émissions dans la province. Il s'agit également de renforcer la résilience, notamment en investissant dans les infrastructures de prévention des inondations, en consolidant les systèmes d'alerte aux inondations, en protégeant la biodiversité et les mangroves, et en développant des solutions d'adaptation pour l'agriculture, les transports, les zones urbaines, le tourisme et d'autres secteurs. La protection et la restauration des écosystèmes, tels que les forêts, les aires de conservation de la biodiversité et les réserves de biosphère, sont essentielles pour minimiser l'impact des changements climatiques et de la montée du niveau de la mer. Enfin, il est crucial de mener des actions de sensibilisation et d'encourager la mobilisation de la population afin de réduire cet impact.
Parallèlement, il est nécessaire de renforcer et de mobiliser les ressources d'investissement pour lutter contre le changement climatique ; de privilégier les investissements dans la recherche et l'application des sciences et des technologies pour y faire face, en veillant à la bonne réalisation des tâches scientifiques et technologiques ; de donner la priorité aux activités de lutte contre le changement climatique, aux actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'adaptation au changement climatique, à la protection de l'environnement et à l'atténuation des catastrophes naturelles…
PV : Merci beaucoup, camarade !
Chanson Nguyen (interprétée)
Source




![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le président de l'Agence de presse latino-américaine de Cuba](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F01%2F1764569497815_dsc-2890-jpg.webp&w=3840&q=75)




























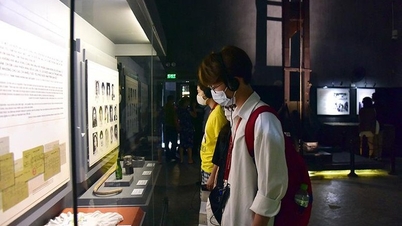






























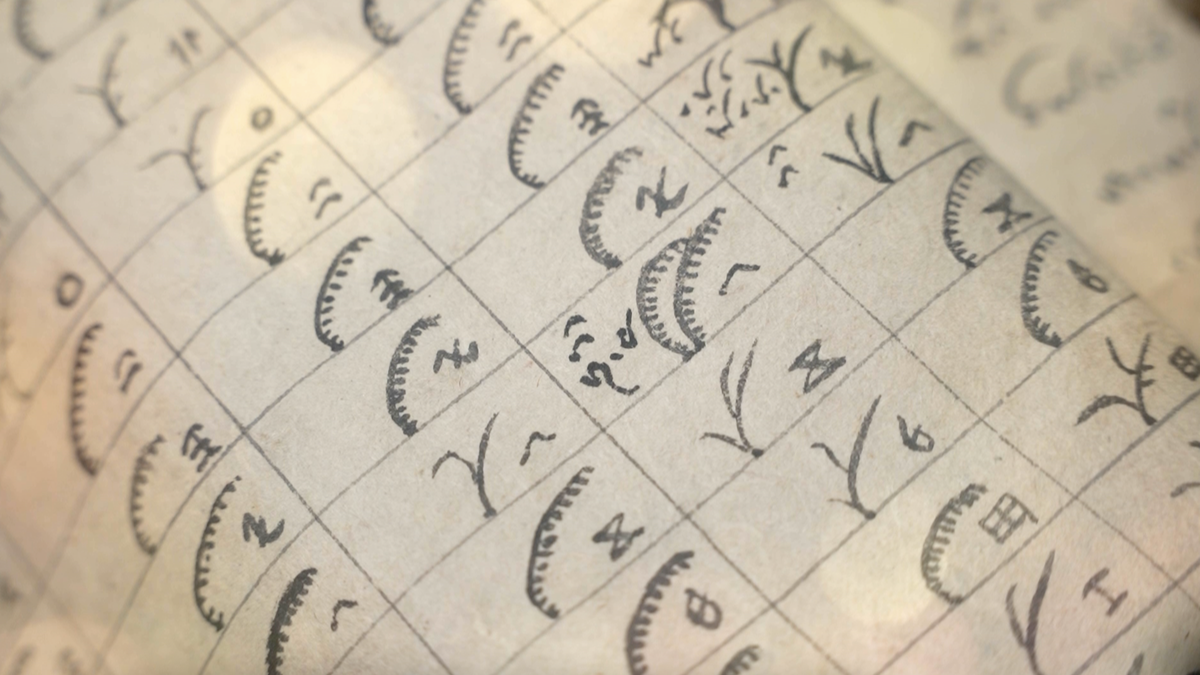












































Comment (0)