Combat inégal…
Lorsque Randy Conrads a lancé Classmate.com, le tout premier réseau social, en novembre 1995, il était loin d'imaginer à quel point sa création allait bouleverser le monde . Un an après la naissance de Classmate.com, Andrew Weinreich, un entrepreneur américain, présentait SixDegrees.com au grand public. Ce site fut l'un des premiers réseaux sociaux généralistes à connaître un large succès et servit de modèle au monde de la technologie pour le lancement d'autres réseaux sociaux à succès basés sur le modèle des « cercles sociaux », tels que Friendster, MySpace, LinkedIn, XING et surtout Facebook.
Facebook et de nombreux autres réseaux sociaux ont vu le jour par la suite, tels qu'Instagram, Twitter ou les plateformes de partage de vidéos comme YouTube et TikTok. Ces dernières se sont rapidement développées, offrant aux utilisateurs un contenu extrêmement riche, rapide et facilement accessible. Les lecteurs et le public se sont progressivement habitués à ces plateformes en ligne et ont délaissé les médias traditionnels, plongeant la presse mondiale dans une crise profonde, puis dans un étouffement.

Obliger les plateformes technologiques comme Google à partager les bénéfices tirés de l'utilisation des contenus d'actualité est une nouvelle tendance visant à aider les journaux à accroître leurs revenus et à fidéliser leurs lecteurs. Photo : Getty
La bataille devient de plus en plus inégale à l'échelle mondiale, et même les plus puissants groupes de médias en souffrent. Par exemple, en 2020, le géant des médias News Corp a dû cesser d'imprimer plus de 100 journaux locaux et régionaux, soit l'équivalent des deux tiers des titres de presse détenus par cette entreprise valant des milliards de dollars .
Au Vietnam, il est difficile de compter le nombre de journaux, notamment de la presse écrite, qui ont dû fermer leurs portes ou survivre de justesse face à la domination des réseaux sociaux. Ces derniers ont capté la quasi-totalité de leurs lecteurs et, bien entendu, leurs revenus se sont volatilisés . Sans compter que même les rédactions ayant survécu à cette invasion ont dû se transformer et s'adapter à leurs concurrents.
Par exemple, les méthodes traditionnelles de reportage ont dû évoluer, la rapidité et le multimédia étant devenus les priorités absolues. Cette évolution a également entraîné une transformation du modèle organisationnel des rédactions. Un siège social imposant n'est peut-être plus indispensable. L'an dernier, Reach, propriétaire de grands quotidiens britanniques tels que le Mirror, l'Express et le Star, prévoyait de fermer la plupart de ses rédactions afin que ses employés puissent travailler à distance, depuis leur domicile ou sur des ordinateurs portables dans des cafés.
On peut qualifier cette situation d’adaptation à l’époque. Mais il n’est pas faux non plus d’affirmer, comme l’a déclaré le journaliste Chris Blackhurst, ancien rédacteur en chef de The Independent (Royaume-Uni), « c’est la mort des rédactions » .
Mais dans la vie, tout excès nuit en tout. La croissance fulgurante des réseaux sociaux a également mis en lumière les aspects négatifs de ces plateformes : la désinformation prolifère faute de contrôle, les données des utilisateurs sont compromises et des milliards de dollars de recettes fiscales que les gouvernements auraient pu percevoir auprès des journaux sont perdus.
Mission impossible
Par conséquent, les législateurs du monde entier ont récemment pris conscience de la nécessité de réglementer les réseaux sociaux et les plateformes technologiques. À ce jour, la campagne visant à contrôler les réseaux sociaux a enregistré des succès encourageants dans de nombreux pays et sur de nombreux fronts.
En mars 2021, l'Australie a annoncé la loi « Digital Platforms and News Media Bargaining Act » , qui oblige les entreprises technologiques propriétaires de réseaux sociaux et de plateformes de partage d'informations telles que Facebook et Google à négocier avec les éditeurs une rémunération lorsqu'elles partagent des informations provenant de la presse.
La loi australienne vise à compenser la perte de recettes publicitaires des médias d'information traditionnels au profit des géants du numérique. On estime qu'en Australie, en moyenne, sur 100 dollars australiens dépensés en publicité en ligne, 53 dollars vont à Google, 28 à Facebook et 19 aux autres.

De nombreuses informations que la presse a obtenues au prix d'efforts et d'argent sont utilisées gratuitement par les réseaux sociaux pour générer des profits et détourner des lecteurs de la presse écrite. Photo : GI
La perte de revenus publicitaires a été partiellement compensée par les abonnements, mais pas suffisamment pour empêcher la faillite et la fermeture des médias. Parallèlement, Google et Facebook ont enregistré d'excellentes performances. En 2019, l'année précédant l'entrée en vigueur de la loi australienne, Google a généré 4,3 milliards de dollars de revenus publicitaires en Australie, tandis que Facebook en a réalisé 700 millions, selon les documents déposés auprès de l'ASIC (Australian Securities and Investments Commission).
Après l'Australie, également en 2021, c'est au tour de l'Union européenne (UE) d'annoncer la « Directive sur le droit d'auteur numérique » avec une série de mesures spéciales visant à créer un marché plus équitable pour la presse, obligeant les fournisseurs de services de partage de contenu en ligne à verser une rémunération à la presse en général et aux journalistes qui créent du contenu d'actualité en particulier.
Les initiatives prises par l'Australie et l'Union européenne ont incité d'autres pays à suivre leur exemple. Désormais, des législateurs au Brésil, en Inde, en Indonésie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et dans d'autres pays encore mettent en œuvre des politiques visant à obliger les géants du numérique à rémunérer les informations qu'ils recueillent auprès des journaux.
Aux États-Unis, un projet de loi intitulé « Journalism Competition and Preservation Act » (JCPA) bénéficie également d'un soutien bipartisan. Ce texte vise à donner aux éditeurs et diffuseurs de presse un pouvoir accru de négociation collective avec les entreprises de médias sociaux, telles que Facebook, Google ou Twitter, afin d'obtenir une part plus importante des revenus publicitaires.
Non seulement les gouvernements, mais aussi les entreprises de presse elles-mêmes sont déterminées à lutter contre les géants de la technologie. Dernier exemple en date : le New York Times vient de conclure un accord de 100 millions de dollars avec Alphabet pour fournir des informations à Google pendant trois ans.
TikTok a également annoncé récemment le lancement d'un produit permettant aux annonceurs de diffuser des publicités à côté de contenus provenant de médias d'information de premier plan. La moitié des revenus publicitaires générés par la plateforme serait reversée à ces médias.
Obliger les réseaux sociaux et les plateformes de partage d'informations à rémunérer les journaux pour les articles et contenus qu'ils reprennent représente un grand espoir de survie et de développement pour la presse écrite. C'est également un moyen concret et direct pour les journaux traditionnels de reconquérir leurs lecteurs délaissés par les réseaux sociaux.
Nguyen Khanh
Source










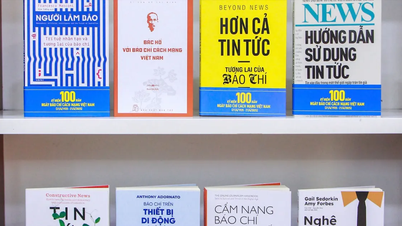



























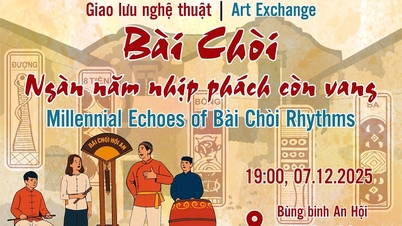







































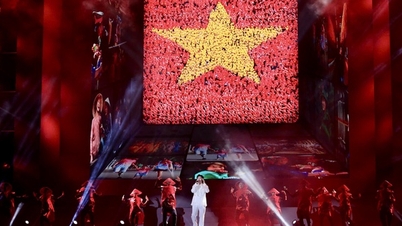




























Comment (0)