Les poissons-poumons existent sur Terre depuis 390 millions d'années et ont développé un mécanisme d'hibernation spécial pour survivre aux périodes de chaleur et de sécheresse prolongées.

Le dipneuste peut survivre quatre ans sans manger ni boire. Photo : Futurism
Les ondulations à la surface du fleuve Bandama, en Côte d'Ivoire, proviennent d'une créature tachetée qui s'élève pour respirer plutôt que pour attraper des insectes. Il s'agit d'un dipneuste d'Afrique de l'Ouest, mais il existe trois autres espèces de dipneustes réparties en Afrique, selon The Oxford Scientist .
Long d'un mètre, ressemblant à une anguille, avec une peau tachetée contrastant avec des écailles brun olive, le dipneuste vit à la frontière entre la vie aquatique et la vie terrestre. Doté de deux poumons, il doit fréquemment remonter à la surface pour s'oxygéner, car ses branchies n'en fournissent pas suffisamment. Contrairement à la plupart des poissons, le dipneuste peut survivre à l'assèchement des rivières pendant la saison sèche.
Alors que d'autres poissons se réfugient dans des étangs exigus ou migrent, les dipneustes africains s'enfouissent dans les lits de rivières asséchés. Là, ils enferment leur corps dans des cocons visqueux, ne laissant qu'une ouverture pour leur bouche, ce qui leur permet de respirer et de survivre sans eau ni nourriture pendant des mois, voire jusqu'à quatre ans. C'est ce qu'on appelle l'hibernation : les animaux entrent alors dans un état d'inactivité physique et métabolique pour survivre aux conditions chaudes et sèches.
L'hibernation est une pratique courante chez les animaux tropicaux. Des naturalistes victoriens ont réussi à expédier des dipneustes africains à l'autre bout du monde, en Angleterre et en Amérique, afin d'observer leur physiologie. Depuis, les progrès technologiques ont permis de révéler les processus cellulaires et génétiques à l'origine de l'hibernation des dipneustes. Dépourvus de pattes pour se déplacer sur terre et capables d'être isolés des autres environnements lorsque l'eau s'assèche, les dipneustes africains ont évolué pour rester en sommeil dans la vase jusqu'au retour de l'eau.
L'induction, première étape de l'hibernation, prépare le terrain pour les prochains mois sous terre. En 1986, des chercheurs ont montré que plusieurs signaux déclenchant l'hibernation incluent la déshydratation, la faim, une respiration plus aérée et le stress. De plus, des variations de salinité et de composition des composés dissous (comme le calcium et le magnésium) dans l'eau environnante signalent l'assèchement de la rivière. Il est possible que les branchies jouent un rôle dans la détection de la quantité d'eau dans le corps du poisson.
Voyant les signes d'un environnement qui se réchauffe et s'assèche, les dipneustes s'enfouissent dans la vase à l'aide de leur bouche et de leur corps musclé. Ils se réfugient ensuite dans leur terrier, recroquevillant leur long corps et se recouvrant d'une épaisse couche de mucus sécrété. Une fois durci, le mucus forme un cocon imperméable, dont seule une étroite ouverture vers la surface permet au poisson de respirer par les poumons.
L'analyse génétique a révélé une augmentation des niveaux de signalisation hormonale dans le cerveau due à une activité génétique accrue. L'arrêt métabolique se produit pendant la phase d'entretien, dès que le cocon de mucus s'assèche. L'absorption d'oxygène se fait exclusivement par les poumons, et la consommation d'oxygène est réduite de moitié par rapport aux dipneustes actifs dans l'eau. Ces changements s'accompagnent d'une forte diminution de l'activité métabolique, d'une fréquence cardiaque qui chute à 2 battements par minute (contre 25 battements par minute en temps normal) et d'un arrêt de la production d'ammoniac. De nombreux systèmes corporels subissent des modifications, notamment les intestins, les reins et le cœur, reflétant une fonction réduite pendant l'hibernation. Les réserves internes constituent la seule source d'énergie des dipneustes.
Le grand nombre de granulocytes (globules blancs essentiels au système immunitaire) qui s'accumulent dans les intestins, les reins et les gonades des dipneustes pendant la saison des pluies joue également un rôle dans leur rémission estivale. Une étude de 2021 publiée dans Science a révélé que les sacs muqueux sont remplis de granulocytes. Ils empêchent les agents pathogènes d'atteindre les dipneustes en hibernation. Les granulocytes migrent de leurs sites de stockage dans les viscères, via la circulation sanguine, vers la peau, entrant dans un état inflammatoire avant de terminer leur parcours dans le sac. Là, les granulocytes créent des pièges extracellulaires qui empêchent les bactéries d'atteindre les dipneustes en hibernation, rendant ainsi les sacs immunisés.
Finalement, l'eau revient et le dipneuste est sorti de son hibernation lorsque sa bouche, seule partie de son corps non recouverte par le cocon de mucus, se remplit d'eau. Cela déclenche la phase d'éveil de l'hibernation, la plus mystérieuse des trois. Sortant péniblement du cocon et remontant lentement à la surface, le dipneuste excrète les déchets accumulés pendant son hibernation. Après environ 10 jours, période pendant laquelle ses organes internes se régénèrent, le dipneuste recommence à se nourrir.
Le dipneuste africain est resté pratiquement inchangé depuis 390 millions d'années, avec des fossiles de dipneustes fouisseurs datant du Dévonien. Cependant, il est menacé par l'activité humaine. Par exemple, le dipneuste marbré a connu un déclin de 11 % dans le bassin du lac Victoria en seulement cinq ans, la surpêche et l'agriculture ayant entraîné la dégradation et la perte des zones humides.
An Khang (selon The Oxford Scientist )
Lien source


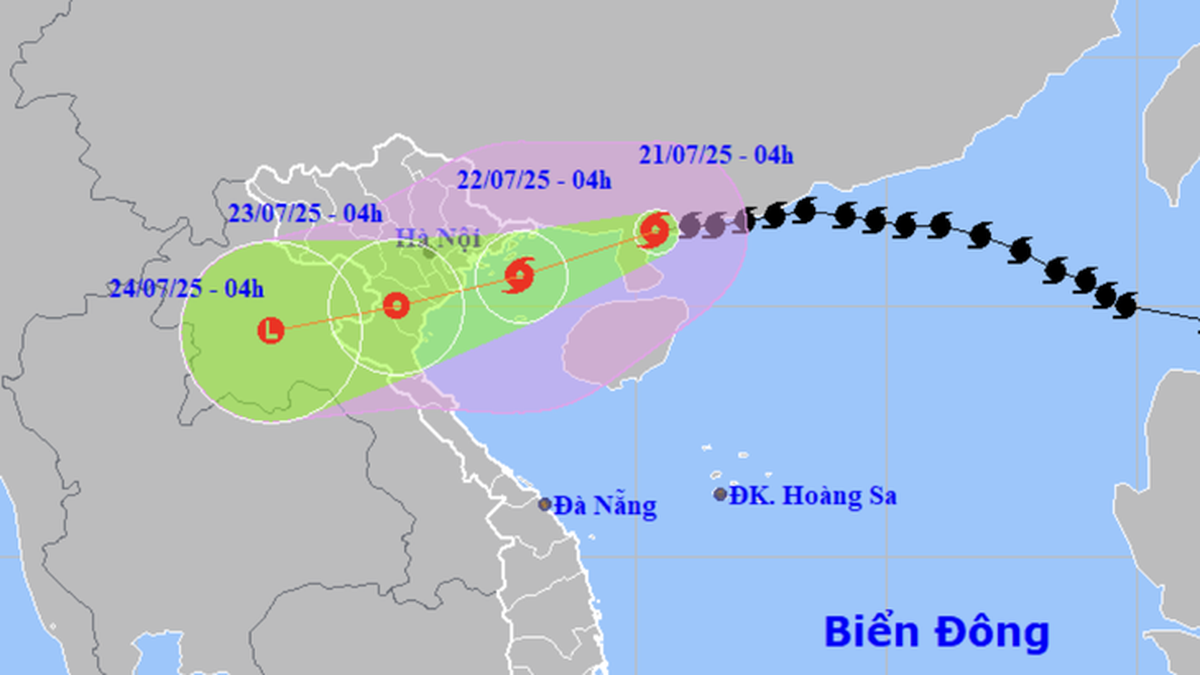





















![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rend visite à la mère héroïque vietnamienne, Ta Thi Tran](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/20/765c0bd057dd44ad83ab89fe0255b783)



































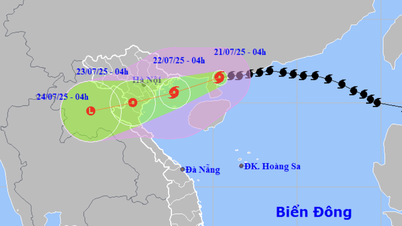





































Comment (0)