Afin de mettre en œuvre la résolution n° 57-NQ/TW du Politburo relative aux avancées scientifiques et technologiques, à l'innovation et à la transformation numérique nationale, ainsi que les dispositions de la résolution n° 36-KL/TW du Politburo et de la décision n° 1595/QD-TTg du Premier ministre concernant le renforcement de la transformation numérique, la modernisation de la gestion et de l'exploitation des barrages et des réservoirs d'irrigation, et l'exécution des missions confiées par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement , le Département de la gestion et de la construction des ouvrages d'irrigation a organisé, le 21 novembre après-midi, à Hanoï, en collaboration avec le journal Agriculture et Environnement, le forum intitulé « Transformation numérique, application des technologies à l'exploitation et à la sécurité des barrages et des réservoirs ».

Le Département de la gestion et de la construction des ouvrages d'irrigation, en collaboration avec le journal Agriculture et Environnement, a organisé le forum « Transformation numérique, application de la technologie dans l'exploitation, garantie de la sécurité des barrages et des réservoirs », dans l'après-midi du 21 novembre.
Le forum vise à créer un espace permettant aux gestionnaires, experts, scientifiques, entreprises et autorités locales de tous niveaux d'échanger et de partager leurs expériences et d'orienter la feuille de route de la transformation numérique dans la gestion de la sécurité des barrages et des réservoirs autour de trois piliers stratégiques : garantir la sécurité absolue des travaux dans des conditions météorologiques défavorables, réduire efficacement les inondations dans les zones en aval et assurer un approvisionnement en eau efficace et polyvalent.

Les responsables du Département de la gestion et de la construction des ouvrages d'irrigation et le rédacteur en chef adjoint du journal Agriculture et Environnement ont présidé la séance de discussion dans le cadre du Forum.
Le forum a réuni des délégués d'unités relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, d'instituts, d'écoles et de centres de services ; des représentants de ministères centraux, de directions régionales, de partenaires internationaux, d'une trentaine d'agences de presse et de représentants de collectivités locales, notamment des directions de l'Agriculture et de l'Environnement, des services de l'Irrigation, des unités de gestion des grands réservoirs et des comités populaires des communes riveraines de barrages et de réservoirs. Des entreprises technologiques telles que WeatherPlus et Vrain, ainsi que des représentants d'associations professionnelles (Association vietnamienne des grands barrages et du développement des ressources en eau, Association de l'irrigation, etc.) ont présenté leurs expériences et proposé des solutions.

Le forum « Transformation numérique, application technologique en exploitation, garantie de la sécurité des barrages et des réservoirs » s'est tenu à Hanoï, à la fois en présentiel et en ligne, l'après-midi du 21 novembre.
Des experts, des décideurs politiques et des entreprises présenteront des exposés sur l'application pratique des technologies et des bases de données pour soutenir l'exploitation des ouvrages d'irrigation ; des modèles de gestion et d'exploitation intelligents par bassin ; des services et solutions de données pour assurer la sécurité des réservoirs pendant la saison des crues ; et la création d'une base de données pour l'évaluation rapide des risques des barrages de taille moyenne et petite à l'aide de la méthode DRAPT dans le cadre du projet de sécurité des barrages Vietnam-Nouvelle-Zélande.

Un grand nombre de délégués, d'orateurs et de journalistes d'agences de presse étaient présents lors de la retransmission en direct du Forum « Transformation numérique, application des technologies dans l'exploitation et la garantie de sécurité des barrages et des réservoirs » dans l'après-midi du 21 novembre.
En outre, le forum abordera les expériences en matière d'opérations de régulation des crues et formulera des recommandations visant à améliorer l'efficacité de la transformation numérique pour garantir la sécurité des barrages et des réservoirs.
Résumé
17h30
N'achetez pas d'équipement, achetez des solutions, concentrez-vous sur les services de données
À la clôture du Forum, M. Nguyen Tung Phong, directeur du Département de la gestion et de la construction des ouvrages d'irrigation (ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), a souligné que les conditions météorologiques de cette année sont « anormales et extrêmes », avec une série de tempêtes (n° 5, 9, 10 et 11) se déplaçant très rapidement, selon des trajectoires totalement différentes de celles des années précédentes. Ces tempêtes ont entraîné des pluies torrentielles et des épisodes de fortes précipitations à répétition, et de nombreuses régions ont enregistré des niveaux « historiques ». Même le delta du Mékong a connu des phénomènes de marée inhabituels.

M. Nguyen Tung Phong, directeur du Département de la gestion et de la construction des ouvrages d'irrigation (ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), a prononcé le discours de clôture du Forum.
Dans ce contexte, la gestion et l'exploitation sûres des barrages et des réservoirs sont confrontées à des exigences inédites. Selon M. Phong, ce Forum vise à concrétiser la résolution 57 sur la transformation numérique et à garantir la sécurité des barrages et des réservoirs.
Concernant les résultats, le système de réservoirs d'irrigation a globalement respecté les procédures d'exploitation au cours des deux dernières années. De nombreux réservoirs, tels que Cam Son, Nui Coc et Ta Trach, ont contribué efficacement à la réduction des inondations. Certains ont même réduit leur débit de rejet de plusieurs dizaines de pour cent par rapport à leur débit d'entrée, participant ainsi de manière significative à la protection des zones situées en aval.
Toutefois, l’efficacité globale de la maîtrise des crues « reste inférieure aux attentes », notamment dans les réservoirs dotés uniquement de déversoirs libres, sans vannes de régulation, ou dans ceux qui n’ont pas abaissé leur niveau d’eau de manière proactive pour faire face aux crues, faute de fiabilité des prévisions. Il a souligné une série de problèmes fondamentaux.
Premièrement, de nombreuses procédures d'exploitation actuelles, qu'il s'agisse de réservoirs uniques ou multiples, reposent sur d'anciennes séries de données historiques et ne tiennent pas compte des valeurs extrêmes observées ces deux ou trois dernières années, où les précipitations peuvent être quatre à six fois supérieures à la moyenne mensuelle et les crues dépassent largement les records précédents. Il est donc nécessaire de revoir la méthode de calcul de la fréquence et de la probabilité de conception, tant au niveau de la planification, de la conception et de la construction des projets, et d'adapter les procédures d'exploitation.
Deuxièmement, le processus actuel reste fortement axé sur la « stabilité », alors qu'en réalité, les données relatives aux précipitations et aux inondations fluctuent très rapidement, ce qui exige une approche opérationnelle plus flexible, tout en privilégiant la sécurité en aval conformément aux directives des dirigeants du Parti et de l'État.
Concernant l'orientation stratégique, M. Phong a souligné la nécessité d'adopter une approche de « gestion et de gouvernance des risques », une gestion unifiée à l'échelle du bassin et interbassins, plutôt que de se concentrer sur chaque lac ou secteur d'activité individuellement. Les solutions doivent allier infrastructures et solutions logicielles : rénovation et modernisation des ouvrages pour répondre aux nouveaux besoins, et promotion de l'utilisation des technologies, des données et des modèles de prévision. Les missions des réservoirs doivent être clairement définies comme étant multiples : réduire les risques d'inondation et garantir la sécurité des ouvrages, protéger les zones en aval et assurer l'approvisionnement en eau pour les besoins vitaux et la production.
Il est donc nécessaire d'étudier l'augmentation de la capacité de prévention des inondations dans de nombreux lacs en envisageant une utilisation flexible de la différence entre le niveau d'eau normal et le niveau de crue de projet, au lieu de simplement « assurer la sécurité » comme auparavant.
Concernant le contenu de la transformation numérique, le ministère a attribué des codes d'identification à environ la moitié des plus de 86 000 projets et coordonne la finalisation des normes de la base de données sectorielle, en priorité pour les réservoirs. L'objectif est de créer une base de données partagée, au format unifié et mise à jour par les collectivités territoriales, ainsi qu'un logiciel d'aide à la décision partagé pour la gestion et l'exploitation des réservoirs.
L’État limitera les investissements massifs dans les capteurs, les stations de mesure et les systèmes SCADA ; il privilégiera plutôt l’achat de services de données et d’aide à la décision auprès d’entreprises technologiques, dans un esprit de socialisation de la transformation numérique : il ne s’agira pas d’acheter des équipements, mais des solutions.
Parallèlement, il a demandé d'améliorer les capacités de prévision et d'alerte, de connecter et d'exploiter efficacement les données provenant de systèmes tels que Vrain, des fournisseurs de services de prévision, des modèles pluviométriques, de débit et hydrauliques. L'objectif est de passer progressivement de la simple prévision à un système d'alerte suffisamment fiable pour que l'unité opérationnelle puisse abaisser le niveau d'eau du réservoir en toute sécurité afin de contenir les crues, optimisant ainsi les capacités de prévention tout en garantissant la sécurité.
Concernant les institutions, M. Phong a indiqué que le ministère prévoit de soumettre à l'Assemblée nationale des amendements à la loi sur les ressources en eau au cours de la période 2027-2028 et d'envisager de modifier et de remplacer le décret 114 après avoir analysé en détail les récents événements extrêmes. Des questions telles que les mécanismes de régulation du niveau d'eau avant les crues, la flexibilité des opérations, le renforcement des capacités de prévention des inondations, la normalisation des bases de données et le partage de logiciels seront étudiées et intégrées à ces documents.
Sur la base des avis exprimés lors du Forum, le Département va synthétiser et élaborer un plan précis afin de conseiller la direction du Ministère dans les prochains mois, dans le but de pouvoir constater clairement, lors d'une réunion dans quelques années, les progrès accomplis en matière de sécurité des barrages et des réservoirs et de réduction des dommages causés par les catastrophes naturelles.
17:10
Attribuer un code d'identification à chaque projet d'irrigation
Selon M. Dang Duy Hien, directeur adjoint du Département de la transformation numérique (ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), à l'ère du numérique, l'application des technologies de l'information ne suffit pas à elle seule à induire une transformation numérique ; au contraire, cette transformation doit s'appuyer sur les technologies de l'information. Pour les ouvrages d'irrigation et les barrages, chaque projet doit se voir attribuer un code d'identification unique afin de garantir une gestion rigoureuse et transparente.

M. Dang Duy Hien, directeur adjoint du Département de la transformation numérique (ministère de l'Agriculture et de l'Environnement).
La transformation numérique doit commencer par la numérisation des données existantes, en veillant à ce que les informations soient correctes, complètes, fiables, à jour et cohérentes, et qu'elles proviennent directement de la source, afin d'éviter les données erronées ou inexactes. Grâce à des données standardisées et complètes, le système de gestion permettra de surveiller, d'exploiter et de coordonner les barrages en temps réel, d'appuyer la prévision des crues, de réduire efficacement les inondations en aval et d'optimiser l'exploitation de l'eau d'irrigation, de l'eau potable et de l'hydroélectricité.
La transformation numérique contribue également à renforcer la coordination inter-réserves et intersectorielle, à améliorer les capacités de prise de décision fondée sur les données et à réduire les coûts et les risques opérationnels. Selon M. Hien, il est essentiel que les organismes de gestion unissent leurs efforts pour déployer simultanément les solutions numériques permettant une gestion intelligente et moderne des ouvrages d'irrigation, répondant aux exigences de sécurité et favorisant un développement durable.
17:05
Il doit y avoir une gestion unifiée des bases de données et des normes économiques et techniques.
Le professeur agrégé Hoang Thai Dai, représentant de l'Association vietnamienne de l'irrigation, a déclaré que les compétences des ingénieurs et experts vietnamiens n'ont rien à envier à celles des pays développés. Il a précisé que de nombreux responsables de l'irrigation ont été formés à l'étranger, maîtrisent les technologies modernes et sont même capables de les transmettre à leurs partenaires internationaux. Ceci confirme que le Vietnam dispose de ressources de haute qualité en nombre suffisant pour maîtriser les techniques de calcul, de simulation et d'exploitation dans le domaine des ressources en eau et des barrages.

Professeur agrégé, Dr Hoang Thai Dai.
M. Dai a fait part d'une préoccupation persistante depuis de nombreuses années : la gestion des ressources en eau par l'État était auparavant dispersée entre de nombreux organismes, ce qui engendrait des chevauchements et un manque de coordination. La fusion et la consolidation du modèle de gestion actuel, notamment avec l'intégration du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, constituent un signal très positif, car elles sont indispensables à l'harmonisation des politiques, des bases de données et des systèmes d'infrastructures de surveillance.
Il a souligné que si la technologie est aujourd'hui très développée, avec des logiciels performants et des équipements modernes, les données demeurent à la fois le principal atout et le point faible. Les données de surveillance, notamment celles du réseau national de surveillance hydrométéorologique et du réseau de stations des entreprises d'irrigation, restent dispersées, non normalisées et non interconnectées.
La répartition des stations, « dense à certains endroits, clairsemée à d'autres », comme l'a souligné le représentant de l'entreprise, est un problème manifeste qui n'a pas encore été entièrement résolu. Selon lui, pour exploiter efficacement cette technologie, il est indispensable de régler au préalable les problèmes liés à l'infrastructure de données et de surveillance.
Le professeur agrégé Hoang Thai Dai a déclaré que, quels que soient les progrès réalisés en matière d'équipement ou de logiciels, le rôle de l'État dans la gestion reste déterminant. L'État doit coordonner et harmoniser la gestion des ressources en eau et des systèmes de barrages, du niveau central au niveau local ; définir des normes, des procédures et des critères économiques et techniques ; et, parallèlement, former le personnel capable d'utiliser les nouvelles technologies. La formation de ressources humaines hautement qualifiées concerne non seulement les organismes de gestion, mais aussi les entreprises exploitant les ouvrages d'irrigation et les collectivités locales.
M. Dai a rappelé les enseignements tirés des conflits opérationnels survenus précédemment entre l'hydroélectricité et l'irrigation, lorsque les deux secteurs fonctionnaient séparément, chacun poursuivant ses propres objectifs. Selon lui, dans le nouveau contexte, où le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement unifie la gestion des ressources en eau et des ouvrages d'irrigation, une coordination plus étroite avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère de la Construction est indispensable pour traiter les questions intersectorielles. Il a affirmé que seule la mise en place d'un organisme de coordination unique, associé à des données complètes et à une infrastructure de surveillance synchronisée, permettra la mise en œuvre effective de politiques d'exploitation interréservoirs.
Le professeur agrégé Hoang Thai Dai a particulièrement apprécié la réunion des organismes de gestion, des collectivités locales et des entreprises pour dialoguer. Selon lui, ce type de conférence permet de mieux cerner le problème, d'avoir une vision plus claire de la situation actuelle et, surtout, de jeter les bases d'une recherche conjointe et de proposer des solutions avec le ministère et le gouvernement afin d'améliorer la gestion, de garantir la sécurité des barrages et le bon fonctionnement des réservoirs à l'avenir.
16:50
Proposition de nombreux programmes de coopération entre le Vietnam et les Pays-Bas en matière de gestion des barrages
Mme Pham Minh Uyen, conseillère principale en politiques publiques à l'ambassade des Pays-Bas au Vietnam, a indiqué que l'objectif de la participation au Forum était d'apprendre et de proposer des orientations pour la coopération future entre le Vietnam et les Pays-Bas en matière d'adaptation au changement climatique.

Mme Pham Minh Uyen, conseillère principale en politiques publiques à l'ambassade des Pays-Bas au Vietnam.
Mme Uyen a souligné que les experts néerlandais coopèrent avec le Vietnam et tirent des enseignements de son expérience. Ils sont disposés à partager leurs connaissances en matière d'application des sciences et technologies, d'intelligence artificielle, de mégadonnées et de développement des ressources humaines. Parallèlement, ils souhaitent mettre en œuvre des programmes de coopération entre les instituts de recherche et les universités néerlandais et vietnamiens, notamment dans le domaine de la sécurité des barrages, afin de renforcer les compétences professionnelles des deux pays.
Selon le représentant de l'ambassade des Pays-Bas, la coopération ne se limite pas au transfert de technologies des Pays-Bas vers le Vietnam, mais concerne également l'apprentissage et le partage d'expériences bilatérales, créant ainsi les bases d'un développement durable pour les deux pays.
16:40
Il est nécessaire de désigner un point de convergence pour contrôler, normaliser et diffuser les données.
Un représentant de la société WATEC a souligné que la sécurité d'exploitation des barrages dans les conditions météorologiques extrêmes actuelles repose sur trois facteurs fondamentaux : la densité des stations pluviométriques dans le bassin, la qualité des données collectées et la capacité du logiciel de gestion à synthétiser et analyser ces informations. L'absence de l'un de ces facteurs compromet l'efficacité de l'exploitation, car des données d'entrée inexactes rendent les modèles de prévision et les scénarios d'exploitation inopérants.

Représentant de la société WATEC.
Selon WATEC, bien que le nombre de stations soit élevé, leur répartition inégale fait que de nombreuses zones ont une densité de stations trop élevée, tandis que d'autres zones manquent d'équipement, ce qui donne des données qui ne reflètent pas fidèlement l'évolution des précipitations dans chaque bassin.
Un représentant de la société WATEC a déclaré que le logiciel de la société avait compilé et partagé gratuitement des données avec le Département de l'irrigation, le Département général de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles et le Département général de l'hydrométéorologie, afin de soutenir les opérations des barrages et la prévention des catastrophes naturelles.
Toutefois, pour exploiter efficacement ces données, il est nécessaire de désigner un organisme centralisateur chargé de les contrôler, de les normaliser et de les diffuser. WATEC est prête à assurer cette coordination tant que les sous-départements demeurent les unités d'installation, tandis que l'entreprise transmet les données à l'organisme centralisateur désigné par le ministère de l'Irrigation pour gestion.
Il est important que le Département fournisse des coordonnées claires et des plans de zonage des bassins afin que les entreprises puissent installer des stations appropriées, éviter les doublons et garantir la distance entre les stations pour une efficacité de surveillance optimale.
Il a également souligné que le principal obstacle réside dans la crainte de nombreux exploitants d'irrigation : lors de la réception de la station, ils doivent effectuer une maintenance annuelle et des inspections périodiques, alors que ces dépenses ne sont pas clairement définies dans les normes. Certains s'inquiètent également du fait qu'une panne du matériel, les obligeant à attendre des pièces de rechange provenant de fabricants étrangers, puisse perturber le système.
Il a affirmé que la position de WATEC est toujours de coopérer et de fournir des données complètes, mais que ce dont on a le plus besoin maintenant, c'est d'un cadre institutionnel unifié pour éviter des investissements fragmentés et dupliqués, tout en garantissant que les entreprises, les organismes de gestion et les exploitants de barrages puissent utiliser une source commune de données précises, continues et fiables.
16h30
Bac Ninh souhaite investir dans la gestion et l'exploitation des barrages.
Selon M. Vu Ba Thanh, directeur adjoint de la Bac Song Thuong Irrigation Works Exploitation Company Limited, l'application de la science et de la technologie dans la gestion et l'exploitation des ouvrages d'irrigation de Bac Ninh ces derniers temps a donné des résultats positifs, notamment lors des tempêtes successives de 2024.

M. Vu Ba Thanh, directeur adjoint de la Bac Song Thuong Irrigation Works Exploitation Company Limited.
L'entreprise a installé des équipements spécialisés, associés à des logiciels de calcul et des systèmes de surveillance, afin de suivre les précipitations et les crues, les niveaux d'eau des lacs, les débits entrants et sortants ainsi que l'état des travaux. Ceci permet une régulation efficace et réduit les risques pour l'aval de la rivière Thuong. Grâce à ces dispositifs, même lorsque le niveau d'eau de la rivière Thuong dépasse parfois le seuil d'alerte, des lacs comme Cam Son et Khuon Than restent opérationnels en toute sécurité.
Cependant, l'application de cette technologie présente encore de nombreuses limites. Beaucoup de dispositifs de surveillance installés hors du chantier sont anciens et leur fonctionnement est instable. Les caméras sont facilement endommagées par les inondations et la foudre. Les pluviomètres, les jauges de niveau d'eau et les débitmètres perdent parfois leur signal en raison des intempéries. Le système de données existant est incomplet et manque de connectivité. Les données logicielles sont fragmentées et non structurées, ce qui rend leur extraction et leur synthèse à des fins de gestion difficiles.
Une autre difficulté majeure réside dans le manque de financement pour la maintenance. Les coûts d'exploitation des équipements spécialisés, de réparation des dommages, de remplacement des composants, de gestion du réseau de surveillance et des logiciels ne sont pas clairement définis, tandis que les ressources financières de l'entreprise sont limitées. Certains équipements spécialisés, notamment les équipements importés, nécessitent un long délai de remplacement en cas de panne, ce qui nuit à la capacité de surveillance en temps réel. L'entreprise doit également saisir des données dans deux systèmes : le système de base de données d'irrigation (thuyloivietnam.vn) et celui du Département de la gestion des ressources en eau, ce qui engendre des doublons et des pertes de temps.
M. Vu Ba Thanh a indiqué qu'actuellement seuls 3 réservoirs, Cam Son, Khuon Than, Suoi Nua et le barrage de Cau Son, ont des données intégrées au système de base de données de l'industrie, tandis que les autres réservoirs n'ont pas fait l'objet d'investissements dans des équipements de surveillance synchrone.
L'entreprise souhaite équiper les 28 lacs et barrages restants. Elle finalise également un rapport proposant un projet de rénovation et de modernisation de la gestion et de l'exploitation des ouvrages d'irrigation pour la période 2026-2030, qui sera soumis à l'examen du Département de l'agriculture et de l'environnement, du Comité populaire de la province de Bac Ninh, du Département de la gestion des constructions d'irrigation et du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.
M. Thanh a indiqué que les réservoirs de la région montagneuse de Bac Ninh sont souvent exposés à des risques élevés lorsque de fortes pluies provoquent des inondations, des glissements de terrain ou perturbent les voies de circulation, entraînant des interruptions dans les opérations d'inspection et de surveillance. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre une solution globale pour améliorer l'efficacité technologique de leur gestion et de leur exploitation.
Compte tenu de ce qui précède, le représentant de la société recommande au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement d'investir dans des équipements spécialisés et synchronisés pour les réservoirs restants. Il recommande également d'établir des normes économiques et techniques pour la maintenance des systèmes de surveillance, des logiciels, des caméras et du matériel de terrain, et d'intégrer les données dans un système unique afin d'éviter leur saisie dans plusieurs logiciels différents. Enfin, il est essentiel d'accompagner la société dans la mise en place d'un centre de gestion et d'exploitation centralisé, conforme aux exigences de gestion modernes.
« L’entreprise continuera d’appliquer les sciences et les technologies ainsi que la transformation numérique pour améliorer l’efficacité de la gestion, assurer la sécurité des barrages et des réservoirs, la sécurité en aval et contribuer au développement socio-économique local », a affirmé M. Vu Ba Thanh.
16:15
Quang Ninh propose de finaliser les normes budgétaires pour l'exploitation du barrage
Un représentant de la société d'irrigation Yen Lap a indiqué que la province de Quang Ninh compte actuellement trois sociétés de gestion de l'irrigation. Toutefois, conformément au plan du Comité populaire provincial, elles fusionneront en une seule entité à partir de décembre, prenant ainsi en charge la gestion de 16 réservoirs, dont deux grands réservoirs équipés de vannes de régulation des crues. Trois de ces grands réservoirs, Yen Lap, Cao Van et Khe Giua, disposent actuellement d'équipements de surveillance automatique, mais la plupart de ces systèmes reposent sur une technologie ancienne, héritée du projet WB3 mis en œuvre entre 2008 et 2009.

Représentant de la société Yen Lap Irrigation Company Limited.
Le représentant de l'unité a indiqué que le système SCADA et les équipements de surveillance installés il y a de nombreuses années sont désormais obsolètes, tandis que le budget de maintenance est insuffisant au regard des normes techniques établies, ce qui engendre des difficultés de maintenance et d'exploitation. La nécessité de moderniser les équipements, de finaliser le système de surveillance automatisée et de constituer une base de données opérationnelle se fait de plus en plus pressante, notamment face à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes.
Concernant l'exploitation, le représentant de l'entreprise a indiqué que la province de Quang Ninh bénéficie de la proximité de ses réservoirs avec les embouchures des rivières, ce qui facilite leur régulation. Lors du récent typhon Yagi, les réservoirs du système ont permis de limiter les crues, garantissant ainsi la sécurité des ouvrages et des zones situées en aval. Plus particulièrement pour les réservoirs présentant un risque élevé pour plus de 1 000 personnes en aval, la province a construit, dans le cadre du projet WB3, un barrage autobloquant (Fuse Plug) afin d'assurer la sécurité lorsque les réservoirs ne parviennent pas à réduire les crues par eux-mêmes, conformément à leur procédure d'exploitation.
L'entreprise a proposé que le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement examine et publie un nouveau cadre économique et technique, prévoyant un budget distinct pour la maintenance du système de surveillance et des infrastructures technologiques. Ce cadre est essentiel pour que l'entreprise de gestion du réservoir dispose des ressources nécessaires au maintien d'une exploitation sûre, notamment lorsqu'elle recevra prochainement l'ensemble du système de barrages, conformément à la décision du Comité populaire provincial.
16h00
Cao Bang propose d'améliorer la réglementation et d'accroître le soutien technique en matière de sécurité des barrages.
Un représentant du Département de l'agriculture et de l'environnement de Cao Bang a indiqué que la province compte actuellement 23 réservoirs et barrages d'irrigation, classés selon la réglementation en vigueur : 16 grands réservoirs, 2 réservoirs moyens et 5 petits réservoirs. La capacité totale du système est d'environ 20 millions de m³, le plus grand réservoir ayant une capacité de près de 37 millions de m³. En raison du relief montagneux, de nombreux réservoirs sont construits sur des barrages de grande hauteur, ce qui les classe comme ouvrages d'envergure nécessitant une gestion rigoureuse pour des raisons de sécurité.

Représentant du Département de l'agriculture et de l'environnement de Cao Bang.
Cependant, la mise en œuvre concrète de ce système au niveau local présente encore de nombreuses limitations. À ce jour, seuls 13 des 18 grands et moyens lacs ont vu leurs procédures d'exploitation approuvées par le Comité populaire provincial. Le suivi reste très insuffisant : toute la province ne compte actuellement qu'un ou deux points de surveillance actifs, et aucun réseau n'est intégré au réseau hydrométéorologique national. Certains lacs ont été créés il y a plusieurs décennies par des coopératives elles-mêmes, sans plans techniques, ce qui complique l'évaluation de leur sécurité et de leur fonctionnement.
Lors des récentes tempêtes Yagi, n° 10 et n° 11, certains réservoirs de la région ont montré des signes de détérioration. Bien que non alarmants, ces signes ont néanmoins suscité l'inquiétude des populations vivant en aval. La province considère cela comme un signal d'alarme quant à la nécessité d'investir dans la réparation et le renforcement du système de surveillance des barrages, face à des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes.
Le représentant du Département a proposé que le Ministère et le Département institutionnalisent rapidement des réglementations détaillées, notamment en matière de financement des inspections, des réparations et de la maintenance, afin de garantir la sécurité du système de construction. Cao Bang a également recommandé la modernisation des infrastructures technologiques, car la plupart des chantiers sont encore gérés manuellement ; il a par ailleurs exprimé le souhait de bénéficier d'un soutien pour l'application des sciences et des technologies à la gestion.
La province a exprimé son souhait de participer aux projets de sécurité des barrages financés par la Banque mondiale et d'accéder à des outils modernes de soutien opérationnel, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité de l'exploitation et à garantir la sécurité des projets dans les prochains mois.
15:45
Les systèmes de surveillance hydrométéorologique et pluviométrique aident le réservoir de Cua Dat à réduire efficacement les inondations.
Selon M. Le Ba Huan, chef du département de gestion de la construction, en charge de la branche de Cua Dat (Conseil de gestion des investissements et de la construction de l'irrigation 3, ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), l'exploitation pratique du réservoir de Cua Dat lors de nombreuses crues majeures montre que la leçon la plus importante est d'être proactif, discipliné et fondé sur la science.

M. Le Ba Huan, chef du département de gestion de la construction, en charge de la succursale de Cua Dat (Conseil de gestion des investissements et de la construction de l'irrigation 3, ministère de l'Agriculture et de l'Environnement).
La gestion des tempêtes et des dépressions tropicales n'est efficace que si les plans approuvés sont scrupuleusement respectés et si les procédures d'exploitation inter-réservoirs du bassin du fleuve Ma sont mises en œuvre avec rigueur. En particulier, les prévisions hydrologiques et la gestion des ressources en eau demeurent essentielles pour garantir la sécurité des mesures de prévention des inondations.
La période de prévision optimale devrait être d'environ 5 jours, à compter du moment de la tempête ou de la dépression tropicale, avec des informations complètes sur le volume total des inondations et l'heure du pic de crue. Auparavant, faute de technologies adéquates, les agents devaient effectuer des mesures manuelles sous la pluie et le vent, escaladant les montagnes et traversant les cours d'eau pour se rendre aux stations hydrologiques pendant de longs mois ; une tâche à la fois ardue et dangereuse. À cette époque, les prévisions d'inondations reposaient principalement sur l'expérience, ce qui les rendait tardives et ne permettait pas de suivre l'évolution réelle de la situation.
Ces dernières années, le réservoir de Cua Dat a profondément modifié son mode de gestion. Un système automatique de surveillance du niveau d'eau et des précipitations a été installé ; un logiciel de prévision et de régulation des crues, développé par l'Institut vietnamien des ressources en eau, est désormais utilisé ; les prévisions météorologiques sont mises à jour en continu grâce à des modèles globaux tels que l'ECMWF, le GFS et l'ICON, via la plateforme Windy. Grâce à cela, la fiabilité des prévisions s'est accrue, permettant une gestion plus proactive et efficace du réservoir en toutes circonstances.
« Toutefois, les entreprises de gestion de la construction rencontrent toujours des difficultés pour signer des contrats de location de logiciels et de services d'inspection d'équipements, faute de normes et de tarifs précis. Par conséquent, l'entreprise recommande au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement de publier rapidement une réglementation afin de lever cet obstacle », a suggéré M. Le Ba Huan.
Grâce à des prévisions fiables, le réservoir de Cua Dat a relâché préventivement les eaux de crue lors de plusieurs tempêtes majeures. Lors de la troisième tempête, le réservoir a évacué 530 millions de m³, réduisant ainsi le débit de pointe de 3 546 m³/s. Lors de la cinquième tempête, les lâchers d'eau effectués avant l'arrivée de la tempête ont permis de constituer une capacité de retenue supplémentaire de 192 millions de m³. Au moment où la tempête a touché terre, le réservoir a continué à évacuer 219 millions de m³, réduisant le débit de pointe de plus de 3 000 m³/s. De même, avant la dixième tempête, le niveau d'eau du réservoir a été abaissé préventivement de près de 4,3 m, créant une capacité de stockage supplémentaire de 116 millions de m³. À l'arrivée de la tempête, le réservoir a évacué 145 millions de m³ supplémentaires, réduisant ainsi le débit de pointe de près de 4 000 m³/s.
Durant l'opération, l'unité de gestion a maintenu une communication constante avec les unités de gestion des travaux du bassin du fleuve Tchou, l'agence hydrométéorologique, les autorités locales et les services de prévention des catastrophes afin de les tenir informés des niveaux d'eau, des débits de crue, des inondations en aval et des marées. La diffusion rapide d'informations à la presse a également permis à la population de réagir de manière proactive, garantissant ainsi la sécurité des personnes et des biens.
En réalité, le réservoir de Cua Dat dispose encore d'une importante capacité de retenue pour la prévention des inondations, notamment à partir d'une altitude de 110 m. Par conséquent, le Comité 3 a proposé que la province de Thanh Hoa envisage une utilisation flexible de cette capacité, équivalente à 257,2 millions de m³, afin d'améliorer la maîtrise des crues et de minimiser les dommages aux zones situées en aval lors de situations d'inondations de plus en plus extrêmes.
15:30
Il est nécessaire d'innover dans l'exploitation des réservoirs et d'accroître la coordination entre l'irrigation et l'hydroélectricité.
Après la pause, le Forum a entamé sa séance de discussion. M. Nguyen Tung Phong, directeur du Département de la gestion et de la construction des ouvrages d'irrigation (ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), a déclaré que les fortes pluies et les inondations récentes avaient mis en lumière de nombreux problèmes qui nécessitent une réévaluation, tant en matière de prévision que d'exploitation des réservoirs.

M. Nguyen Tung Phong, directeur du Département de la gestion et de la construction des ouvrages d'irrigation (ministère de l'Agriculture et de l'Environnement).
M. Phong a soulevé la question essentielle : faut-il maintenir le niveau d’eau du lac au niveau normal conformément à la procédure actuelle, ou faut-il l’abaisser pour augmenter sa capacité de rétention des crues dans un contexte de conditions météorologiques de plus en plus erratiques ?
Selon lui, la décision relative au niveau d'eau avant la crue doit reposer sur des bases scientifiques, car elle influe directement sur la sécurité des constructions, la sécurité des zones en aval et la nécessité de stocker l'eau pour la production. Or, les récentes inondations montrent que les capacités de prévention des crues sont moindres qu'auparavant.
Soulignant l'importance des prévisions, M. Phong a indiqué que de nombreuses unités dépendent encore de modèles de prévision internationaux, alors que les scientifiques préconisent la mise en place de modèles de prévision spécialisés pour chaque bassin versant. Il s'agit d'une condition essentielle pour améliorer la précision des prévisions dans le contexte du changement climatique, qui rend les crues plus imprévisibles et dépasse facilement les paramètres de conception initiaux.
Concernant la capacité et la coordination des interréservoirs, il a indiqué que la capacité totale des plus de 7 000 réservoirs d’irrigation n’atteint que 15,5 milliards de m³ environ, tandis que de nombreux réservoirs hydroélectriques présentent une capacité bien supérieure. Par conséquent, une participation plus active du système hydroélectrique à la prévention des inondations permettrait d’accroître significativement l’efficacité des mesures de protection en aval, notamment lors de fortes pluies « historiques ».
M. Phong a souligné que les réservoirs actuels sont des projets à usages multiples : garantir la sécurité de l’ouvrage, celle des zones en aval et assurer l’approvisionnement en eau pour la production – la vie quotidienne et la production d’électricité. Par conséquent, la gestion et l’exploitation doivent être interdisciplinaires et ne peuvent être abordées séparément pour chaque domaine. Il a cité l’exemple de la gestion d’un réservoir sur la rivière Cau, qui peut avoir des répercussions sur la rivière Thuong, ou encore la régulation de la rivière Da, qui affecte le trafic et la production dans le delta du fleuve Rouge. Ceci démontre la nécessité d’une gestion à l’échelle de l’ensemble du système fluvial, et non pas d’un petit bassin versant.
Lors d'une discussion sur la prochaine session d'orientation, M. Phong a déclaré que le secteur de l'irrigation devait mettre à jour sa base de données sur les crues, ses paramètres de conception et ses normes de sécurité des barrages afin de tenir compte des nouvelles valeurs des phénomènes météorologiques extrêmes. La transformation numérique ne se limite pas à la numérisation des données ; elle doit également aider le secteur à résoudre des problèmes concrets : la prévision des crues, le calcul de la capacité de stockage des eaux et l'aide à la décision en temps réel. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement examine les propositions locales, comme celle de Thai Nguyen visant à ajuster les niveaux d'eau normaux afin d'accroître la capacité de stockage des eaux de crue.
M. Phong a souligné qu'une étroite coordination entre l'irrigation et l'hydroélectricité, ainsi que l'application de nouvelles technologies et de données modernes, seront essentielles pour garantir la sécurité en aval et servir le développement socio-économique dans un contexte de climat de plus en plus extrême.
14:45
Création d'une base de données sur les risques pour les barrages de taille moyenne et petite à l'aide de la méthode DRAPT
Lors du Forum, le professeur agrégé Dr Ho Sy Tam, chef du département des sciences, des technologies et de la coopération internationale (Université des ressources en eau), a présenté la construction d'une base de données pour l'évaluation rapide des risques des petits et moyens barrages à l'aide de la méthode DRAPT (Dam - Rapid - Assessment - Prioritisation - Tool), dans le cadre du projet de sécurité des barrages Vietnam-Nouvelle-Zélande.

Professeur agrégé Dr. Ho Sy Tam, chef du département des sciences, des technologies et de la coopération internationale (Université des ressources en eau).
Le Vietnam compte actuellement environ 7 000 barrages, dont beaucoup sont dégradés et dont la capacité de protection contre les crues ne répond plus aux exigences. La plupart de ces barrages sont situés en amont, tandis qu'en aval se trouvent des zones résidentielles ou des régions densément peuplées. Le risque lié à la sécurité des barrages provient de la possibilité et de l'ampleur des dégâts en cas d'incident.
Le professeur agrégé Ho Sy Tam a déclaré que l'outil DRAPT a été développé pour fournir une méthode d'évaluation basée sur des observations de terrain et déterminer l'ordre de priorité des investissements pour la réparation et la modernisation des barrages au Vietnam. Développé entre 2017 et 2018 par des experts en sécurité des barrages, DRAPT a été testé sur plus de 200 barrages à travers le pays.
Cet outil facilite l’évaluation initiale de l’état actuel du barrage grâce à des relevés sur site, la mesure de la capacité du déversoir, l’analyse des conséquences d’une rupture, des modes de défaillance potentiels et du niveau de risque pour la sécurité du barrage. Les résultats de cette évaluation permettent à l’organisme de gestion de prendre des décisions éclairées concernant des investigations complémentaires ou des investissements supplémentaires visant à réduire les risques.
Le DRAPT peut être appliqué à un grand nombre de barrages au sein d'une commune, d'une société d'exploitation des ressources en eau ou d'une province. Le processus d'évaluation comprend 5 étapes :
- Inspecter le barrage et consigner son état général ainsi que toute anomalie.
- Évaluation préliminaire des impacts en aval, de l'étendue des inondations en cas de rupture du barrage et de la population à risque.
- Capacité estimée en cas de crue de conception.
- Identifier les types de ruptures de barrage susceptibles de se produire.
- Synthétiser les résultats pour déterminer le niveau de risque lié à la sécurité du barrage.
À ce jour, le DRAPT s'est avéré efficace lorsqu'il a été appliqué à près de 150 barrages dans les provinces de Nghe An et Ha Tinh et continue d'être déployé sur 85 barrages dans les provinces de Quang Binh, Hué et Dak Lak.
Les représentants de l'Université des ressources en eau ont souligné la nécessité d'une transformation numérique dans la gestion de la sécurité des barrages en général et avec l'outil DRAPT en particulier, en raison du grand nombre de barrages, les données doivent être mises à jour au moins une fois par an et la liste des barrages prioritaires doit être surveillée régulièrement.
De plus, la numérisation permettra de réduire les délais de collecte et de traitement des informations. Parallèlement, elle facilitera la décentralisation et la délégation de pouvoirs dans le cadre des évaluations de la sécurité des barrages.
14h30
Promouvoir l'investissement dans les infrastructures de transmission de données pour les systèmes de surveillance
Le Dr Ha Ngoc Tuan, représentant en chef de Weather Plus au Vietnam, a présenté le système d'outils de soutien à la gestion des réservoirs que son unité et ses partenaires ont mis au point au fil des ans.

Dr Ha Ngoc Tuan, représentant en chef de Weather Plus au Vietnam.
Selon lui, l'objectif du système est d'aider les gestionnaires de réservoirs au Vietnam à prendre des décisions face à l'aggravation des inondations, notamment dans les régions du Nord et du Centre-Nord, qui ont subi une série de tempêtes et de dépressions tropicales en juillet et août derniers. Concernant le bassin du fleuve Chu-Ca, dont la capacité totale de retenue est d'environ 1,6 milliard de m³, comprenant de nombreux grands réservoirs comme celui de Cua Dat et une série de réservoirs hydroélectriques de taille moyenne et petite, le Dr Tuan a expliqué que le problème consiste à la fois à garantir la sécurité des barrages et à minimiser les risques d'inondation pour les zones situées en aval.
Il a expliqué que la méthode traditionnelle, basée sur un unique point de contrôle du niveau d'eau en aval, a été efficace pendant des décennies, mais qu'elle n'est plus adaptée face aux changements climatiques qui modifient les régimes de pluie et de crue. La nouvelle tendance consiste à surveiller simultanément les variations des niveaux d'eau et des débits vers les réservoirs en amont, et à calculer en temps réel le niveau d'eau optimal avant crue pour chaque réservoir.
Sur cette base, Weather Plus a coordonné la mise en place d'un système composé de trois piliers : un réseau spécialisé de surveillance des précipitations dans le bassin ; des modèles de prévision des précipitations et des débits calibrés spécifiquement pour chaque zone ; et un logiciel de gestion des réservoirs.
Le logiciel comporte deux couches : une couche par réservoir qui visualise les données, le niveau d’eau, les régimes d’écoulement et les scénarios opérationnels de chaque réservoir ; et une couche d’intégration à l’échelle du bassin qui permet de relier les réservoirs entre eux, en intégrant des algorithmes hydrauliques et d’optimisation à la chaîne opérationnelle. Le système comprend un « module de connaissances » où des experts analysent directement les données et formulent des recommandations, au lieu de s’en remettre entièrement à l’ordinateur.
Le Dr Tuan a cité l'exemple d'une crue récente dans le bassin du fleuve Chu. Grâce à un réseau plus dense de stations de surveillance des précipitations et à un modèle de prévision spécifiquement conçu pour cette zone, son équipe a élaboré deux scénarios de crue lacustre, avec un débit de pointe attendu d'environ 6 000 m³/s et un volume d'eau total d'environ 700 millions de m³.
La réalité a ensuite quasiment coïncidé avec le scénario optimiste, permettant aux centrales hydroélectriques et aux réservoirs de limiter les inondations, d'éviter que le niveau de l'eau ne dépasse le seuil de sécurité et de protéger ainsi les installations et la zone en aval. Le système de prévision a affiché un taux de réussite supérieur à 80 % lors des fortes pluies qui se sont abattues sur la région du Centre-Nord pendant la récente saison des crues.
Il a toutefois souligné le risque majeur d'interruption des signaux de transmission de données lors de violentes tempêtes, privant ainsi le système de surveillance d'informations cruciales. Face à ce constat, le Dr Tuan a recommandé au secteur de l'irrigation d'investir dans une infrastructure de transmission de données plus indépendante et stable, à l'instar du secteur de l'électricité qui construit son propre réseau de transport.
Il a souligné que ce n'est qu'en combinant des méthodes d'exploitation appropriées, des données suffisamment denses et des outils de calcul fiables que les solutions numériques peuvent être véritablement efficaces pour garantir la sécurité des réservoirs et minimiser les dommages causés par les inondations.
14:15
Tirer les leçons de l'expérience du système de gestion intelligente du bassin du fleuve Yangtsé (Chine)
Lors d'une intervention sur le modèle d'exploitation intelligent du système de réservoirs servant à la gestion des catastrophes dans le bassin du fleuve Yangtsé (Chine), le professeur Nguyen Quoc Dung, vice-président permanent de l'Association vietnamienne des grands barrages et du développement des ressources en eau, a souligné que ce système était devenu la « colonne vertébrale » de la gestion du bassin du plus long fleuve d'Asie.

Le professeur Dr. Nguyen Quoc Dung, vice-président permanent de l'Association vietnamienne des grands barrages et du développement des ressources en eau, a déclaré que nous pouvions tirer des enseignements de l'expérience du système de gestion intelligente du bassin du fleuve Yangtsé (Chine).
Dans cette région, les phénomènes météorologiques extrêmes sont plus fréquents et causent d'importants dégâts à la production et aux populations. Plus le développement socio-économique est important, plus les risques de catastrophes naturelles augmentent. Par conséquent, la Chine est contrainte de combiner des mesures d'ingénierie et non d'ingénierie globales, notamment en ce qui concerne la gestion de son système de réservoirs.
La crue historique de 1954 sur le fleuve Yangtsé, avec un volume total de 102,3 milliards de m³, a eu des conséquences considérables. La simulation de la régulation à l'aide du Système d'Aide Opérationnelle (SAO) a permis de réduire le volume d'eau excédentaire à relâcher à 35 milliards de m³. L'optimisation de davantage de projets d'irrigation permettrait de ramener ce volume à environ 30 milliards de m³. Ceci implique une réduction du recours aux bassins de rétention des eaux de crue, évitant ainsi des dommages importants aux personnes et aux biens. Actuellement, le bassin compte 40 grands réservoirs d'une capacité totale de prévention des crues de 57 milliards de m³, jetant les bases d'un système de régulation d'une ampleur sans précédent.
Le système d'aide à la décision (SAD) joue un rôle central dans la prévision des crues et la gestion des réservoirs. Il décrit la structure des ouvrages, les objectifs opérationnels et leurs interrelations, définissant ainsi les procédures d'exploitation sous-jacentes. Grâce aux technologies d'exploration de données, à l'intelligence artificielle et au traitement des mégadonnées, le SAD est capable d'évaluer automatiquement les situations de crue et de formuler des recommandations de régulation en temps réel. Les services de géolocalisation contribuent à alerter et à guider les populations des zones sinistrées.

Centre de surveillance de la sécurité des projets hydroélectriques en Chine. Photo : EVN .
Les systèmes d'aide à la décision (SAD) sont devenus un outil important pour la régulation à usages multiples : protection contre les inondations, approvisionnement en eau, hydroélectricité, navigation et protection des écosystèmes. L'expérience acquise dans le bassin du Yangtsé a permis à la Chine d'élaborer le « Plan annuel de coordination conjointe des groupes de réservoirs », approuvé par le ministère des Ressources en eau pour 2018 et 2019, et d'étendre ce modèle à d'autres bassins.
Toutefois, l’élaboration d’un cadre réglementaire largement applicable demeure un défi ; l’apprentissage automatique est exploré pour tirer des enseignements des scénarios opérationnels historiques afin de faciliter la prise de décision dans des conditions en évolution rapide.
M. Dung a déclaré que le Vietnam s'intéressait depuis de nombreuses années à la mise en place d'un système d'aide à la décision (SAD) et que, de fait, cet outil s'est avéré efficace pour la gestion des réservoirs, des bassins interréservoirs et la prévention des catastrophes naturelles. Toutefois, face aux exigences croissantes en matière de sécurité des barrages, de sécurité en aval et d'exploitation optimale de l'eau dans un contexte de climat extrême, le Vietnam a besoin d'un système d'aide à la décision plus intelligent et plus moderne, capable de relever les nouveaux défis de la gestion des ressources en eau.
14h00
Amélioration des données et des technologies pour des opérations d'irrigation sûres
Lors du forum, le Dr Nguyen Van Manh, directeur du département des sciences et technologies (Institut de planification des ressources en eau), a souligné que le contexte opérationnel se complexifie : sur les quelque 6 800 réservoirs que compte le pays, seuls 300 représentent 80 % de la capacité régulée et seulement 200 environ sont équipés de vannes de régulation. Par ailleurs, les crues extrêmes prévues pour la période 2024-2025 continuent d’exercer une forte pression, contraignant le secteur de l’irrigation à renforcer ses capacités de prévision, de surveillance et d’exploitation.

Le Dr Nguyen Van Manh, chef du département des sciences et technologies (Institut de planification des ressources en eau), a présenté l'état actuel des technologies et des applications de bases de données pour soutenir l'exploitation des ouvrages d'irrigation.
L'Institut de planification des ressources en eau gère actuellement de nombreuses bases de données importantes, notamment le système de sécurité des barrages et des réservoirs, les données d'exploitation de l'irrigation (45 000 ouvrages identifiés), ainsi qu'un réseau d'information provenant du système pluviométrique Vrain (plus de 2 600 stations) et des données hydrométéorologiques nationales. L'entrepôt de données de l'Institut contient des données sur les ressources en eau, les niveaux d'eau des réservoirs et les débits en amont et en aval, alimentant ainsi le modèle de calcul, la simulation hydraulique et la prévision des crues.
Le Dr Manh a indiqué que les groupes d'experts de l'Institut sont organisés par bassin et gèrent les crues quotidiennement ou à la demande. Les modèles pluie-débit MIKE NAM et HEC-HMS calculent et prévoient le volume d'eau alimentant le lac après chaque épisode pluvieux, tandis que Mike11, Mike Flood et HEC-ResSim permettent de simuler la régulation du lac et d'effectuer des calculs en aval. Ces résultats contribuent à l'élaboration de bulletins d'alerte aux crues, de cartes des zones inondables et à la proposition de scénarios de gestion optimaux pour des dizaines de grands lacs tels que Cua Dat, Ngan Truoi, Ta Trach ou le système fluvial Rouge-Thaï Binh.
Cependant, la qualité des prévisions reste largement tributaire des données pluviométriques et de l'expertise, ce qui peut entraîner des erreurs dans l'estimation des pics et des durées de crue lors de certains événements. Les modèles actuels sont également considérés comme obsolètes et doivent être mis à jour pour suivre le rythme du changement climatique et répondre aux exigences opérationnelles de plus en plus strictes.

Le personnel de la société par actions WATER Resources Engineering Development and Consulting (WATEC) vérifie la station de pluviomètre automatique et la station d'alerte aux fortes pluies.
Pour remédier à cette situation, le Dr Manh a proposé la création d'une vaste base de données pour l'ensemble du secteur, conforme aux normes internationales, en standardisant l'identification des ouvrages et le processus de partage des données du niveau central au niveau local. Le secteur de l'irrigation doit se connecter et partager ses données de manière synchrone avec le système hydrométéorologique national, le réseau de pluviomètres automatiques Vrain et les plateformes météorologiques telles que WeatherPlus. Ceci permet de garantir que toutes les unités opérationnelles utilisent la même source de données, limitant ainsi les erreurs de calcul.
Parallèlement, le secteur doit promouvoir l'application de l'intelligence artificielle (IA) pour analyser rapidement les données relatives aux précipitations et aux débits et faciliter les prévisions. Le Dr Manh a souligné que le facteur déterminant reste l'humain. Il est essentiel de maintenir une équipe d'experts pour exploiter le modèle régulièrement, même en dehors des périodes d'inondations, afin de vérifier et de calibrer les données en continu et de garantir la disponibilité permanente du système. C'est à cette seule condition que la qualité des prévisions pourra être améliorée et que la réponse aux catastrophes naturelles sera véritablement proactive.
13:45
Normalisation des données des systèmes de réservoirs pour répondre aux crues extrêmes
Lors du Forum, M. Phan Tien An, chef du département de la sécurité des barrages et des réservoirs (département de la gestion et de la construction des ouvrages d'irrigation, ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), a déclaré que la gestion et l'exploitation des barrages et des réservoirs sont soumises à de nouvelles pressions en raison de la fréquence accrue des pluies extrêmes et des inondations.

M. Phan Tien An, chef du département de la sécurité des barrages et des réservoirs (Département de la gestion et de la construction des ouvrages d'irrigation, ministère de l'Agriculture et de l'Environnement).
Le pays compte actuellement plus de 7 300 barrages et réservoirs, qui contribuent à l’irrigation, à l’approvisionnement en eau potable et alimentent de nombreux secteurs économiques. Grâce à la vigilance de tous les niveaux, la saison des crues de 2025, bien que violente, n’a pas provoqué d’incidents majeurs et les grands réservoirs ont fonctionné de manière relativement stable.
Cependant, derrière cette situation se cachent de nombreuses difficultés persistantes, notamment pour les petits et moyens réservoirs gérés par les collectivités locales. Le taux d'application des exigences obligatoires en matière de sécurité des barrages demeure très faible : seuls 30 % des réservoirs disposent de plans d'intervention d'urgence, 9 % ont fait l'objet d'une inspection de sécurité et seulement 19 % sont équipés de systèmes de surveillance. Nombre de réservoirs ne possèdent ni procédures d'exploitation ni signalisation de protection, ce qui engendre un risque d'insécurité en cas de crue soudaine.
Le principal défi actuel réside dans le manque de données techniques complètes et d'un système technologique synchronisé. La base de données des réservoirs du ministère a été créée en 2016, mais seuls 900 réservoirs environ disposent de paramètres complets. La plupart des localités gèrent encore les données manuellement à l'aide d'Excel ou de documents séparés ; ces données ne sont ni mises à jour ni interconnectées, ce qui rend leur synthèse et leur utilisation à des fins stratégiques extrêmement difficiles. Le système de surveillance hydrométéorologique spécialisé est toujours insuffisant et obsolète ; de nombreux réservoirs ne sont pas équipés de stations pluviométriques sur l'ensemble de leur bassin, et les données de surveillance sont instables.
Parallèlement, ces dernières années ont été marquées par des précipitations irrégulières et des tempêtes. L’urbanisation rapide a réduit les zones de refuge contre les inondations, et les infrastructures de drainage n’ont pas suivi le rythme. La coordination entre les réservoirs demeure un point faible majeur : les réservoirs hydroélectriques et d’irrigation partagent des données limitées, et il n’existe aucun mécanisme de coordination unifié entre les bassins. Les procédures d’exploitation de nombreux réservoirs sont obsolètes et n’ont pas été mises à jour faute d’outils et de données en temps réel.
Les capacités de drainage et de prévention des inondations de nombreuses zones en aval sont insuffisantes, tandis que le système d'alerte des petits lacs reste principalement manuel. L'infrastructure informatique est trop faible pour traiter les données massives ; les ressources d'investissement sont trop limitées, ne couvrant qu'environ 11,8 % des besoins de maintenance et étant principalement consacrées aux réparations, sans financement pour le développement technologique.

Il est nécessaire de promouvoir activement la transformation numérique et l'application des technologies dans l'ensemble de la chaîne de gestion des réservoirs. Photo illustrative .
Pour remédier à ces lacunes, M. An estime qu'il est indispensable de promouvoir activement la transformation numérique et l'application des technologies dans l'ensemble de la chaîne de gestion des réservoirs. Il convient en premier lieu de perfectionner les institutions, de modifier la réglementation et d'établir des normes communes pour les bases de données, la surveillance et les logiciels d'exploitation. Les bases de données sectorielles doivent être normalisées et exploitées selon le principe du partage, permettant aux collectivités locales d'utiliser leurs propres logiciels, mais exigeant une connexion via des API standardisées.
Parallèlement, il est nécessaire d'investir dans des services de surveillance modernes ou de les externaliser, de mettre en place des systèmes d'alerte automatique, de renforcer les compétences du personnel en matière d'analyse de données et d'exploiter les nouvelles technologies. L'établissement de normes économiques et techniques pour les investissements dans l'Internet des objets (IoT), les logiciels de surveillance, l'intelligence artificielle (IA) et le cloud computing permettra aux collectivités territoriales d'harmoniser leurs estimations et leur mise en œuvre.
M. An a affirmé que lorsque les données seront normalisées, les systèmes de surveillance complets et les technologies d'aide à la décision largement appliquées, l'exploitation des réservoirs sera plus sûre, plus rapide et répondra aux exigences d'une période de changements climatiques de plus en plus sévères.
13h30
Les réservoirs agissent comme des « boucliers », assurant les ressources en eau et les moyens de subsistance des communautés.
S'exprimant lors du forum « Transformation numérique, science et technologie dans l'exploitation des barrages et des réservoirs », le 21 novembre après-midi, M. Vu Minh Viet, rédacteur en chef adjoint du journal Agriculture et Environnement , a indiqué que cet événement se déroulait dans un contexte de graves inondations ayant causé d'importants dégâts dans de nombreuses régions du pays. Les régions du Centre, de Khanh Hoa et de Dak Lak continuent de subir de graves inondations, tandis que plusieurs provinces du Nord viennent de connaître des crues historiques. Les dégâts matériels et humains se chiffrent en dizaines de milliers de milliards de dongs.

Vu Minh Viet, rédacteur en chef adjoint du journal Agriculture et Environnement, a souligné que les pluies extrêmes et les inondations rendent urgente la transformation numérique de la gestion des réservoirs.
D'après M. Viet, les fortes pluies en amont exercent une pression considérable sur la gestion et l'exploitation du système de barrages et de réservoirs, soulevant de nombreuses questions quant à la régulation précise des crues, la sécurité des ouvrages et la diffusion rapide et fiable d'informations en cas d'urgence. Il a souligné que seule la promotion de la transformation numérique et l'application des sciences et des technologies à l'exploitation permettront de relever efficacement ces défis. « Il s'agit là d'une solution novatrice et d'une priorité absolue », a-t-il déclaré.
Les responsables du journal Agriculture et Environnement ont souligné que les réservoirs ne servent pas uniquement à l'irrigation, mais jouent également un rôle de protection pour les populations, garantissant la sécurité hydrique et contribuant au développement socio-économique. Cependant, nombre de ces ouvrages sont anciens et les systèmes d'information et de prévision ne sont pas synchronisés, ce qui exige une profonde transformation du secteur de l'irrigation, tirant parti des acquis de la quatrième révolution industrielle.
M. Viet a particulièrement souligné l'importance du Forum dans le contexte de la mise en œuvre, par le secteur, de la Résolution 57 relative aux avancées scientifiques et technologiques et à la transformation numérique ; de la Conclusion 36 du Politburo sur la sécurité des barrages et des réservoirs ; et de la Décision 1595 du Premier ministre relative à la modernisation de la gestion et de l'exploitation des réservoirs d'irrigation. Ces orientations sont considérées comme des axes essentiels pour améliorer les capacités d'alerte aux risques et réagir de manière proactive aux inondations.

Les réservoirs ne servent pas seulement à l'irrigation, mais jouent également un rôle de « bouclier ». Photo d'illustration .
Le rédacteur en chef adjoint du journal Agriculture et Environnement a présenté les six principaux objectifs du Forum : unifier la prise de conscience de l’urgence de la transformation numérique face aux inondations extrêmes ; partager les expériences technologiques nationales et étrangères ; proposer des solutions pour améliorer les normes juridiques et techniques ; élaborer une feuille de route adaptée à chaque groupe de réservoirs ; promouvoir la coordination intersectorielle et la diffusion des données hydrométéorologiques ; et garantir la fourniture d’informations précises et opportunes aux personnes en situation de danger, afin d’éviter la panique.
M. Viet a également suggéré que les experts, les organismes de gestion et les entreprises technologiques se concentrent sur des discussions approfondies concernant l'état actuel de l'application technologique, la capacité à reproduire des modèles opérationnels intelligents, les difficultés de mobilisation des ressources et les propositions pratiques visant à construire un écosystème de transformation numérique synchrone pour le secteur de l'irrigation.
Source : https://nongnghiepmoitruong.vn/chuyen-doi-so-ung-dung-cong-nghe-trong-van-hanh-bao-dam-an-toan-ho-dap-d785638.html








































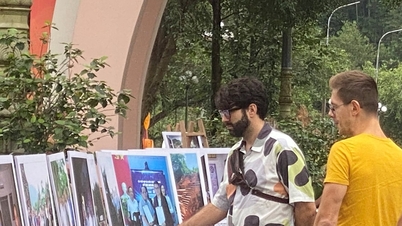















































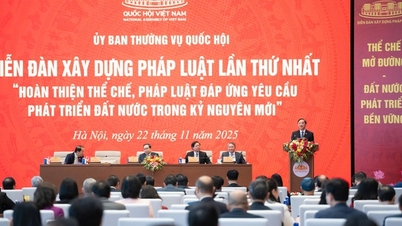

























Comment (0)