Un peu plus d’une semaine après l’éviction du président Mohamed Bazoum, les Nigériens ressentent déjà la douleur économique alors que les prix des biens montent en flèche.
À Maradi, ville animée du sud du Niger, à environ 40 kilomètres de la frontière nigériane, Moutari a été choqué par la flambée du prix du riz après le coup d'État. Il a déclaré que le prix du riz était passé de 11 000 francs CFA (18,30 dollars) le sac à 13 000 francs en quelques jours seulement.
« J'ai encore assez d'argent pour acheter du riz, mais je suis inquiet pour les plus pauvres. Les jours à venir seront très difficiles. Nous ne pouvons que prier pour que tout se passe bien », a-t-il déclaré.
La Communauté économique des États africains (CEDEAO) a imposé le 30 juillet de sévères sanctions au Niger en réponse au coup d'État, notamment la fermeture de ses frontières.
Cette situation a aggravé la situation critique du Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde . Ce pays d'Afrique de l'Ouest est déjà dépendant des importations, notamment de produits de base essentiels comme le riz. En raison de son enclavement, les importations sont souvent acheminées par voie terrestre via les pays voisins.

Les forces de sécurité nigériennes dispersent des manifestants devant l'ambassade de France à Niamey, le 30 juillet. Photo : Reuters
Le gouvernement nigérien, soutenu par le coup d'État, a rouvert ses frontières avec plusieurs pays voisins le 1er août après avoir fermé toutes les frontières et l'espace aérien le jour du renversement du président Bazoum le 26 juillet. Les personnes et les marchandises peuvent voyager vers l'Algérie, la Libye et le Tchad, qui ne sont pas membres de la CEDEAO, ainsi que vers les deux membres de la CEDEAO qui ont soutenu le coup d'État, le Mali et le Burkina Faso.
Mais les frontières clés avec le Bénin et le Nigéria restent fermées en raison des sanctions de la CEDEAO. Les ports atlantiques de ces deux pays sont essentiels pour l'importation et l'exportation de marchandises du Niger, selon Abdoul Aziz Seyni, économiste à l'Université de Niamey.
« Nous ne sommes pas un pays avec accès à la mer. Tout ce que nous achetons transite par les ports des pays voisins, puis est acheminé vers le Niger. La fermeture des frontières de ces pays a donc un impact considérable sur la vie socio-économique des Nigériens », a déclaré Seyni.

Localisation du Niger et des pays voisins. Infographie : AFP
Moussa Halirou, chauffeur de transport de passagers sur la ligne Maradi-Nigéria, a ressenti les effets de la fermeture de la frontière avec le Nigéria. Les prix du carburant au marché noir ont grimpé en flèche, réduisant ses profits. Avant le coup d'État, il payait 350 nairas nigérians (environ 0,45 dollar) pour un litre d'essence, contre 620 nairas aujourd'hui.
Halirou a déclaré que même lorsqu'il augmentait ses tarifs pour compenser les coûts de carburant, il ne gagnait toujours qu'environ 4 500 nairas par voyage.
Avant le coup d'État, environ 1 000 véhicules circulaient chaque jour entre le port béninois de Cotonou et la capitale nigérienne, Niamey. C'était l'un des postes-frontières les plus fréquentés d'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, ces déplacements ont disparu.
"Même quand le camion est chargé, il reste bloqué à la frontière", a déclaré Salissou Idrissa, l'un des nombreux chauffeurs bloqués au poste-frontière de Malanville, en attendant de traverser la frontière du Bénin vers le Niger.

Un Nigérien se tient devant la tente de fortune dans laquelle il vit avec sa famille à Niamey, le 31 juillet. Photo : AP
Le Nigeria a coupé l'alimentation électrique du Niger, dont l'approvisionnement énergétique dépend fortement de son voisin. De fait, de nombreux districts subissaient des coupures de courant régulières avant le coup d'État, et un Nigérien sur cinq avait accès à l'électricité, selon la Banque mondiale.
Les sanctions de la CEDEAO ont suspendu les échanges commerciaux et financiers entre le Niger et les États membres du bloc économique ouest-africain. Elles ont également gelé les avoirs du Niger dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO. Le bloc a menacé de recourir à la force si le président Bazoum n'était pas rétabli au pouvoir.
La CEDEAO regroupe 15 pays africains : le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Sénégal, la Sierra Leone, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Nigéria et le Togo. Cependant, le Mali et le Burkina Faso, deux pays actuellement sous régime militaire , ont été suspendus de la CEDEAO à la suite de coups d’État.
Les Nigériens peinent à faire face à la flambée des prix dans un contexte d'instabilité économique et politique. Recouvert aux deux tiers de désert, le Niger souffre d'une grave sécheresse et dispose de peu de terres arables. Environ 4,3 millions de personnes, soit 17 % de la population, dépendent des subventions alimentaires.
Le pays reçoit chaque année 2 milliards de dollars d’aide publique au développement, dont environ 40 % du budget gouvernemental provient de l’aide étrangère.
Un porte-parole de l'ONU a déclaré que les opérations humanitaires n'avaient pas été perturbées. Cependant, certains des principaux donateurs du Niger, dont l'Union européenne (UE), l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ont réduit divers types d'aide au développement et leurs budgets à la suite du coup d'État.
Bien que le coup d'État ait aggravé la situation du Niger, certains soutiennent le changement. « Les Nigérians ne peuvent plus vivre comme avant. Il est temps de changer. Et le changement est arrivé », a déclaré Seydou Moussa, partisan du coup d'État à Niamey.
Parallèlement, certains s'inquiétaient de l'avenir. « La plupart des ménages accumulent des choses. En quelques jours, le prix de certains articles a augmenté de 3 000 à 4 000 francs CFA (5 à 6 dollars). Sera-t-il le même dans un mois ? »
Thanh Tam (selon DW, AP )
Lien source






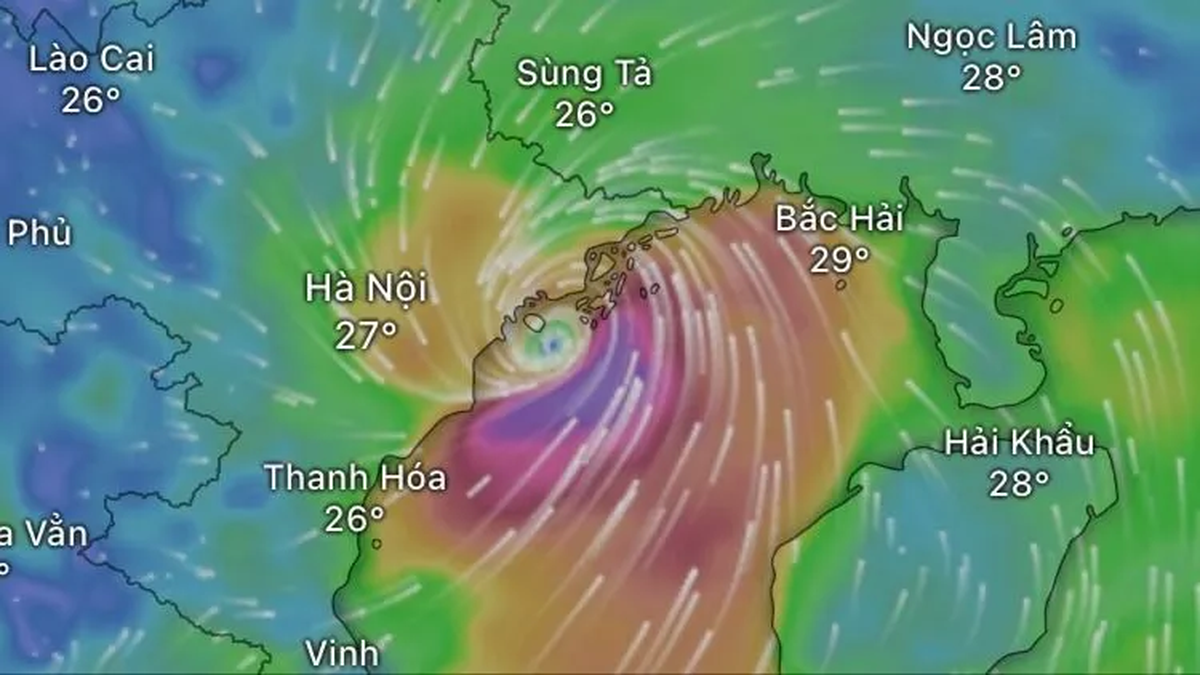































































































Comment (0)