Beaucoup mais pas forts
L'histoire de la Coopérative de légumes et de fleurs de Dong Che (quartier de Hoanh Bo) en est un exemple typique. Créée il y a plus de 15 ans, cette coopérative a contribué à créer une image de marque pour la région de culture de fleurs et de légumes de Dong Che. Cependant, après tout ce temps, la coopérative ne dispose toujours pas de bureau, n'a aucun lien de production, n'organise pas la consommation des produits ni les services logistiques pour ses membres. L'État a soutenu la construction de routes internes, de serres et la fourniture de plants… mais tout cela n'a été qu'une attente, insuffisante pour créer une organisation économique véritablement cohérente.
Mme Vu Thi Huong, directrice adjointe de la coopérative de légumes et de fleurs de Dong Che, a déclaré : « Les membres de la coopérative produisent et consomment principalement pour eux-mêmes. » Les autres activités communes du collectif consistent en des réunions régulières deux fois par an pour discuter des variétés de fleurs et des moyens de prévenir les parasites et les maladies afin que les fleurs puissent pousser à temps pour le Têt.

Une situation similaire s'est produite à la Coopérative de services agricoles de Ha Tan (quartier de Ha Tu). Fondée en 1992, la coopérative était autrefois réputée pour sa production maraîchère sûre, mais elle est aujourd'hui confrontée à de nombreuses difficultés. L'urbanisation galopante et la suspension prolongée de la planification ont entraîné une diminution croissante de la superficie cultivée.
« La production à petite échelle ne suffit pas à répondre aux commandes importantes, ce qui rend quasiment impossible tout investissement pour améliorer la production. Conséquence inévitable : les revenus des membres sont instables, même si nous œuvrons pour une production agricole propre et la sécurité alimentaire », a déclaré M. Le Van Xuan, directeur de la Coopérative de services agricoles de Ha Tan.
Ces exemples ne représentent qu'un aperçu du paysage actuel des centaines de coopératives de la province. Selon le rapport de l'Union provinciale des coopératives, bien que la main-d'œuvre coopérative représente près de 11 % de la main-d'œuvre totale de la province (soit 74 000 personnes), l'efficacité opérationnelle reste insuffisante. Le chiffre d'affaires moyen d'une coopérative n'est que de 870 millions de VND par an, le bénéfice d'environ 300 millions de VND et le revenu moyen par membre de 5,6 millions de VND par mois, soit un niveau bien inférieur au revenu moyen de l'ensemble de la province. Il est à noter que la province compte jusqu'à 377 coopératives ayant cessé leurs activités, en attente de dissolution ou n'ayant pas encore démarré. Sur les 710 coopératives actuellement en activité, seules 230 affichent une bonne performance productive et commerciale, soit 32,4 % ; les autres affichent généralement un faible niveau d'activité.
Supprimer le goulot d'étranglement qui freine l'économie collective
En réalité, on sait que la principale cause de cette situation réside dans la petitesse du modèle organisationnel, le manque de ressources financières et l'absence d'espaces de production stables. Moins de 5 % des coopératives disposent de terrains pour leur siège social ; la plupart opèrent au domicile de leurs membres ou en location temporaire. Outre les limitations internes, les insuffisances des politiques et de leur mise en œuvre en sont également la cause.
Parmi les dix groupes de politiques de soutien aux coopératives énoncés dans le Programme d'action n° 22-CTr/TU du Comité provincial du Parti, de nombreuses mesures n'ont pas été efficacement mises en œuvre ou manquent de spécificité pour le secteur de l'économie collective. Les politiques de crédit restent limitées et il n'existe pas de fonds provincial de soutien au développement des coopératives. Les conditions de prêt offertes par les banques de développement ne sont pas vraiment attractives. Un autre problème réside dans le manque de cohérence de la gestion et du soutien de l'État aux coopératives. De l'enregistrement des entreprises au suivi, à l'évaluation, à la gestion et à la supervision, tout est dispersé entre les départements, les branches et les localités.

Selon le président de l'Union des coopératives provinciales, Ngo Tat Thang, en tant qu'agence permanente conseillant et soutenant le développement de l'économie collective, l'Union des coopératives travaille également avec les agences concernées pour se concentrer sur de nombreuses solutions spécifiques : renforcer et perfectionner l'appareil de gestion coopérative ; définir clairement les ressources, la structure du capital et la structure d'investissement ; renforcer la gestion financière, la comptabilité transparente et proposer des politiques d'assurance contre les risques pour le secteur agricole.
Parallèlement à cela, il est nécessaire de promouvoir la transformation numérique, de compléter une base de données commune pour une gestion plus efficace ; d'appliquer de manière synchrone les normes techniques dans la production, en particulier pour les infrastructures d'aquaculture marine ; d'émettre des codes pour les zones de plantation et d'élevage ; de réorganiser la chaîne d'approvisionnement en intrants tels que les semences, les aliments pour animaux, la prévention des maladies dans une direction centralisée...
Outre les efforts déployés par les autorités pour perfectionner le mécanisme, soutenir les capitaux, les terres, les sciences et technologies et la formation en gestion, le plus important reste le changement proactif au sein de chaque coopérative : coopération approfondie, liens étroits, application des avancées techniques et orientation vers le marché. À ce moment-là, la multiplication des coopératives ne sera plus seulement une statistique, mais constituera un fondement solide pour l'économie des ménages, des agriculteurs, des pêcheurs et des petits commerçants, contribuant ainsi à promouvoir une économie verte, circulaire et durable.
Source : https://baoquangninh.vn/phat-trien-htx-can-ca-so-luong-va-chat-luong-3371859.html









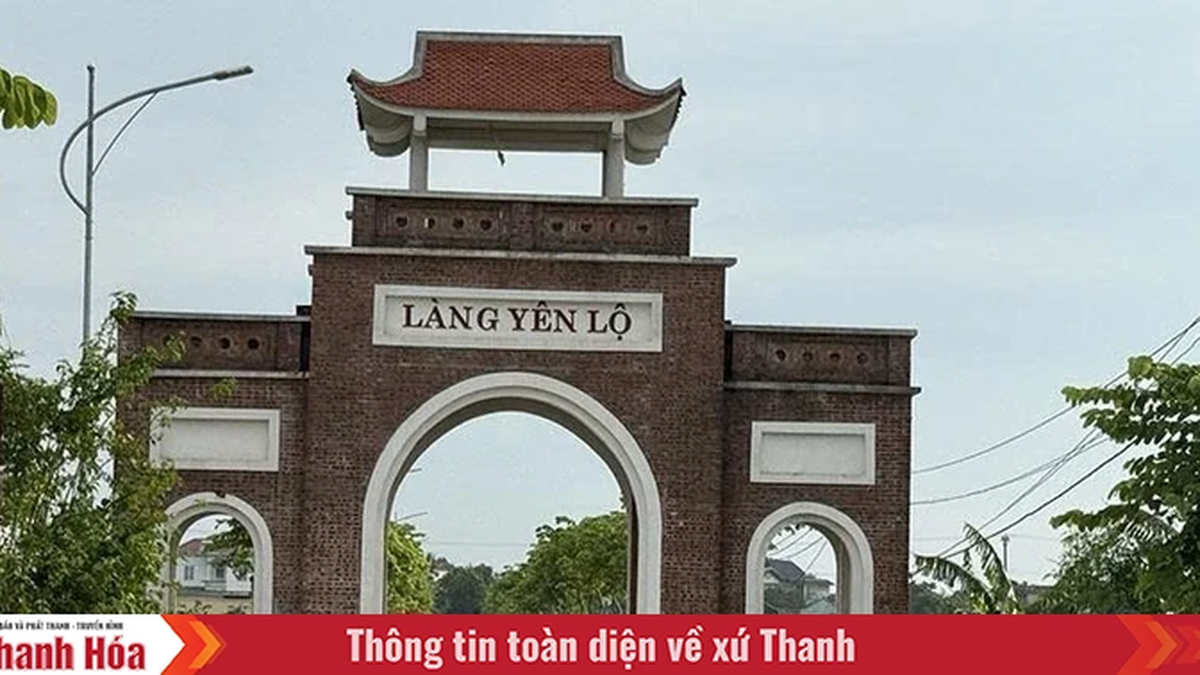















![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à la cérémonie d'ouverture du Centre national de données](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/18/b5724a9c982b429790fdbd2438a0db44)






















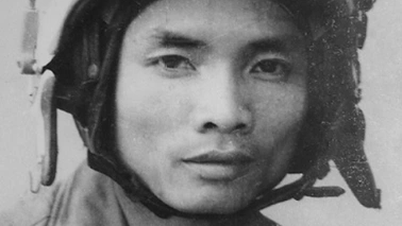












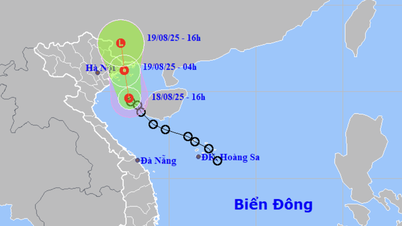












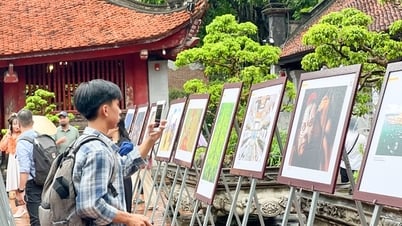

























Comment (0)