
Cette tendance se traduit par le maintien aux États-Unis de droits de douane élevés sur les produits chinois, l'adoption de lois telles que le CHIPS et le Science Act, dont l'objectif affiché est la réindustrialisation, et les efforts déployés pour contrôler les technologies clés. L'Union européenne (UE) ne fait pas exception à cette tendance avec sa politique d'autonomie stratégique fondée sur le Pacte vert pour l'Europe et les mesures visant à protéger son marché intérieur. L'Inde impose également des droits de douane sur les panneaux solaires importés depuis 2018 afin d'empêcher l'afflux de produits similaires en provenance de Chine.
Les mesures non tarifaires, ou barrières techniques, telles que les mesures sanitaires et phytosanitaires, se généralisent. D’ici 2022, plus de 70 % du commerce mondial sera soumis à des barrières techniques. En imposant des réglementations spécifiques sur la nature du produit ou son mode de production, ces mesures créent de fait des obstacles à l’importation de produits non conformes aux nouvelles règles. L’UE a appliqué avec vigueur cette politique pour protéger son secteur agricole national, 90 % des échanges agricoles étant soumis à ces conditions. Ces mesures restrictives constituent une exception au principe de la nation la plus favorisée et sont contraires au multilatéralisme prôné par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
La Chine a été particulièrement touchée par la montée du protectionnisme. Son adhésion à l'OMC en 2001 a été synonyme de forte croissance des exportations, grâce à la réduction significative des droits de douane (en vertu de la clause de la nation la plus favorisée). Cependant, depuis la crise financière de 2008, cette puissance asiatique est devenue une cible privilégiée des membres de l'OMC. En 2019, 45 % des importations mondiales étaient affectées par des mesures protectionnistes temporaires liées à la Chine, contre 14 % en 2001. Cette proportion n'a cessé d'augmenter en raison des tensions commerciales sino-américaines, qui se sont intensifiées depuis le premier mandat du président américain Donald Trump (2017-2021).
La dernière décennie a également été marquée par une évolution dans l'utilisation de la politique commerciale. Les justifications classiques de la protection de l'industrie nationale ont désormais cédé la place à des arguments politiques et, plus largement, géopolitiques. Le premier mandat de M. Trump à la présidence en est un parfait exemple, illustrant le lien étroit entre politique commerciale et programme électoral. Il a bâti sa campagne médiatique autour du slogan « L'Amérique d'abord » pour remporter l'élection présidentielle américaine de 2017 à 2021, et a été réélu lors de la dernière élection présidentielle avec le slogan « Rendre sa grandeur à l'Amérique ».
Enfin, on constate que les pays utilisent de plus en plus des instruments non traditionnels qui, à première vue, ne semblent pas être de nature protectionniste, mais qui ont un impact protectionniste très significatif. Par exemple, la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), adoptée par le gouvernement américain en juillet 2022, permet aux ménages et aux entreprises américains de bénéficier de subventions pour la consommation et la production de véhicules électriques. Mais sous couvert de promouvoir l'industrie automobile verte, cette loi accorde des subventions publiques assorties de dispositions préférentielles nationales. De même, l'UE s'est dotée de nouveaux instruments commerciaux lui permettant d'adopter des mesures visant à renforcer ses politiques protectionnistes internes en réponse aux pressions extérieures.
Les opportunités et les défis s'entremêlent.
Les politiques protectionnistes ont entraîné une restructuration complète de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les entreprises privilégient désormais la sécurité à l'optimisation des coûts. Trois grandes tendances se dessinent à l'échelle mondiale : la délocalisation de la production vers des partenaires de confiance (friendshoring), le rapprochement de la production des marchés de consommation (nearshoring) et le rapatriement des lignes de production (re-shoring).
Cette reconfiguration délibérée des échanges commerciaux à des fins de sécurité impose une logique de proximité croissante, tant géographique que de valeur, donnant ainsi corps aux concepts de nearshoring ou de friendshoring. De fait, les États-Unis souhaitent se rapprocher et construire des chaînes de valeur sur leur territoire continental dans le cadre de l'Accord États-Unis-Canada-Mexique (AEUMC). En Asie, conformément à l'idée de mondialisation entre alliés, les États-Unis privilégient les échanges commerciaux avec leurs partenaires – le Japon, la Corée du Sud et Taïwan (Chine) – notamment en matière de technologies clés telles que les puces de dernière génération.
La tendance à la démondialisation présente à la fois des opportunités et des défis. Parmi les aspects positifs, elle contribue à renforcer la sécurité des chaînes d'approvisionnement, à promouvoir le développement industriel national et à réduire la dépendance à l'égard d'un fournisseur unique. Toutefois, il est indéniable qu'elle a des conséquences négatives : hausse des coûts de production, inflation plus élevée et baisse de l'efficacité économique dues à la perte de spécialisation et d'échelle.
Selon Isabelle Job-Bazille, directrice de la recherche économique chez Crédit Agricole, si les événements récents ont mis en évidence une tendance protectionniste plus marquée, la mise en œuvre de mesures protectionnistes semble également devenue plus complexe et incertaine pour les gouvernements, compte tenu de l'imbrication des chaînes de valeur internationales. Dès lors, il est difficile de savoir si l'économie qui adopte des politiques protectionnistes finira par supporter des coûts supplémentaires supérieurs à ceux des économies initialement visées.
Par exemple, une étude récente des économistes américains Mary Amiti, Stephen Redding et David Weinstein a montré qu'en 2018, durant les mesures protectionnistes de l'administration Trump, les marges bénéficiaires des entreprises exportant vers les États-Unis sont restées inchangées, car l'intégralité de la hausse des droits de douane a été répercutée sur le prix de vente. De ce fait, ce sont les consommateurs et les entreprises américaines important les biens nécessaires à leur production qui ont supporté le coût de ces droits de douane protectionnistes, estimé à près de 4 milliards de dollars par mois.
Ainsi, les mesures protectionnistes, sous forme de droits de douane, mises en œuvre sous la présidence de Donald Trump, ont fait grimper les prix des produits chinois importés aux États-Unis. Ce sont les consommateurs américains et les entreprises importatrices qui en supportent le coût, et non les entreprises ou les pays exportateurs. Ceci met en lumière l'incompatibilité potentielle entre les objectifs des gouvernements et ceux des entreprises. La géopolitique relève de la compétence des gouvernements, mais sa traduction en relations économiques dépend du comportement des entreprises, souvent multinationales.
À l'avenir, la tendance protectionniste devrait se poursuivre et s'accentuer dans les années à venir. La période 2024-2025 sera marquée par la poursuite des politiques protectionnistes et la restructuration des chaînes d'approvisionnement. D'ici 2026-2030, on peut observer la mise en place d'un ordre commercial multipolaire, avec des chaînes d'approvisionnement régionales et un nouvel équilibre dans les relations économiques internationales. Dans ce contexte, les pays doivent élaborer des stratégies industrielles nationales adaptées, diversifier leurs relations commerciales et investir massivement dans les technologies et les ressources humaines.
L’enjeu est de trouver un juste équilibre entre protectionnisme et ouverture, entre sécurité et efficacité. Pour les entreprises, le moment est crucial pour adapter leurs stratégies. Il est nécessaire de diversifier les chaînes d’approvisionnement, de promouvoir la numérisation et l’automatisation, et de développer le marché intérieur comme rempart contre les fluctuations extérieures.
La démondialisation et le protectionnisme commercial ne signifient pas la fin de la coopération internationale. Au contraire, le monde assiste à une transition vers un nouveau modèle, qui concilie intégration et autonomie, efficacité et sécurité. Le défi pour la communauté internationale est de gérer efficacement cette transition, d'éviter les conflits inutiles et de garantir un ordre économique mondial juste et durable pour tous.
Article final : Affirmer la position du Vietnam sur le marché mondial
Source : https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/trien-vong-tang-truong-tu-mot-the-gioi-bien-dong-bai-4-xu-huong-len-ngi-cua-chu-nghia-bao-ho-va-phi-toan-cau-hoa/20241206102115459





![[Photo] Clôture de la 14e Conférence du 13e Comité central du Parti](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/06/1762404919012_a1-bnd-5975-5183-jpg.webp)


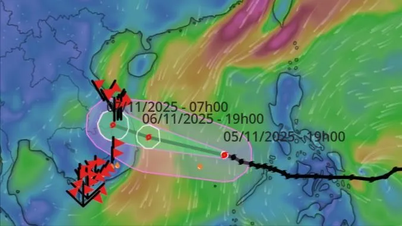









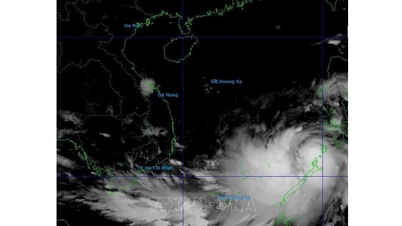





























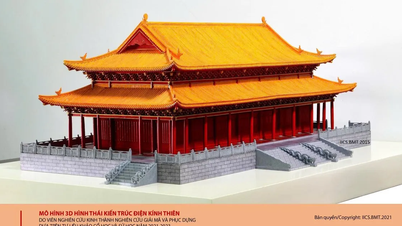






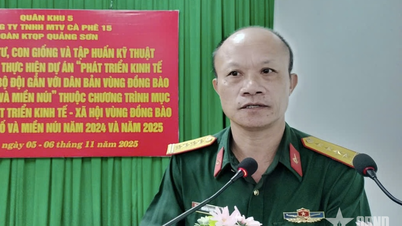

























































Comment (0)