
Les experts affirment que cette exigence est urgente dans le contexte des pluies extrêmes et des inondations qui ont dépassé de nombreux scénarios de conception, et que le système d'exploitation actuel présente encore des limitations qu'il convient de surmonter de toute urgence.
Le professeur Nguyen Quoc Dung, vice-président permanent de l'Association vietnamienne des grands barrages et du développement des ressources en eau, a estimé que les pluies récentes présentaient des caractéristiques exceptionnelles, « dépassant un niveau qui ne se produit qu'une fois tous les quelques décennies ». Ces pluies, non seulement très abondantes, ont également persisté pendant plusieurs jours consécutifs. En hydrologie, les crues prolongées sont les plus dangereuses : elles surviennent lorsque les réservoirs sont pleins, que les zones basses sont saturées, que les forêts ne peuvent plus absorber l'eau et que la majeure partie des eaux pluviales s'écoule en aval, réduisant considérablement la capacité de drainage du bassin.
Plus inquiétant encore, de nombreuses régions ont enregistré le phénomène de « double crue », c'est-à-dire qu'une crue n'a pas encore reflué mais que la suivante est déjà arrivée, or la plupart des opérations actuelles de gestion des réservoirs sont encore basées sur le modèle de la crue unique, et ne peuvent donc pas suivre l'évolution réelle de la situation.
Face à la situation de nombreux réservoirs relâchant simultanément de l'eau lors de la montée des eaux, le professeur Nguyen Quoc Dung a déclaré que la principale difficulté réside actuellement dans le fait que « personne ne conseille au président provincial de procéder à des lâchers d'eau anticipés », malgré les prévisions de fortes pluies. Par temps calme, demander l'ouverture des vannes deux à trois jours à l'avance est une décision très difficile, d'autant plus que de nombreux services locaux manquent d'experts en hydrologie et en hydraulique et n'ont pas les capacités nécessaires pour analyser les scénarios d'écoulement et formuler des recommandations. En revanche, au Japon et en Chine, chaque région dispose d'un service hydrologique opérationnel 24 h/24 et 7 j/7 pendant la saison des crues.
M. Nguyen Quoc Dung a déclaré que si le Vietnam n'a pas encore mis en place ce modèle de manière formelle, il peut envisager de socialiser les services de conseil afin de favoriser des décisions plus opportunes et plus scientifiques en matière d'exploitation des réservoirs.
L'un des principaux obstacles à la coordination actuelle de la gestion des réservoirs réside dans la divergence des objectifs entre l'hydroélectricité et l'irrigation. L'hydroélectricité étant liée à la sécurité énergétique, abaisser le niveau d'un réservoir pour recevoir les crues comporte toujours un risque de pénurie d'eau pour la production d'électricité en cas d'absence de pluie. Ce fut le cas pour le réservoir de Hoa Binh en 2017.
De nombreux experts ont proposé la solution de « l’achat de capacités de prévention des inondations », qui consiste à utiliser le fonds de prévention des catastrophes naturelles pour compenser les pertes de production d’électricité ou les coûts supportés par le propriétaire du réservoir lorsqu’il doit relâcher de l’eau prématurément pour prévenir les inondations. Selon M. Nguyen Quoc Dung, cette solution est considérée comme un moyen d’harmoniser les intérêts et d’encourager les propriétaires de réservoirs à participer activement, de manière volontaire et transparente, aux actions de prévention des inondations.
En réalité, le fonctionnement des réservoirs intermédiaires dans notre pays se divise en trois périodes : début, milieu et fin de saison. En début de saison, il est nécessaire d’abaisser le niveau d’eau pour absorber les crues ; en milieu de saison, le débit de sortie ne doit pas excéder le débit entrant ; et en fin de saison, il faut stocker suffisamment d’eau pour la saison sèche. Or, cette année, les crues sont survenues de manière inhabituelle et fréquente en fin de saison, alors que de nombreux réservoirs étaient déjà remplis, réduisant ainsi leur capacité de rétention.
D'après les experts, dans ce contexte, les réservoirs d'irrigation et les réservoirs hydroélectriques doivent renforcer leur coordination, et le commandement de la protection civile, à tous les niveaux, doit promouvoir ce rôle. La capacité totale des réservoirs du pays s'élevant à environ 70 milliards de m³, dont près de 55 milliards de m³ de réservoirs hydroélectriques, la lutte contre les inondations ne peut reposer uniquement sur le système de réservoirs d'irrigation.
M. Nguyen Tung Phong, directeur du Département de la gestion et de la construction des ouvrages d'irrigation ( ministère de l'Agriculture et de l'Environnement ), a déclaré qu'avant chaque prévision de fortes pluies, son département exigeait des collectivités locales qu'elles vident les systèmes d'irrigation. Parallèlement, les réservoirs sont équipés de vannes de régulation permettant d'ajuster leur niveau d'eau afin de gérer les crues de manière proactive, garantissant ainsi la sécurité des ouvrages et évitant les débordements susceptibles de mettre en danger les zones situées en aval. Lors des récentes inondations, de nombreux grands réservoirs d'irrigation, tels que Cam Son, Nui Coc et Ta Trach, ont fonctionné conformément à cette procédure et ont contribué efficacement à la réduction des crues. Certains réservoirs ont même réduit leur débit de plusieurs dizaines de pour cent par rapport à leur débit d'entrée.
L'expérience acquise au réservoir de Cua Dat ( Thanh Hoa ) démontre que, grâce à des prévisions fiables et au strict respect du plan, la gestion proactive des crues donne des résultats probants. M. Le Ba Huan, chef du département de gestion des travaux, responsable de la branche de Cua Dat (Conseil des investissements et de la construction des systèmes d'irrigation n° 3), a déclaré que le niveau d'eau du réservoir avait été abaissé de manière proactive, permettant ainsi d'éviter d'importantes crues lors de nombreuses tempêtes. Par exemple, lors de la troisième tempête, le réservoir a retenu 530 millions de m³, réduisant le débit de pointe de 3 546 m³/s. Lors de la cinquième tempête, grâce à ces lâchers d'eau anticipés, une capacité supplémentaire de 192 millions de m³ a été créée pour prévenir les inondations. À l'arrivée de la tempête, le réservoir a continué à retenir 219 millions de m³, réduisant le débit de pointe de plus de 3 000 m³/s. Avant la tempête n° 10, le réservoir a abaissé son niveau d'eau de près de 4,3 m, créant 116 millions de m³ et lorsque l'inondation est arrivée, il a retenu 145 millions de m³ supplémentaires, réduisant le pic de crue de près de 4 000 m³/s.
M. Huan a également déclaré que le lac Cua Dat possède encore un grand potentiel en matière de prévention des inondations, notamment en ce qui concerne sa capacité à partir d'une altitude de +110 m et plus, soit environ 257,2 millions de m³, et a proposé que la province de Thanh Hoa autorise une utilisation flexible de cette capacité dans le contexte de pluies et d'inondations de plus en plus extrêmes.
Mais il ne s'agit là que de grands réservoirs, dotés d'investissements dans des systèmes de recherche, des applications scientifiques de pointe et un système de base de données complet. L'efficacité globale des réservoirs « n'a pas encore atteint les objectifs fixés », notamment pour les réservoirs d'irrigation équipés uniquement de déversoirs libres, sans vannes de régulation. Les grands réservoirs, disposant d'équipes de consultants compétentes, n'hésitent souvent pas à abaisser leur niveau d'eau pour faire face aux crues, tandis que de nombreux petits réservoirs se contentent de maintenir leur niveau normal afin d'éviter les pénuries d'eau pendant la saison sèche.
Selon les experts, lors de l'approbation de barrages hydroélectriques, l'objectif premier est la production d'électricité. Dans le contexte actuel, il est nécessaire de modifier la réglementation afin d'harmoniser les intérêts de toutes les parties prenantes. La gestion des ressources en eau doit s'effectuer de l'amont vers l'aval, indépendamment du secteur concerné. Cette gestion doit s'appuyer sur les bassins versants, et non sur les limites administratives, pour parvenir à une solution globale de régulation de l'eau. Les barrages doivent répondre à de multiples objectifs, mais le premier est de réduire efficacement les risques d'inondation pour les zones situées en aval, le second est d'assurer la sécurité du projet, et enfin de fournir l'eau nécessaire au développement économique .
Selon le professeur agrégé Hoang Thai Dai, de l'Association vietnamienne des ressources en eau, le principe de la gestion intégrée par bassin hydrographique est proposé depuis de nombreuses années, mais le rôle des comités de gestion de bassin reste flou. Une gestion intégrée des ressources en eau nécessite une harmonisation des niveaux central et local, ainsi qu'une coordination intersectorielle.
La demande formulée dans la circulaire officielle n° 225/CD-TTg du Premier ministre, relative à la gestion des conséquences des pluies exceptionnellement abondantes et des inondations dans la région Centre, souligne l'importance d'une étroite coordination entre le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et le ministère de l'Industrie et du Commerce afin de prioriser la réduction des débits de crue et la protection des zones et des populations en aval. Face à des épisodes de fortes pluies et d'inondations, la mise en œuvre de différents scénarios, l'amélioration des capacités de prévision et d'exploitation, le recours à des consultants spécialisés et une gestion unifiée par bassin hydrographique constituent la solution pour minimiser les dégâts et garantir la sécurité des populations.
Source : https://baotintuc.vn/kinh-te/uu-tien-giam-xa-lu-phat-huy-hieu-qua-trong-van-hanh-lien-ho-chua-20251122120705945.htm




































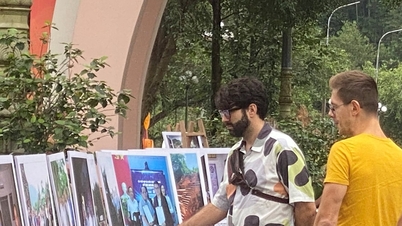














































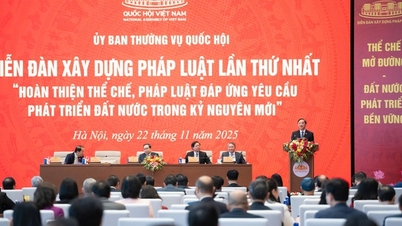

























Comment (0)