Les relations entre les États-Unis et l'Iran, autrefois proches alliés au début de la guerre froide, se sont transformées en une confrontation qui dure depuis des décennies.
 |
| Le roi iranien Mohammad Reza Pahlavi (deuxième à partir de la gauche) rencontre le président américain Jimmy Carter (deuxième à partir de la droite) en 1977. (Source : Alamy) |
Malgré ses causes profondes, la prise d'otages choquante d'il y a 45 ans peut être considérée comme la « goutte d'eau qui a fait déborder le vase » et qui a plongé les relations américano-iraniennes dans un profond fossé.
Autrefois alliés
Au vu des tensions actuelles entre les États-Unis et l'Iran, rares sont ceux qui croient que ces deux pays étaient autrefois les alliés les plus proches lors de la confrontation de la Guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale.
À cette époque, l'Iran, sous le règne du Shah Pahlavi, était considéré comme un « ami indispensable » des États-Unis, une source importante de pétrole pour Washington ainsi qu'un « avant-poste » contre l'influence soviétique dans la région.
Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont soutenu le Shah dans son maintien au pouvoir, allant même jusqu'à appuyer le coup d'État de 1953 qui a renversé le Premier ministre iranien élu Mohammed Mossadegh, lequel avait nationalisé l'industrie pétrolière.
L'ingérence américaine dans la politique iranienne, conjuguée à la monarchie de plus en plus autocratique dans ce pays du Moyen-Orient, a provoqué le mécontentement parmi la population, conduisant à la révolution islamique « bouleversante » de 1979.
Le grand ayatollah Khomeini, qui avait été expulsé par le roi Pahlavi en 1964, est revenu en Iran pour mener le peuple iranien dans une révolution, renversant la monarchie et transformant le pays en république islamique.
Bien que surpris par ce changement, les États-Unis n'ont pas immédiatement confronté l'Iran. Ce n'est qu'en novembre 1979 qu'une véritable crise diplomatique a éclaté entre les deux pays, après la prise d'otages par des étudiants iraniens de 63 personnes à l'ambassade américaine à Téhéran, dont le chargé d'affaires.
La goutte d'eau qui fait déborder le vase
Le 4 novembre 1979, environ 500 étudiants iraniens, membres de l'organisation « Suiveurs des étudiants musulmans », ont attaqué l'ambassade des États-Unis et pris 63 otages. La principale raison invoquée était que le gouvernement de Washington avait autorisé le Shah Pahlavi, déchu du pouvoir, à se rendre aux États-Unis pour y recevoir un traitement contre le cancer.
Selon la chaîne américaine History Channel, l'attaque n'était pas seulement liée aux soins médicaux du roi Pahlavi ; il s'agissait, pour les étudiants révolutionnaires iraniens, d'une manière de rompre avec le passé, d'affirmer le droit à l'autodétermination de la République islamique et de mettre fin à l'ingérence américaine. L'ayatollah Khomeini, chef du gouvernement iranien, a refusé toutes les demandes internationales, y compris celles des Nations Unies, de libérer les otages.
Après deux semaines de captivité, l'Iran a accepté de libérer les personnes non américaines, les femmes et les minorités, mais les 52 Américains restants sont demeurés captifs pendant les 14 mois suivants. Les images des otages, les yeux bandés et ligotés, ont suscité l'indignation aux États-Unis et ont contraint le gouvernement à prendre des mesures fermes.
En février 1980, l'Iran exigea l'extradition du Shah Pahlavi par les États-Unis afin qu'il soit jugé à Téhéran et qu'il présente des excuses pour ses actes passés. Le président américain Jimmy Carter refusa, puis rompit les relations diplomatiques avec l'Iran, imposa des sanctions économiques et gela les avoirs de ce pays du Moyen-Orient.
La crise des otages a marqué le début d'une relation tendue entre les États-Unis et l'Iran, transformant leur alliance en rivalité. Depuis lors, le gel des relations bilatérales persiste, reflétant les fluctuations des relations internationales et de la politique.
| En 2015, 36 ans après l'enlèvement, chaque otage de cette crise a reçu 4,4 millions de dollars d'indemnisation de la part des États-Unis. |
Sauvetage raté
Sous la pression exercée pour libérer les otages, le président Jimmy Carter demanda au département de la Défense des États-Unis d'élaborer un plan d'action. L'opération « Griffe d'aigle » fut confiée à la Delta Force, l'unité d'élite des commandos américains.
L'opération, qui s'est déroulée sur deux nuits à partir du 24 avril 1980, a mobilisé plusieurs unités militaires américaines, dont l'armée de l'air, la marine, l'armée de terre et les Marines.
Selon le plan, la première nuit, huit hélicoptères devaient décoller du porte-avions USS Nimitz, en mer d'Arabie, pour rejoindre Desert 1, une zone secrète du centre de l'Iran, afin de récupérer l'équipe Delta en provenance d'une base à Oman. Les huit hélicoptères devaient transporter l'équipe Delta jusqu'à Desert 2, à 80 km au sud de Téhéran, pour s'y cacher et attendre le moment opportun pour agir. La deuxième nuit, l'équipe devait se rendre en camion à Téhéran pour infiltrer l'ambassade américaine et libérer les otages.
Cependant, l'opération ne s'est pas déroulée comme prévu. Arrivés à Desert 1, les hélicoptères ont rencontré des problèmes techniques et l'opération a dû être annulée. Lors du repli, un C-130 transportant du carburant et des soldats est entré en collision avec un avion de transport militaire EC-130E, provoquant une violente explosion qui a coûté la vie à huit soldats. L'opération « Griffe d'aigle » a échoué et aucun otage n'a pu être libéré.
Le 27 juillet 1980, le Shah Pahlavi décède au Caire. Les étudiants islamiques déclarent qu'ils ne libéreront pas les otages tant que les biens du Shah ne seront pas restitués. En septembre 1980, l'ayatollah Khomeini pose quatre conditions à la libération des otages : la restitution des biens de Pahlavi par les États-Unis, le déblocage des avoirs iraniens gelés, la levée des sanctions et l'engagement de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Iran.
De nombreux historiens estiment que la crise des otages en Iran a empêché Jimmy Carter d'accéder à un second mandat présidentiel. L'ancien président américain lui-même a également déclaré que l'échec de l'opération « Griffe d'aigle » avait largement contribué à la victoire de son adversaire républicain, Ronald Reagan, lors de l'élection de 1980.
 |
| Les otages sont rentrés aux États-Unis le 25 janvier 1981, cinq jours après leur libération par l'Iran. (Source : Département de la Défense des États-Unis) |
La diplomatie intervient
Le rôle des diplomates algériens dans la médiation entre les deux parties est largement connu. Mais peu savent que l'Allemagne a également joué un rôle important, révélé plus tard. Le dernier jour de son mandat, le 20 janvier 1981, le président Jimmy Carter déclara : « Les Allemands ont apporté une aide que je ne pourrai jamais révéler publiquement au monde. »
L'historien Frank Bosch et le magazine Die Spiegel ont par la suite mis en lumière cet appel à la générosité, révélant le rôle clé joué par l'ambassadeur d'Allemagne en Iran, Gerhard Ritzel. Nommé ambassadeur d'Allemagne à Téhéran en 1977, alors que le Shah d'Iran était encore au pouvoir, Ritzel a rapidement tissé des liens avec des groupes d'opposition islamistes fondamentalistes, notamment ceux qui allaient accéder au pouvoir après la révolution de 1979.
Après le retour du grand ayatollah Khomeini en Iran et sa prise de pouvoir, M. Ritzel a habilement maintenu le contact, décrivant l'ayatollah Khomeini comme un « humanitaire » et soulignant la possibilité d'une coopération entre l'Occident et le nouveau régime.
Alors que la crise des otages s'éternisait et s'intensifiait, l'Allemagne a joué un rôle clé dans les négociations secrètes.
Téhéran craignait des représailles de Washington et souhaitait récupérer 12 millions de dollars gelés dans des banques américaines ainsi que les avoirs du Shah. La guerre Iran-Irak, qui éclata le 22 septembre 1980, modifia également la dynamique des négociations, Téhéran se concentrant sur la gestion de cette nouvelle menace.
En mai 1980, de hauts responsables américains, dont le secrétaire d'État Edmund Muskie, ont commencé à contacter l'ambassadeur allemand Ritzel afin de trouver une solution à la crise. M. Ritzel a ensuite rencontré le grand ayatollah Khomeini à Mashhad pour lui transmettre des messages de Washington et tenter de convaincre les dirigeants iraniens.
Environ une semaine plus tard, des négociations secrètes se déroulèrent à la résidence du ministère allemand des Affaires étrangères à Bonn, sous la coordination du ministre allemand des Affaires étrangères, Hans Dietrich Genscher. Grâce à la médiation patiente et habile de l'Allemagne, les parties parvinrent finalement à un accord le 19 janvier 1981, aux termes duquel les États-Unis s'engageaient à lever les mesures de gel des avoirs iraniens en échange de la libération de tous les otages par Téhéran.
Le 20 janvier 1981, jour même de l'investiture de Ronald Reagan comme 40e président des États-Unis, les 52 otages américains furent enfin libérés. Ils furent conduits à la base aérienne américaine de Wiesbaden, en Allemagne, mettant ainsi fin à la plus longue prise d'otages de l'histoire diplomatique américaine.
Selon l'historien allemand Frank Bosch, sans la médiation de ce pays d'Europe centrale, l'accord n'aurait peut-être pas été possible.
La crise des otages en Iran n'est pas seulement une leçon de diplomatie et de conflit politique, mais aussi une démonstration claire du pouvoir de la négociation dans la résolution des conflits internationaux.
Des décennies plus tard, les leçons de 1979 résonnent encore dans les relations américano-iraniennes actuelles et continuent d'être rappelées dans le contexte des défis actuels, tels que l'accord nucléaire de 2015 et les conflits régionaux interminables au Moyen-Orient.
Cependant, la question de savoir si la compréhension et le dialogue peuvent apaiser les désaccords persistants reste ouverte.
Source : https://baoquocte.vn/cu-no-chan-dong-lich-su-tu-ban-hoa-thu-giua-my-va-iran-293741.html




![[Photo] Vénération de la statue de Tuyet Son - un trésor vieux de près de 400 ans à la pagode Keo](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764679323086_ndo_br_tempimageomw0hi-4884-jpg.webp&w=3840&q=75)


![[Photo] Défilé pour célébrer le 50e anniversaire de la fête nationale du Laos](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764691918289_ndo_br_0-jpg.webp&w=3840&q=75)









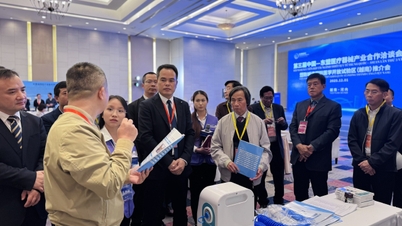















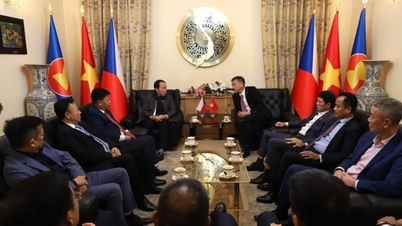







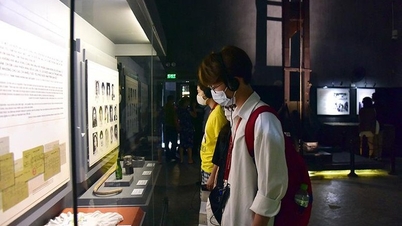


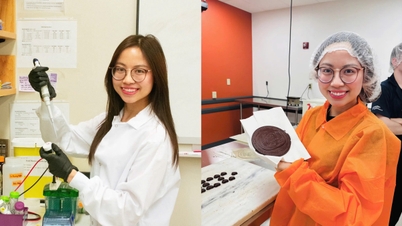


















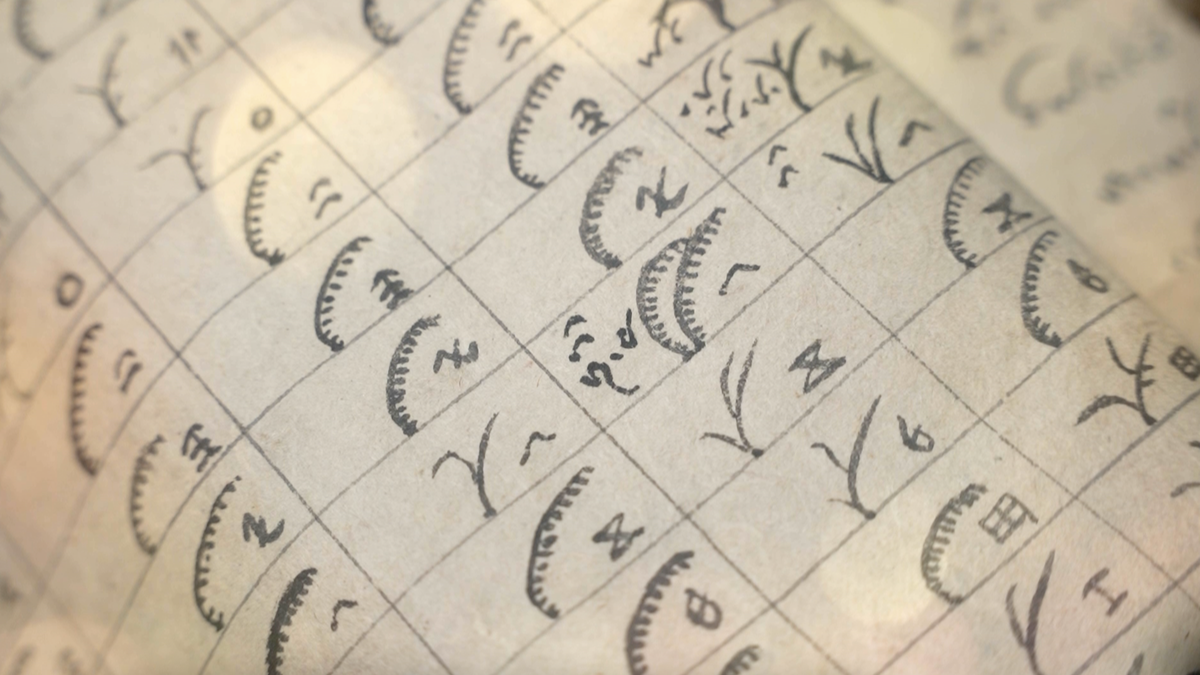





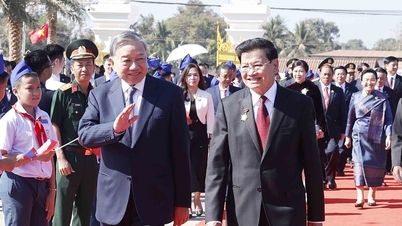







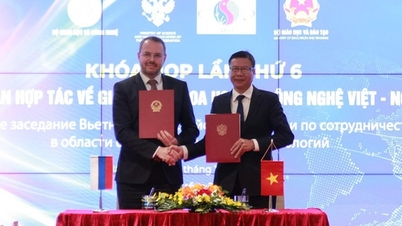













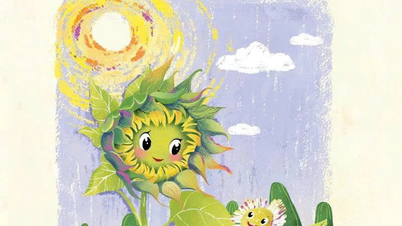















Comment (0)