 |
| Le délégué Nguyen Hai Nam a proposé de rationaliser le système de planification. Photo : Délégation de la ville à l’Assemblée nationale |
Restructuration du contenu de la planification dans une direction rationalisée
Participant à la discussion, le délégué Nguyen Hai Nam (délégation de l'Assemblée nationale de la ville de Hué ) a proposé que, tout d'abord, le système de planification soit rationalisé en l'unifiant en deux niveaux : la planification de zonage et la planification détaillée pour les zones urbaines et rurales.
Selon M. Nam, la réduction du nombre de niveaux permettra d'éviter les redondances de contenu, de simplifier les procédures d'ajustement, de raccourcir le temps de préparation des projets et de réduire les coûts sociaux.
Le délégué Nguyen Hai Nam a également proposé de revoir les éléments nécessaires à l'élaboration des plans détaillés, afin d'éviter les doublons avec les plans techniques et les plans de base. En effet, de nombreux plans détaillés actuels recoupent des documents techniques, ce qui allonge les délais d'évaluation et complexifie les procédures administratives.
Le deuxième point souligné par M. Nam concerne le renforcement de la réglementation en matière d'urbanisme au niveau des arrondissements, niveau de gestion directe de l'espace urbain. Or, il n'existe actuellement aucun type de planification correspondant. De ce fait, les arrondissements sont dépourvus d'outils juridiques pour gérer les ordres de construction, l'embellissement urbain et mettre en œuvre la décentralisation et l'autorisation. Définir clairement les exigences, le champ d'application et les types de planification au niveau des arrondissements permettra d'accroître la proactivité et l'efficacité de la gestion.
Concernant les liens entre la planification fonctionnelle et la planification spécialisée, le délégué Nguyen Hai Nam a proposé de clarifier le périmètre et les objectifs de la planification fonctionnelle, afin d'assurer leur cohérence avec la planification spécialisée (tourisme, agriculture , culture, énergie, etc.). Il existe actuellement de nombreux chevauchements, comme entre la planification urbaine et la planification de l'irrigation, ou encore entre la planification résidentielle et la planification énergétique.
M. Nam a déclaré que le contenu actuel de la planification est encore « trop axé sur les paramètres techniques », alors que de nombreux domaines disposent déjà de normes spécialisées. Les délégués ont proposé de restructurer le contenu de la planification afin de le simplifier et de ne réglementer que l'orientation spatiale, les infrastructures principales, l'utilisation des sols et les modèles de développement, en excluant la « planification par projet » et l'inclusion d'une liste de projets spécifiques. Cette approche vise à éviter toute rigidité susceptible de freiner les investissements. Elle a pour objectif de simplifier le processus de création, d'évaluation et d'approbation, de réduire les coûts, conformément à l'esprit de la réforme des procédures administratives et aux impératifs de développement définis par le Secrétaire général et le Premier ministre.
La décentralisation doit s'accompagner de critères, de capacités et de mécanismes de suivi.
Lors de son intervention à la réunion, la déléguée Nguyen Thi Suu, chef adjointe de la délégation de l'Assemblée nationale de la ville de Hué, a exprimé son accord avec de nombreux points du projet, mais a déclaré que le point le plus important résidait dans la relation entre la planification, la construction et la mise en œuvre.
Mme Suu a souligné : « Une bonne interprétation juridique conduit à une bonne mise en œuvre ; et la mise en œuvre est la mesure de l'interprétation juridique. »
Concernant la décentralisation des responsabilités en matière de planification, le projet de loi autorise le Comité populaire provincial à déléguer certaines compétences aux agences de gestion des zones fonctionnelles et aux Comités populaires communaux. Selon Mme Suu, cette approche va dans le bon sens, mais le projet manque de critères d'attribution et de réglementations concernant les capacités minimales des unités concernées. En l'absence d'un mécanisme de coordination clair, le risque de chevauchements, de conflits de responsabilités et d'erreurs dans l'organisation de la planification est très élevé. Mme Suu propose d'ajouter des critères relatifs aux ressources humaines qualifiées, aux capacités informatiques et à l'accessibilité des données ; elle suggère également de charger le gouvernement d'édicter des réglementations détaillées sur la coordination entre les agences.
Concernant l'approbation des plans directeurs communaux, le projet de loi confère cette autorité au Comité populaire communal, mais ne prévoit pas de conditions suffisantes telles que des équipements spécialisés, du personnel qualifié, une infrastructure numérique, etc. La députée Nguyen Thi Suu a proposé d'exiger une évaluation préalable par un organisme professionnel provincial, et que le Comité populaire provincial évalue les capacités de la commune avant toute décentralisation ; par ailleurs, il demeure juridiquement responsable si le plan communal contrevient à un plan d'un niveau supérieur.
Concernant le zonage et la planification détaillée des zones fonctionnelles, le projet de loi autorise les organismes de gestion des zones fonctionnelles à élaborer et approuver ces plans de manière indépendante, mais ne prévoit aucun mécanisme de coordination avec les autorités locales ni de mécanisme de suivi. Mme Suu a proposé d'ajouter la responsabilité d'évaluation aux organismes professionnels provinciaux et de définir clairement le modèle de coordination afin de garantir que la planification des zones fonctionnelles soit conforme aux orientations générales.
En ce qui concerne les ajustements de planification locale, les délégués ont proposé de définir clairement les conditions, la portée et les procédures afin d'éviter les abus ou les conflits avec la planification de niveau supérieur ; l'opinion publique doit être consultée, avec une évaluation au niveau provincial et une approbation par le Conseil populaire provincial avant toute approbation.
En outre, Mme Suu a proposé d'ajouter trois éléments : une réglementation prévoyant la révision périodique des plans tous les cinq ans, afin de garantir leur adaptation aux fluctuations du terrain, notamment dans le contexte du changement climatique ; la mise en place d'un mécanisme obligatoire de consultation publique, avec publication des résultats et des explications ; et la définition claire des responsabilités juridiques du Comité populaire provincial en matière de suivi des plans, même en cas de décentralisation des pouvoirs vers les communes ou les agences de gestion des zones fonctionnelles, afin d'éviter toute délégation de pouvoirs sans attribution.
« La décentralisation et la délégation de pouvoir sont des tendances positives, mais nous devons garantir la légalité, la cohérence, la qualité de la planification et le lien avec la pratique, afin que le système de planification devienne scientifique, transparent et efficace dans le contexte de la nouvelle organisation administrative et de la nouvelle ère de développement », a souligné Mme Suu.
Renforcer le mécanisme d'ajustement de la planification Le même matin, lors de la séance de débat sur le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire (modifié), la vice-présidente de la délégation des députés de la ville de Hué, Nguyen Thi Suu, a également formulé plusieurs observations. Elle a notamment insisté sur la nécessité de renforcer le mécanisme d'évaluation et d'ajustement des plans d'aménagement afin de garantir leur stabilité, leur transparence et d'éviter toute modification arbitraire. Les délégués ont proposé de réaliser la première évaluation dès la deuxième année de la période de planification afin de déceler rapidement les lacunes et d'éviter d'attendre la cinquième année pour en faire le bilan. Cette évaluation devra reposer sur des critères quantitatifs tels que le taux d'achèvement des projets, le niveau de réalisation des objectifs de développement, le taux d'utilisation des sols et la capacité à répondre aux besoins de la population. Les résultats de l'évaluation devront être rendus publics localement afin que les citoyens puissent suivre l'évolution de la situation et réagir. Concernant les ajustements de planification, les délégués ont demandé des précisions sur les responsabilités : l’organisme de planification doit justifier par écrit tous les ajustements proposés ; l’organisme d’approbation doit consulter pleinement les ministères, les directions et les collectivités territoriales ; le conseil d’évaluation joue un rôle indépendant dans le contrôle de la légalité et du bien-fondé des ajustements. Le principe d’ajustement doit garantir que les objectifs généraux de développement ne soient pas modifiés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles ou des épidémies. Les délégués ont également proposé d'ajouter deux bases importantes d'ajustement : les retours légitimes de la communauté et les exigences d'intégration internationale dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et des infrastructures numériques. Concernant les procédures, il est nécessaire de fixer des délais clairs : 60 jours pour l’évaluation, 30 jours pour l’approbation, 15 jours pour la publication ; en cas d’urgence, le délai est de 30 jours. Compte tenu des adaptations apportées à la procédure simplifiée, les délégués ont proposé un audit a posteriori dans les 12 mois afin de prévenir tout abus. Selon les délégués, ces ajouts permettront à la loi sur l'aménagement du territoire de devenir un cadre juridique suffisamment solide, répondant aux exigences de la gouvernance du développement pour la nouvelle période. |
Source : https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/theo-dong-thoi-su/go-chong-cheo-tang-phan-cap-bao-dam-tinh-kha-thi-160429.html

































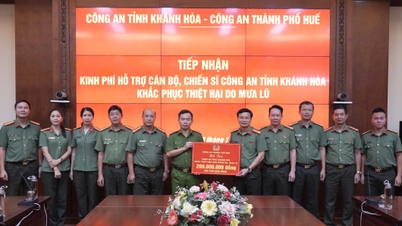







































































Comment (0)