Si, dans les années 1990, le monde s'est orienté vers la mondialisation et l'unification religieuse, le XXIe siècle a vu le phénomène inverse : les gens se sont tournés vers les « croyances locales ».
En Corée, les jeunes redécouvrent le chamanisme ; en Europe du Nord, on reconstruit le temple d’Odin ; au Vietnam, la cérémonie de médiumnité est diffusée en direct et les jeunes la qualifient de « patrimoine vivant »… Le retour des croyances autochtones n’est pas seulement un phénomène culturel, mais un cheminement vers la recherche d’une identité dans un monde trop uniformisé.
 |
Le clip vidéo « Bac Bling », réalisé par les artistes Hoa Minzy, Xuan Hinh (artiste émérite) et Tuan Cry, recrée la culture du Nord du Japon à travers le rituel du Hau Dong, des costumes traditionnels et de la musique folklorique, le tout mêlé à du rap moderne. (Source : YouTube) |
Le renouveau discret
Dans un monde où la technologie et la vitesse règnent, un paradoxe se manifeste : plus nous nous modernisons, plus nous recherchons des valeurs primitives. Il ne s’agit pas seulement du renouveau du yoga, de la méditation ou des mouvements écologiques, mais plus profondément encore : d’un retour aux croyances autochtones, à des systèmes de croyances autrefois marginalisés par le monothéisme et le rationalisme.
En Corée du Sud, le chamanisme (musok), autrefois considéré comme superstitieux, est désormais reconnu par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation , la science et la culture (UNESCO) comme patrimoine culturel immatériel. Selon le Korea Times ,
La Corée du Sud compte actuellement environ 300 000 chamans, exerçant pour la plupart de manière informelle. À Séoul seulement, de nombreux rituels ancestraux connaissent un regain de popularité et apparaissent dans des films, des clips musicaux et des expositions d'art contemporain.
« Le chamanisme… est un monde invisible, mystérieux et spirituel », a déclaré à Reuters la célèbre chamane Lee Kyoung-hyun. Elle contacte ses clients d’une manière résolument moderne : via des comptes sur les réseaux sociaux suivis par des centaines de milliers de personnes.
En Nouvelle-Zélande, les jeunes Maoris font également revivre les rituels haka et karakia – non seulement pour le sport, mais aussi comme moyen de « faire vivre l’esprit de nos ancêtres ».
Selon le journal Te Ao Māori , les activités du Matariki (Nouvel An maori), notamment le karakia de l'aube et le haka communautaire, sont devenues des espaces permettant aux jeunes de renouer avec le « tikanga », le mode de vie maori.
En Europe du Nord, le néopaganisme (la renaissance des anciennes religions préchrétiennes en Europe et en Amérique du Nord) se répand, des milliers de Suédois et de Norvégiens renouant avec le culte d'Odin, de Freya et des dieux nordiques. Ils y voient « une réaction naturelle au vide spirituel de l'ère numérique ».
Le magazine Iceland Review a un jour noté que la Nordic Revival Society en Islande est l'une des deux organisations religieuses ayant connu la plus forte augmentation du nombre de ses membres inscrits au registre national des organisations religieuses.
En Amérique latine, les rituels incas et aztèques, jadis interdits par les colonisateurs espagnols, sont remis au goût du jour par les jeunes générations, comme un acte de renaissance identitaire. Lors de cérémonies au Pérou ou à Mexico, on brûle du copal ou des herbes traditionnelles pour purifier l'espace, on offre de la coca, on prie le soleil – des images autrefois réservées aux livres d'histoire, qui s'affichent désormais sur Instagram et TikTok avec le hashtag #returntotheroots (retour aux racines).
Il ne s'agit pas seulement d'un regain d'intérêt de la jeunesse, mais aussi d'une renaissance discrète. Et peut-être, à l'heure où la mondialisation culturelle tend à uniformiser les peuples, les croyances autochtones deviennent-elles un moyen pour chaque nation de forger sa propre identité.
Pourquoi faire demi-tour au lieu d'avancer ?
Les chercheurs qualifient cette tendance de « réindigénisation » – un retour aux valeurs traditionnelles pour guérir le monde moderne.
 |
| Les danses chamaniques sont de plus en plus présentes dans les films et les émissions de divertissement coréens. (Source : Yonhap) |
Selon l'anthropologue canadien Wade Davis, dans une interview accordée en 2020 au site d'information indépendant Mongabay , nous vivons une époque où le langage disparaît progressivement. Le langage, non seulement le vocabulaire et la grammaire, mais aussi une composante indissociable de l'esprit humain, est le moyen par lequel l'âme d'une culture s'exprime dans le monde matériel. Cette perte signifie la disparition de milliers d'univers spirituels. Face à cette perte, les gens commencent à comprendre que le développement matériel n'est pas synonyme de bonheur.
Le XXe siècle a glorifié la raison, la science et le progrès, mais il a aussi plongé l'humanité dans une crise spirituelle. Solitude numérique, dépression, épuisement, désorientation… autant de facteurs qui contribuent à un sentiment de vide, malgré l'abondance de biens matériels.
Quand le monde est saturé de données et de logique, on aspire au silence de l'âme, là où les émotions et l'intuition peuvent s'exprimer. Les croyances autochtones sont le langage le plus ancien de ce silence. Les rituels ancestraux, des danses du feu africaines aux gongs des Hauts Plateaux du Centre, éveillent la mémoire génétique de la nature en chacun. Dans le son des tambours ou le parfum de l'encens, on retrouve un sentiment d'appartenance que la technologie ne peut créer.
Au Canada, les peuples autochtones organisent des pow-wows qui attirent chaque année des dizaines de milliers de personnes, à la fois comme une célébration et comme une affirmation : « Nous sommes toujours là. » Les croyances autochtones, en ce sens, ne se limitent pas à la spiritualité ; elles concernent le droit d’exister en tant que peuple distinct.
Le Vietnam ne fait pas exception.
Au Vietnam, le phénomène de retour aux croyances traditionnelles s'opère discrètement mais clairement. En 2016, le culte de la Déesse Mère a été reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Les rituels Hau Dong réapparaissent progressivement dans la vie urbaine, notamment à Hanoï, Hai Phong et Nam Dinh.
Si, autrefois, le Hau Dong était associé à la paysannerie, il attire aujourd'hui jeunes, artistes et hommes d'affaires. Ils n'y cherchent pas seulement la chance, mais aussi un langage spirituel ancestral. Sur les réseaux sociaux, des pages comme Viet Nam Tin Nguong et Dao Mau Today comptent des dizaines de milliers d'abonnés. Les vidéos de Hau Dong ont atteint des millions de vues sur TikTok.
Non seulement le culte de la Déesse Mère, mais aussi celui de Than Nong, la Déesse Mère de l'Eau, et les rituels de prière des moissons des peuples Tay, Dao et Muong, connaissent un regain de popularité lors de festivals et de visites culturelles communautaires. Par ailleurs, de nombreux jeunes artistes vietnamiens intègrent des éléments spirituels traditionnels à leurs créations, tissant ainsi un lien unique entre tradition et modernité.
Des œuvres visuelles de Le Giang et Nguyen Trinh Thi aux projets musicaux de Den Vau et Hoang Thuy Linh, tous utilisent les images de déesses mères, de divinités et de rituels pour exprimer le désir de liberté et d'identité.
Le clip vidéo « Bắc Bling » de Hòa Minzy, en collaboration avec l'artiste Xuân Hinh et le musicien Tuấn Cry, est récemment devenu un exemple marquant : il recrée la culture du Nord du Japon à travers des rituels de médiumnité, des costumes traditionnels et de la musique folklorique, le tout mêlé à du rap moderne. La chanson a non seulement suscité un véritable engouement sur les réseaux sociaux, mais a également éveillé un sentiment de fierté culturelle nationale chez les jeunes, prouvant ainsi que les croyances et les cultures autochtones renaissent sous une forme populaire.
Cette vague est-elle seulement temporaire ?
La renaissance des croyances autochtones reflète un besoin spirituel global : le besoin de connexion, d’appartenance et d’équilibre. Les jeunes du XXIe siècle ne rejettent pas la technologie ; ils souhaitent simplement s’enraciner plus profondément tout en aspirant à de plus grandes choses. Ils méditent via des applications mobiles, participent à des cérémonies dédiées à la Déesse Mère en début d’année, écoutent de la musique trance, se font tatouer des représentations de dieux maoris, utilisent les réseaux sociaux et partagent des récits ancestraux à travers des podcasts.
Les croyances autochtones ne se limitent donc plus aux temples, mais ont infiltré la vie contemporaine sous de nouvelles formes : musique folk électronique, documentaires spirituels, art de la performance, tourisme communautaire, et même dans la création de mode et l'art numérique.
Cela aide les jeunes à comprendre que l'identité n'est pas un héritage du passé, mais la matière première pour bâtir l'avenir. Le retour aux croyances autochtones n'est pas un refus du progrès, mais une reconquête du droit à un équilibre entre raison et spiritualité, permettant au passé et au présent de dialoguer.
Un article paru dans la revue universitaire Public Culture en 2000 notait qu'à l'ère de la mondialisation – où le monde semble plus « plat » que jamais – les populations locales cherchent à préserver leur identité à travers leurs croyances et pratiques culturelles distinctives.
En d'autres termes, les humains tentent de réinscrire leur empreinte sur la carte de l'esprit humain, et c'est là le sens le plus profond de ce retour : nous ne cherchons pas l'ancien, mais nous nous retrouvons nous-mêmes – la part originelle que le progrès du monde a involontairement oubliée.
Source : https://baoquocte.vn/niem-tin-ban-dia-di-xa-de-tim-lai-chinh-minh-333158.html






![[Photo] Déblaiement de collines pour faciliter la circulation sur la route 14E, touchée par des glissements de terrain.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/08/1762599969318_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2025-11-08t154639923-png.webp)





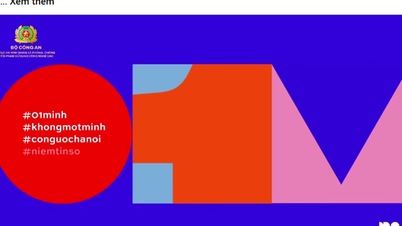





































![[Vidéo] Les monuments de Hué rouvrent leurs portes aux visiteurs](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/05/1762301089171_dung01-05-43-09still013-jpg.webp)




































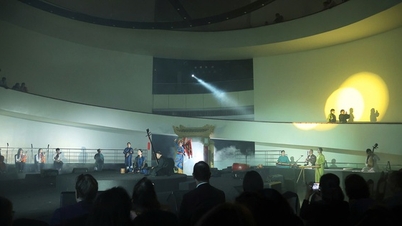












![Transition de Dong Nai à l'OCOP : [Partie 2] Ouverture d'un nouveau canal de distribution](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/09/1762655780766_4613-anh-1_20240803100041-nongnghiep-154608.jpeg)













Comment (0)