Le choix de la région du Golfe pour le premier voyage à l'étranger du second mandat de M. Trump, comme lors de son premier mandat, renforce non seulement les alliances stratégiques avec les alliés du Moyen-Orient, mais aide également les États-Unis à concurrencer le « soft power » de la Chine dans la région.
Des transactions d'un milliard de dollars
Le président américain Donald Trump a débuté sa tournée dans trois pays du Golfe le 13 mai en Arabie saoudite, où lui et le prince héritier Mohammed ben Salmane ont annoncé un engagement d'investissement de 600 milliards de dollars aux États-Unis, marquant un tournant dans les relations bilatérales.
Les accords comprennent 142 milliards de dollars pour la défense, 20 milliards de dollars de la société saoudienne DataVolt pour construire des centres de données d'intelligence artificielle (IA) et des infrastructures énergétiques aux États-Unis, selon la Maison Blanche.
Le prince héritier Mohammed a exprimé son ambition d’augmenter l’investissement total à 1 000 milliards de dollars dans les mois à venir.
Concernant l'accord avec l'Arabie saoudite, dans le domaine de l'IA, l'entreprise publique Humain a signé un accord pour utiliser « des centaines de milliers » de puces avancées du géant technologique américain Nvidia pour construire une infrastructure d'IA, avec 18 000 serveurs de technologie Blackwell dans la première phase. Le groupe de fabrication de semi-conducteurs AMD et Humain investissent 10 milliards de dollars pour déployer des infrastructures en Arabie saoudite. Amazon développera également une infrastructure de centre de données d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars dans le pays.
Le président américain Donald Trump et le prince héritier Mohammed ben Salmane à Riyad en 2017. Photo : NBC
Ces accords renforcent non seulement la position des États-Unis dans l’industrie de haute technologie, mais aident également l’Arabie saoudite à se rapprocher de son objectif de devenir un pôle mondial de l’IA, conformément à la stratégie « Vision 2030 » du pays visant à diversifier son économie .
En matière de défense, l’accord de 142 milliards de dollars, décrit par la Maison Blanche comme « le plus important de l’histoire », comprend des équipements et des services militaires avancés provenant de plus d’une douzaine d’entreprises américaines. Cela renforce non seulement les capacités militaires de l’Arabie saoudite, mais crée également des emplois et stimule l’industrie de défense américaine.
Outre les accords économiques, M. Trump a également annoncé qu’il lèverait toutes les sanctions contre la Syrie afin de donner au pays l’opportunité de se reconstruire après l’effondrement du régime d’Assad en décembre 2024.
Avec l’Iran, M. Trump a exprimé son intention de négocier un nouvel accord nucléaire mais a averti qu’il exercerait une « pression maximale » si Téhéran rejetait l’accord, y compris en réduisant à zéro les exportations de pétrole iraniennes.
Il espère également que l'Arabie saoudite normalisera bientôt ses relations avec Israël, même si cette perspective est entravée par la position d'Israël sur la question palestinienne.
Ce week-end, le président américain se rendra aux Émirats arabes unis (EAU) et au Qatar, deux pays limitrophes de l'Arabie saoudite.
La stratégie américaine au Moyen-Orient face à l'intensification de la concurrence avec la Chine
On peut constater que les accords récemment annoncés apportent des avantages significatifs aux États-Unis, allant de la création d’emplois à la promotion de l’industrie technologique et de la défense, en passant par le renforcement de l’alliance stratégique avec l’Arabie saoudite.
L’administration Donald Trump met en œuvre un plan multidimensionnel au Moyen-Orient, combinant le renforcement des alliances stratégiques, la garantie de la sécurité énergétique et la concurrence économique avec la Chine dans le contexte de la réduction de la présence militaire directe des États-Unis dans la région.
M. Trump se concentre sur les grands accords économiques et la diplomatie « pragmatique », exploitant la puissance financière des alliés du Golfe comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar pour maintenir l’influence des États-Unis et la stabilité dans le golfe Persique (la région qui fournit la majeure partie du pétrole mondial), assurant ainsi la sécurité énergétique mondiale.
Dans le même temps, les accords sur l’IA et la technologie avec l’Arabie saoudite reflètent une stratégie américaine visant à maintenir son leadership dans les industries du futur. En attirant les investissements des fonds souverains géants du Golfe (totalisant plus de 3 000 milliards de dollars), les États-Unis non seulement sécurisent les capitaux mais empêchent également ces pays de transférer leur coopération technologique vers la Chine.
Ces dernières années, la Chine a utilisé son initiative « Ceinture et Route » (BRI) pour étendre son influence au Moyen-Orient grâce au « soft power ». En 2024, Pékin a investi 39 milliards de dollars dans des projets énergétiques et d'infrastructures dans la région et a joué un rôle de médiateur dans les pourparlers de réconciliation... La Chine a également augmenté ses achats de pétrole à l'Arabie saoudite, devenant ainsi le plus grand partenaire commercial du royaume.
De toute évidence, la concurrence entre les États-Unis et la Chine au Moyen-Orient montre des signes de déplacement important vers le domaine économique.
L’annonce de M. Trump de lever les sanctions contre la Syrie et de négocier avec l’Iran montre que les États-Unis, aux côtés d’alliés comme l’Arabie saoudite, jouent un rôle plus important dans les questions régionales.
Cependant, la stratégie américaine n’est pas sans risques. L’investissement massif de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis pourrait être difficile à réaliser si les prix du pétrole chutent et que les pressions financières nationales s’intensifient. Sans progrès sur des questions telles que l’accord sur le nucléaire iranien ou la normalisation des relations israélo-saoudiennes, les États-Unis pourraient perdre une partie de leur influence sur la Chine.
On peut constater qu’en renforçant leurs alliances, en garantissant leur sécurité énergétique et en étant à la pointe des industries d’avenir comme l’IA, les États-Unis se tournent vers la concurrence économique et la géopolitique douce au Moyen-Orient pour maintenir leur influence dans le contexte de la concurrence avec la Chine.
Toutefois, le succès de cette stratégie dépend de la capacité à honorer les engagements d’investissement et à gérer les conflits régionaux, dans une région en proie à l’instabilité et à la concurrence pour le pouvoir.
Qu’est-ce qui préoccupe le plus Donald Trump lorsqu’il se montre dur envers l’Europe ? Le président Donald Trump a soudainement critiqué l'Union européenne (UE) en la qualifiant de « pire que la Chine » après avoir conclu un accord de réduction d'impôts avec Pékin. Cependant, la forte montée en puissance de la Chine constitue un défi majeur tant pour les États-Unis que pour l’UE.
Source : https://vietnamnet.vn/nuoc-co-trung-dong-cua-ong-trump-giua-cuoc-dua-my-trung-quoc-2401142.html




![[Photo] Détermination des paires en demi-finale par équipes du Championnat national de tennis de table du journal Nhan Dan](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/21/eacbf7ae6a59497e9ae5da8e63d227bf)
![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le rabbin Yoav Ben Tzur, ministre israélien du Travail](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/21/511bf6664512413ca5a275cbf3fb2f65)

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à la cérémonie d'inauguration du projet Trump International Hung Yen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/21/ca84b87a74da4cddb2992a86966284cf)
















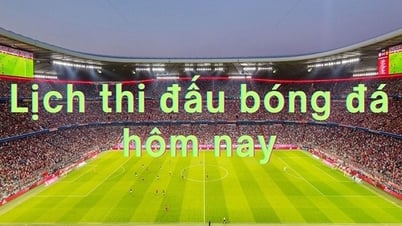




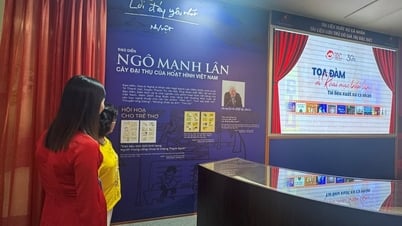














































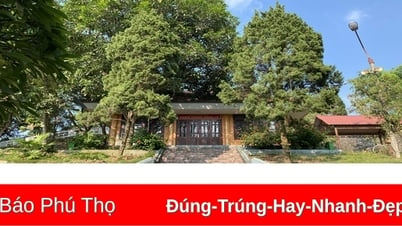





















Comment (0)