(QBĐT) - Il y a environ 20 ans, le numéro du Nouvel An lunaire du journal Quang Binh publiait mon poème « Chapeau conique » : « Blanc de l'intérieur vers l'extérieur / Il a toujours été blanc / Les gens qui tissent des chapeaux coniques dans ma ville natale / Tissent des couches de feuilles pour cacher leurs mots à l'intérieur… ». Ma ville natale est le village de Tho Ngoa, l'un des « Huit villages célèbres » de Quang Binh, un village artisanal traditionnel de chapeaux coniques reconnu par le Comité populaire de la province de Quang Binh.
L'histoire cachée du village du chapeau conique de Tho Ngoa
Les chapeaux coniques sont apparus vers 2 500-3 000 ans avant J.-C. Leurs représentations étaient gravées sur des antiquités vietnamiennes telles que les tambours en bronze Ngoc Lu et Dong Son, ce qui est éloquent.
Mais les chercheurs ignorent encore l'origine du chapeau conique dans l'histoire vietnamienne. L'encyclopédie vietnamienne, expliquant le mot « chapeau », précise : « La légende du saint Giong portant un casque de fer pour combattre les envahisseurs An nous permet de penser que les chapeaux existent depuis longtemps dans l'ancien Vietnam… ». Dès la dynastie Ly, les livres d'histoire mentionnent le chapeau dans les costumes vietnamiens, principalement folkloriques. Sous la dynastie Nguyen, le chapeau devint un costume populaire, protégeant les soldats et les habitants du soleil et de la pluie.
 |
Une légende de ma ville natale raconte : « Il était une fois une année où il pleuvait abondamment pendant des semaines, inondant maisons et terres, rendant la vie extrêmement misérable. Soudain, une déesse apparut sous la pluie, coiffée d'un chapeau géant fait de quatre grandes feuilles cousues ensemble avec des tiges de bambou. Partout où la déesse allait, les nuages sombres se dissipaient et le temps devenait frais. La déesse enseigna également de nombreux métiers avant de disparaître. Pour commémorer ses mérites, les habitants construisirent des temples et tentèrent de créer un chapeau en enfilant des feuilles de palmier. Depuis, le chapeau conique est devenu extrêmement familier et cher aux agriculteurs vietnamiens. »
Quant à la date d'apparition de l'artisanat du chapeau à Tho Ngoa, elle n'est qu'une légende. C'est pourquoi les gens continuent de se disputer. Dans les généalogies des familles anciennes du village, aucune lignée ne mentionne l'artisanat du chapeau.
Cependant, mes villageois s'accordent toujours à dire que le métier de chapelier est apparu dans le village durant la seconde moitié du XIXe siècle. En revanche, il n'existe pas de consensus sur la transmission de ce métier. La famille Tran, une grande famille du village, a rapporté à la presse qu'un membre de sa famille avait transmis le métier de chapelier. Ce membre de la famille Tran avait constaté que les Tho Ngoa avaient peu de terres et étaient souvent inondés d'eau salée, ce qui les rendait souvent affamés et démoralisés. Il a alors « traversé champs et mers » jusqu'à Hué pour apprendre le métier, puis est revenu enseigner aux villageois. Mais le seul document utilisé pour le prouver était : « Nous l'avons entendu ainsi ».
Contrairement à la famille Tran, M. Nguyen T., aujourd'hui âgé de 96 ans, a affirmé aux journalistes d'une chaîne de télévision, alors que je les avais emmenés chez lui pour le tournage de « L'Histoire des Chapeaux », que : « Celui qui a introduit le métier de chapelier au village était un habitant du hameau de Dinh (aujourd'hui le quartier résidentiel de Dinh). Cependant, c'était un homme égoïste. Il ne fabriquait des chapeaux que ouvertement pendant la journée. Toutes les étapes de la transformation des matières premières, comme les feuilles et les bords des chapeaux, ainsi que la fabrication des moules, se faisaient à huis clos, en secret la nuit. Un villageois, témoin de cela, s'est mis en colère. Chaque nuit, il montait sur le toit, soulevait le tableau pour observer. Au bout d'un moment, il a appris tous les secrets. Grâce à cela, le métier de chapelier a prospéré dans tout le village… » M. T. n'avait pas non plus de documents, se contentant de dire que mon grand-père et mon père le lui avaient raconté. Je pense que son histoire est plus fiable. Car selon l’arbre généalogique, le grand-père de M. T. avait 118 ans de plus que lui, il pouvait donc clairement comprendre l’histoire du métier de chapelier pour la raconter à ses enfants et petits-enfants.
Les chapeliers se réunissent souvent pour s'amuser, et l'histoire de la transmission du savoir-faire est encore plus captivante. Les femmes se lèchent souvent les lèvres, disant que peu importe qui l'a transmis et quand. L'important, c'est que notre village doit sa réussite à la chapellerie, sinon nous mourrions de faim !
Est-ce que ce sera juste... de la nostalgie ?
La plupart des habitants de mon village ont commencé à fabriquer des chapeaux à 7-8 ans. À cause de la faim, nous devions exploiter au maximum le travail des enfants et des personnes âgées. Nous, les enfants maigres comme moi, avions le visage caché par les moules pour les fabriquer. La chapellerie était peu lucrative, mais elle employait la main-d'œuvre de toutes les classes sociales, et nous pouvions fabriquer, vendre et gagner notre vie au quotidien.
J'ai appris à fabriquer des chapeaux à une époque où les chapeaux étaient uniquement vendus à l'État. À l'époque prospère, les boutiques payaient immédiatement après l'achat. Mais à la fin des années 70 du siècle dernier, les gens s'endettaient constamment pour leurs chapeaux. Ils étaient déjà affamés et encore plus frustrés. Les chapelleries ont été fermées, ce qui a permis à la chapellerie privée de se développer. Dans les années 80, l'industrie de la chapellerie de mon village était extrêmement florissante.
Chaque soir, à la lampe à huile, les pères rasaient les bords, les mères repassaient les feuilles et les enfants cousaient des chapeaux coniques. Ces sons complexes s'entrechoquaient, créant un bruissement. Les familles aisées possédaient un transistor pour écouter de la musique. Certaines familles possédaient un lecteur de cassettes et une lampe, si bien que de nombreuses personnes venaient confectionner des chapeaux coniques.
À cette époque, nous étions en âge de flirter avec les filles. Chaque soir, des groupes de jeunes hommes se rendaient à vélo aux « clubs de chapellerie » du village pour s'amuser, jouer de la musique et chanter. Tard le soir, ils s'installaient souvent au club où ils avaient une amante. Lorsqu'elle avait fini de confectionner un chapeau, il se levait et la ramenait chez lui, se postant dans un coin pour discuter. Généralement, dans la pénombre, le chapeau conique blanc était le plus visible, parfois même comme un bouclier pour des baisers passionnés.
 |
La chose la plus redoutée par les chapeliers est le vent laotien, qui assèche et raidit les feuilles, les rendant impossibles à repasser. À ces moments-là, ma mère doit attacher des bottes de feuilles et les laisser tomber près du puits. Il y avait des nuits où, de retour à la maison, je voyais les mains de ma mère caresser et repasser les feuilles, ce qui me faisait frissonner. Des vers de poésie me sont alors venus à l'esprit : « Des mains sèches caressent les jeunes feuilles / Les feuilles deviennent des fleurs dans le chapeau de maman, usant sa jeunesse… » Nuit après nuit, chaque maison repassait les feuilles, et l'odeur de la fumée de charbon, celle des feuilles mûres et celle du tissu brûlé provenant du panier à repasser imprégnaient mon sommeil.
Dans les années 1990, les habitants du Nord n'appréciaient plus les chapeaux. Les chapeaux Tho Ngoa ont dû migrer vers le Sud, grâce aux commerçants de Hué. Dès lors, la fabrication des feuilles par ébullition, permettant de confectionner des bords, s'est répandue à Hué, notamment pour les chapeaux en feuilles de cocotier du Sud. La fabrication traditionnelle des chapeaux du village de Mai s'est progressivement estompée, pour finalement disparaître complètement.
Au XXIe siècle, l'économie s'est développée et les rues modernes sont encombrées de véhicules, ce qui rend le chapeau encombrant et dangereux par vent fort. Même les cyclistes et les piétons l'ont remplacé par un chapeau plus adapté. La plupart du temps, seuls les agriculteurs des campagnes portent encore le chapeau aux champs. Les chapeliers de ma ville natale ont des revenus trop faibles par rapport à la moyenne, alors ils abandonnent leur chapeau et se tournent vers d'autres métiers. Jusqu'à présent, très peu de chapeliers vivent de leur métier. Les marchands de chapeaux doivent acheter des chapeaux bruts dans d'autres communes de la région, tandis que les enfants et les personnes âgées de ma ville natale font le reste.
Heureusement, grâce à sa beauté intrinsèque, le chapeau conique Tho Ngoa reste un symbole de poésie et est incontournable sur les podiums de l'ao dai. Ce chapeau reste un « ornement » qui accompagne l'ao dai pour prendre des photos et filmer à l'approche du Têt, du printemps et… pour la nostalgie !
Do Thanh Dong
Source : https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202501/que-toi-lang-cham-non-2224019/


![[Photo] Le 1er Congrès du Comité provincial du Parti de Phu Tho, mandat 2025-2030](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/30/1507da06216649bba8a1ce6251816820)
![[Photo] Ouverture solennelle du XIIe Congrès du Parti militaire pour la période 2025-2030](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/30/2cd383b3130d41a1a4b5ace0d5eb989d)
![[Photo] Le secrétaire général To Lam, secrétaire de la Commission militaire centrale, assiste au 12e Congrès du Parti de l'armée](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/30/9b63aaa37ddb472ead84e3870a8ae825)

![[Photo] Panorama du pont à haubans, dernier goulot d'étranglement de l'autoroute Ben Luc-Long Thanh](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/30/391fdf21025541d6b2f092e49a17243f)
![[Photo] Le président Luong Cuong reçoit le président de l'Assemblée nationale cubaine Esteban Lazo Hernandez](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/30/4d38932911c24f6ea1936252bd5427fa)








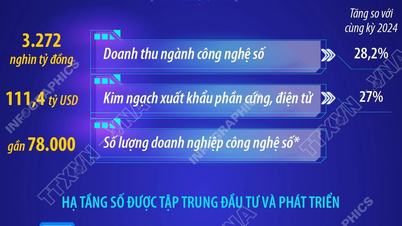



















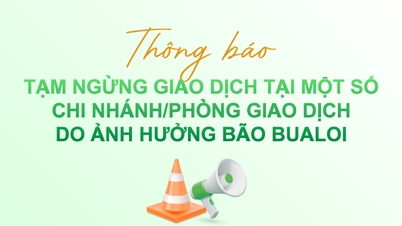








































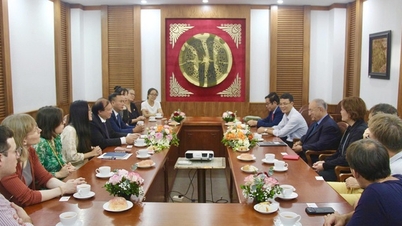
























Comment (0)