Cette confrontation reflète non seulement une tendance protectionniste croissante, mais elle risque aussi de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales et de menacer la croissance économique mondiale.
Depuis n'importe lequel pot amour commerce arriver bord peinture guerre peigne États-Unis - Chine
Le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine est le résultat de décennies de tensions économiques qui se sont accumulées, reflétant les mutations de la structure de production mondiale et le rôle croissant de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement mondiale .
Des années 1980 au début des années 2000, les entreprises américaines ont massivement délocalisé leurs sites de production à l'étranger pour profiter des faibles coûts de main-d'œuvre et des conditions de production favorables en Asie de l'Est, notamment en Chine. Grâce à sa population nombreuse, à son abondante main-d'œuvre et à ses infrastructures industrielles en plein développement, la Chine est devenue « l'usine du monde ».
Dès les années 2000, Washington a commencé à exprimer son mécontentement face aux politiques économiques et monétaires de Pékin, notamment en l'accusant de maintenir le yuan sous-évalué pour stimuler ses exportations. Bien que la monnaie se soit quelque peu raffermie au cours de la décennie suivante, le déficit commercial américain avec la Chine est resté de plusieurs centaines de milliards de dollars par an, exacerbant les tensions bilatérales.

La nouvelle vague de confrontation a débuté en 2018, lorsque l'administration Trump a imposé une série de droits de douane et de barrières commerciales visant à contraindre la Chine à modifier des pratiques que les États-Unis considéraient comme déloyales, allant des subventions industrielles aux violations de la propriété intellectuelle.
Un accord de « phase 1 », signé en 2019 et par lequel la Chine s’engageait à acheter davantage de produits américains, a temporairement apaisé les tensions. Toutefois, des désaccords persistants sur les questions technologiques, d’investissement et de politique industrielle ont jeté les bases d’une rivalité structurelle plus profonde entre les deux plus grandes économies mondiales.
Après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, Washington a rapidement relancé la guerre commerciale. À la mi-2025, les États-Unis ont imposé un droit de douane de 145 % sur les produits chinois, tandis que Pékin ripostait par un droit de douane de 125 %. L'escalade des tensions a provoqué une forte volatilité sur les marchés mondiaux et menacé les chaînes d'approvisionnement de haute technologie.
En mai 2025, les deux parties sont parvenues à une « trêve commerciale de Genève » dans laquelle les États-Unis ont réduit les droits de douane à 30 % sur la plupart des produits chinois, tandis que Pékin les a réduits à 10 % et a accepté de suspendre temporairement les contrôles à l'exportation des terres rares – une mesure considérée comme une concession stratégique pour apaiser temporairement les tensions.
La guerre des terres rares a marqué un nouveau tournant dans la confrontation entre les deux superpuissances. Le conflit s'est rapidement ravivé lorsque la Chine a imposé des réglementations strictes sur les exportations de terres rares, un groupe de matériaux stratégiques utilisés dans la production de semi-conducteurs, de véhicules électriques et de technologies de défense.
Pékin insiste sur le fait qu'il s'agit d'une mesure de sécurité nationale, mais les observateurs y voient une réponse directe au renforcement par Washington des contrôles à l'exportation de puces et d'équipements semi-conducteurs de pointe vers les entreprises chinoises.
En vertu de nouvelles règles édictées par le ministère chinois du Commerce, toutes les entreprises, nationales et étrangères, doivent obtenir une autorisation avant d'exporter des produits contenant plus de 0,1 % de terres rares (en valeur). Cette politique devrait perturber la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale et démontre que Pékin utilise de plus en plus les ressources stratégiques comme levier géoéconomique dans ses relations avec les États-Unis.
Risque ro orchidée large depuis vie guerre impôt mandarin
La décision de la Chine de contrôler ses exportations de terres rares a suscité une vive réaction de Washington. Le 10 octobre, le président Donald Trump a annoncé une taxe supplémentaire de 100 % sur les produits chinois, applicable à compter du 1er novembre. Avec les mesures précédentes, le taux d'imposition total imposé par les États-Unis sur les importations chinoises atteint environ 130 %, un niveau quasi équivalent à celui de 2024.
La Maison Blanche a déclaré que cette décision était une réponse aux « contrôles à l'exportation extrêmement agressifs » de Pékin. Trump avait auparavant averti de la possibilité d'imposer des droits de douane de 100 % et une interdiction d'exporter en réponse à la mesure prise par la Chine.
Le ministère chinois du Commerce a rapidement protesté, accusant les États-Unis d’« appliquer deux poids, deux mesures » et d’« instrumentaliser le concept de sécurité nationale » pour justifier des mesures unilatérales. Pékin a fait valoir que Washington recourt depuis longtemps aux contrôles à l’exportation et à l’« extraterritorialité » pour restreindre l’accès aux produits chinois, tandis que la Chine ne dispose que d’une liste d’environ 900 articles contrôlés, contre plus de 3 000 pour les États-Unis.
Les deux pays envisagent désormais les contrôles à l'exportation comme monnaie d'échange lors des prochaines négociations. Cependant, la tenue d'un sommet États-Unis-Chine reste possible, M. Trump ayant laissé entendre qu'il pourrait l'annuler si les tensions continuent de s'aggraver.
Quelques jours seulement après l'annonce des nouveaux droits de douane, le ton de Washington s'est quelque peu adouci. Le président Trump a déclaré que « les États-Unis veulent aider la Chine, et non lui nuire », laissant entrevoir une réconciliation après une période de tensions. Cette déclaration a temporairement stabilisé les marchés financiers : les indices boursiers américains se sont redressés après une chute de près de 3 %, tandis que le marché des cryptomonnaies est resté volatil, entraînant des pertes de centaines de milliards de dollars pour les investisseurs.
Cependant, les problèmes fondamentaux des relations économiques bilatérales demeurent irrésolus. Une interruption des approvisionnements en terres rares en provenance de Chine pourrait avoir des répercussions sur l'industrie mondiale des semi-conducteurs, alors que les États-Unis s'efforcent de relancer leur production nationale. À l'inverse, un blocage des importations chinoises accentuerait les pressions inflationnistes aux États-Unis et contraindrait la Chine à diversifier ses sources de production, ce qui pourrait entraîner du dumping sur d'autres marchés, notamment en Europe, où les industries sont déjà soumises à une forte concurrence.
Globalement, les deux économies souffriront, mais les États-Unis pourraient être davantage touchés à court terme en raison de leur forte dépendance aux importations chinoises à bas prix. Parallèlement, si la Chine considère toujours les États-Unis comme un partenaire commercial important, elle a diversifié ses marchés d'exportation au cours de la dernière décennie, réduisant considérablement le risque de tensions bilatérales.
Bien que les deux plus grandes économies mondiales soient toutes deux résilientes, un nouveau cycle de protectionnisme croissant risque d'entraîner une récession mondiale, car le commerce international et les chaînes d'approvisionnement sont profondément perturbés.
Source : https://congluan.vn/cang-thang-thuong-mai-my-trung-buoc-vao-chu-ky-doi-dau-moi-10316505.html







![[Photo] Clôture de la 14e Conférence du 13e Comité central du Parti](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/06/1762404919012_a1-bnd-5975-5183-jpg.webp)

































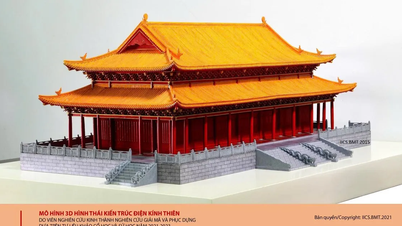






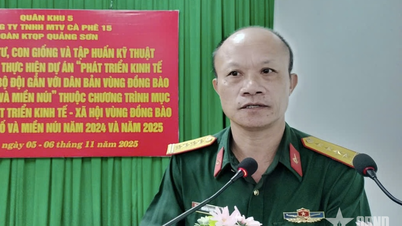








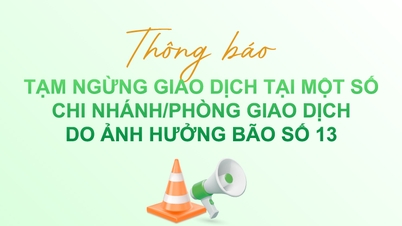















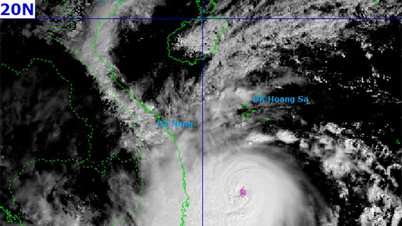






































Comment (0)