 |
| L'ambassadeur Ha Van Lau avec le président Fidel Castro à Cuba. Photo : Document |
Le colonel-ambassadeur Ha Van Lau (1918-2016) était un fils remarquable du village de Lai An, commune de Phu Mau, district de Phu Vang (aujourd'hui commune de Phu Mau, ville de Hué, province de Thua Thien Hué). Il rejoignit le Front Viet Minh en 1944. Plus tard, il adhéra au Parti communiste indochinois et participa activement aux combats .
En 1951, Ha Van Lau est nommé directeur adjoint du département des opérations du ministère de la Défense nationale avec le grade de colonel.
Français Par hasard, de colonel de l'armée, Ha Van Lau (alias Sau Lau) est devenu ambassadeur sur un front sans tirs mais extrêmement difficile, le mémoire « Ha Van Lau - La personne qui est partie du quai du village de Sinh » (écrit par Tran Cong Tan, Maison d'édition des femmes, 2004) dit : Alors que l'état-major de combat préparait le plan d'attaque de Dien Bien Phu, il y eut un ordre du vice-Premier ministre Pham Van Dong de garder Ha Van Lau pour rejoindre la délégation préparant la Conférence de Genève. Sau Lau a été affecté au groupe militaire avec le vice-ministre de la Défense nationale Ta Quang Buu pour préparer les plans de lutte militaire, exigeant la fin de la guerre à la Conférence de Genève en tant que spécialiste en charge des questions militaires, assistant le vice-ministre Ta Quang Buu... ».
Pour préparer la nouvelle mission à la table des négociations, dans l'esprit de la déclaration du président Ho Chi Minh au journal Expressen en novembre 1953, Ha Van Lau a activement collecté des documents, toutes sortes de documents, y compris la situation de guerre en cours pour servir la délégation.
En tant qu'experts militaires de la délégation, Ha Van Lau et Ta Quang Buu ont étudié attentivement les plans militaires de la conférence, à savoir le rétablissement de la paix en Indochine, le cessez-le-feu, le transfert de troupes et le retrait français des trois pays indochinois. Parmi les termes de la cessation des hostilités, nous avons proposé les plans suivants : soit un cessez-le-feu de type « peau de léopard », soit la division des zones de regroupement militaire des deux camps. Nous avons notamment calculé que la division des zones du 13e au 16e parallèle serait très pratique pour les élections générales ultérieures. Par conséquent, nous avons estimé que la lutte pour l'empiétement ou l'empiétement sur le choix d'une ligne de démarcation temporaire serait âpre lors de la conférence.
Comme prévu, lors des négociations militaires à la conférence, le vice-ministre de la Défense nationale, Ta Quang Buu, et le colonel Ha Van Lau ont rencontré à plusieurs reprises en privé la délégation militaire française, dont le général de division Delteil et le colonel Brebisson. Le point le plus important était que le parallèle divisant le pays pour permettre le regroupement des armées des deux camps devait respecter notre position, comme l'avait indiqué le chef de la délégation, Pham Van Dong : « Un cessez-le-feu signifie ne plus combattre, mettre fin à la guerre et ramener la paix dans le pays. Si l'autre partie propose de diviser la ligne pour regrouper et transférer des troupes, nous pouvons accepter. S'il refuse, nous pouvons faire des propositions avec tact, mais ne le laissons pas en profiter pour nous calomnier en prônant la division du pays. Nous devons trouver tous les moyens de concentrer nos forces jusqu'au 13e parallèle. »
Par conséquent, au cours des négociations, nous avons persisté auprès de l'adversaire à exiger la latitude la plus au sud possible. Au début, nous avons exigé le 13e parallèle traversant Quy Nhon, car les trois provinces de Quang Nam, Quang Ngai et Binh Dinh étaient des zones franches de l'Inter-zone 5, à l'exception de la ville de Da Nang. La France exigeait le 18e parallèle, à savoir la rivière Gianh à Dong Hoi. Le 10 juillet 1954, le chef de la délégation, Pham Van Dong, a rencontré Mendès France et a choisi la solution du 16e parallèle, mais la France a persisté sur le 18e parallèle. Ce n'est que le 19 juillet, sous la pression des grandes puissances, que les trois délégations de l'Union soviétique, de la Chine et de la République démocratique du Vietnam se sont mises d'accord sur le 16e parallèle, mais l'adversaire a maintenu le 18e parallèle. Finalement, la conférence a convenu de prendre le 17e parallèle, à savoir la rivière Ben Hai au nord de la province de Quang Tri, comme ligne de démarcation militaire temporaire pour les mouvements de troupes et la période des élections générales a été prolongée de deux ans (jusqu'en 1956).
Après sa victoire à la Conférence de Genève, l'ambassadeur Ha Van Lau continua de bénéficier de la confiance du Parti et de l'État, et se vit confier de nombreuses responsabilités diplomatiques importantes. En 1962, il fut envoyé à la Conférence internationale sur le Laos. En 1968, il participa à la Conférence internationale sur le Cambodge, ainsi qu'à de nombreuses conférences du Mouvement des non-alignés. De 1968 à 1970, il fut notamment chef adjoint de la délégation de négociation de la Conférence de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam. Fort de sa précieuse expérience acquise à la Conférence de Genève, de son intelligence et de ses talents de diplomate, l'ambassadeur Ha Van Lau contribua grandement à la victoire à la table des négociations de Paris, forçant les États-Unis à accepter le retrait de leurs troupes du Sud-Vietnam, créant ainsi une occasion favorable de mettre fin à la longue résistance contre les États-Unis au printemps historique de 1975.
Début 1974, Ha Van Lau est nommé ambassadeur du Vietnam à Cuba, puis en République d'Argentine (du 21 août 1974 au 31 mai 1975), simultanément ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Jamaïque et en Guyane, et ambassadeur du Vietnam auprès des Nations Unies (1978-1982).
À partir de mars 1982, l'ambassadeur Ha Van Lau fut rappelé du pays et nommé vice-ministre des Affaires étrangères, tout en étant chef du Comité central des Vietnamiens d'outre-mer. En 1984, il occupa les fonctions d'ambassadeur du Vietnam en France, puis en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, jusqu'à sa retraite à plus de 70 ans.
L'histoire a confié au colonel diplomate Ha Van Lau de nombreuses responsabilités importantes au sein du pays, et il s'en est toujours acquitté avec brio. Que ce soit comme soldat ou comme ambassadeur diplomatique, il a toujours laissé l'image d'un commandant poli, compétent et talentueux.
Source : https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/theo-dong-thoi-su/dau-an-cua-dai-su-ha-van-lau-tren-ban-dam-phan-143126.html






















![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale participe au séminaire « Construire et exploiter un centre financier international et recommandations pour le Vietnam »](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)








































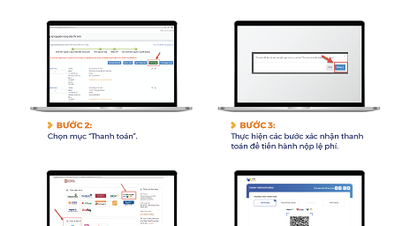




































Comment (0)