
Accroître la concentration des ressources et assurer la coordination intersectorielle.
Lors des discussions sur le Programme national ciblé de modernisation et d'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation pour la période 2026-2035, la députée à l'Assemblée nationale Doan Thi Le An (Cao Bang) a soulevé les points suivants : malgré les nombreux efforts déployés par le secteur de l'éducation ces dernières années, les disparités de qualité entre les régions restent importantes ; les infrastructures et équipements numériques ne répondent pas aux exigences d'innovation ; il existe une pénurie d'enseignants, notamment dans les zones les plus difficiles ; la formation professionnelle et l'enseignement supérieur ne fournissent pas encore suffisamment de ressources humaines aux secteurs clés.
Par conséquent, l'élaboration de ce programme national ciblé est absolument nécessaire pour accroître la concentration des ressources, garantir la coordination intersectorielle et permettre une transformation radicale du système éducatif au cours de la prochaine décennie. Le document de proposition et le projet de résolution définissent un calendrier de mise en œuvre, des objectifs précis et les ressources nécessaires.

L'un des objectifs du programme qui intéresse les députés de l'Assemblée nationale est de faire progressivement de l'anglais la deuxième langue du système éducatif national. D'ici 2030, au moins 30 % des établissements préscolaires et d'enseignement général s'efforceront de mettre en œuvre des modèles d'école intelligente, appliquant les technologies numériques et l'intelligence artificielle (IA) à la gestion, à l'enseignement et à l'apprentissage, intégrant les disciplines STEM/STEAM et enseignant les sciences naturelles et les disciplines STEM/STEAM en anglais.
D’ici à 2035, investir pour que 100 % des établissements préscolaires et d’enseignement général disposent du matériel pédagogique suffisant pour mettre en œuvre l’enseignement de l’anglais comme deuxième langue à l’école.
Il s'agit d'une orientation majeure, témoignant de la volonté de s'intégrer pleinement à la communauté internationale. À cet égard, selon la déléguée Doan Thi Le An, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'évaluer avec franchise les conditions et les défis liés aux infrastructures, aux ressources humaines et au contexte de mise en œuvre.
Citant la situation actuelle à Cao Bang, le délégué a indiqué que dans la province, près de 70 % des écoles publiques, après évaluation, ne répondent toujours pas aux normes en matière d'équipement technologique pour l'apprentissage des langues étrangères. De nombreuses écoles isolées, situées dans les zones habitées par les minorités ethniques, ne disposent pas de salles de classe adéquates, rendant ainsi l'investissement dans des salles fonctionnelles pour l'anglais quasi impossible à court terme. Bien que l'accès à Internet soit largement répandu, le débit est faible et instable, ce qui complique la mise en place d'un environnement numérique adapté à l'apprentissage des langues.
Partant de ce constat, les délégués ont déclaré que l'objectif de voir 30 % des établissements d'enseignement préscolaire et général capables d'enseigner des matières intégrées, naturelles ou STEM/STEAM en anglais d'ici 2030 pourrait être réalisable dans les grandes provinces et les grandes villes, mais « très difficile » dans les zones montagneuses telles que Cao Bang, Tuyen Quang, Lai Chau, Dak Lak... - où les infrastructures ne sont pas encore adaptées.
Soulignant le principal obstacle actuel, à savoir le manque d'enseignants d'anglais dans de nombreuses localités, la déléguée Doan Thi Le An a indiqué que dans les provinces montagneuses du nord (Cao Bang, Bac Kan, Dien Bien…), environ 40 à 50 % des enseignants d'anglais n'ont pas encore atteint le niveau de compétence linguistique requis par le Cadre de compétences à six niveaux. Dans les écoles maternelles et primaires, la pénurie d'enseignants d'anglais est encore plus criante, en raison du nombre limité de formations disponibles pour ce niveau.

Au niveau secondaire, le nombre de professeurs de physique, chimie, biologie, informatique et mathématiques capables d'enseigner en anglais représente actuellement moins de 3 % à l'échelle nationale ; à Cao Bang, ce taux est quasi nul. Par ailleurs, les professeurs de langues étrangères de haut niveau privilégient souvent les établissements urbains ou privés offrant de bonnes rémunérations ; le système d'incitation actuel est insuffisant pour attirer les bons enseignants dans les zones rurales.
En ce qui concerne la préparation des élèves, des parents et de l'environnement linguistique, selon la déléguée Doan Thi Le An, si dans les zones urbaines la demande d'apprentissage de l'anglais est très élevée, alors dans les provinces montagneuses, le pourcentage d'élèves issus de minorités ethniques dépasse 90 %, le vietnamien étant également une langue seconde, imposer l'anglais comme langue seconde à l'école représente un défi extrêmement important.
« La plupart des provinces ne disposent pas d'un environnement anglophone au sein de la communauté. Si les élèves n'ont que 2 ou 3 heures de cours par semaine, il leur sera difficile d'acquérir les compétences nécessaires pour étudier les matières scientifiques en anglais », a souligné le délégué.
Le délégué a toutefois affirmé que faire de l'anglais la deuxième langue du système éducatif est une vision juste et urgente. Pour atteindre les objectifs de 30 % d'ici 2030 et de 100 % d'ici 2035, il est nécessaire d'investir massivement et de manière coordonnée, d'harmoniser les pratiques pédagogiques, d'apporter un soutien spécifique aux minorités ethniques et aux zones montagneuses, et de mettre en place une stratégie adaptée aux réalités de chaque région et localité.
Les délégués estiment qu'avec une forte détermination politique et des politiques suffisamment robustes, le Vietnam peut pleinement atteindre cet objectif, contribuant ainsi à améliorer la qualité de ses ressources humaines et à répondre aux exigences de l'intégration internationale dans cette nouvelle période.
Examinez attentivement afin d'éviter d'avoir à produire deux séries de documents, deux rapports et à appliquer deux mécanismes pour un même contenu.
Dans son évaluation générale des deux programmes nationaux cibles sur l'éducation et la formation, les soins de santé et la population, la députée de l'Assemblée nationale Ly Thi Lan (Tuyen Quang) a déclaré que les projets de résolution reflétaient tous l'esprit d'innovation et de percée de la résolution n° 72-NQ/TW du Politburo sur un certain nombre de solutions novatrices pour renforcer la protection, les soins et l'amélioration de la santé des personnes et de la résolution n° 71/NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de l'éducation et de la formation.

Face à la réalité de la mise en œuvre des programmes nationaux ciblés au niveau local, la déléguée Ly Thi Lan a également souligné que le principal problème de la mise en œuvre des programmes au niveau local réside dans la capacité limitée d'organisation et de mise en œuvre, la capacité d'absorption des capitaux, et que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes.
Par ailleurs, les deux programmes nationaux ciblés continuent d'investir massivement dans la construction d'infrastructures, tandis que, selon les délégués, la capacité à établir, évaluer et mettre en œuvre des investissements publics au niveau communal… se heurte encore à de nombreux obstacles. Sans solutions spécifiques et modèles de programmes adaptés aux réalités du terrain, leur mise en œuvre efficace sera difficile.
Outre la mise en œuvre des Programmes nationaux ciblés, le gouvernement a également soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale, lors de cette 10e session, la politique d'investissement de plusieurs autres Programmes nationaux ciblés. En conséquence, la déléguée Ly Thi Lan a suggéré que le gouvernement demande aux ministères et aux directions de poursuivre l'examen et la comparaison des programmes afin d'éviter tout chevauchement d'activités ou de tâches.
« Si ces deux programmes nationaux ciblés ne sont pas soigneusement examinés lors de leur mise en œuvre au niveau local, notamment au niveau communal, il y aura un risque de devoir préparer deux séries de documents, deux rapports et appliquer deux mécanismes pour un même contenu, ce qui rendra leur mise en œuvre au niveau local très difficile », a souligné le délégué.
Dans l'espoir que le Programme national ciblé sur les soins de santé, la population et le développement pour la période 2026-2035 soit mis en œuvre de manière synchrone, substantielle et efficace, contribuant ainsi à la bonne réalisation des objectifs de développement socio-économique et de soins de santé pour la population, la députée à l'Assemblée nationale Dang Thi Bao Trinh (Da Nang) a suggéré que, parmi les bénéficiaires, il soit nécessaire de clarifier qui est le groupe « défavorisé », afin d'éviter tout chevauchement avec d'autres groupes prioritaires ; dans le même temps, il convient d'ajouter les personnes handicapées à la liste des bénéficiaires.

Cela garantit une allocation des ressources ciblée, transparente et cohérente lors de la mise en œuvre. Parallèlement, la définition claire de l'objectif facilitera la conception d'activités de soutien adaptées par les projets qui le composent, améliorant ainsi la faisabilité et l'efficacité pratique du programme, notamment dans les zones défavorisées où les besoins sont souvent divers et complexes.
Selon la députée à l'Assemblée nationale Trang A Duong (Tuyen Quang), le groupe de bénéficiaires prioritaires doit être élargi conformément à l'esprit de la résolution 72-NQ/TW, y compris les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, etc. Dans le même temps, il est proposé d'ajouter les « zones de minorités ethniques et les zones montagneuses, frontalières et insulaires » aux zones prioritaires.

Concernant le projet 3 du sous-projet 1 visant à encourager la naissance de deux enfants, la déléguée Dang Thi Bao Trinh a souligné que le taux de remplacement des naissances est actuellement en baisse principalement en raison de facteurs économiques, éducatifs et liés au milieu de travail, et non uniquement par manque d'information ou de compétences. Par conséquent, les activités de formation et d'accompagnement, si elles ne sont pas accompagnées de solutions concrètes en matière d'économie, de santé reproductive et d'infrastructures médicales, auront beaucoup de mal à être efficaces.
Il est donc recommandé de bien séparer les activités politiques/institutionnelles des activités d'investissement/de soutien aux modèles, et d'ajouter des activités spécifiques permettant de mesurer les résultats, par exemple, l'application des technologies numériques pour surveiller les fluctuations démographiques, l'investissement dans les examens de santé prénuptiaux et les soins de santé reproductive.
Source : https://daibieunhandan.vn/khi-co-quyet-tam-cao-va-chinh-sach-du-manh-se-som-dua-tieng-anh-thanh-ngon-ngu-thu-hai-10397019.html




















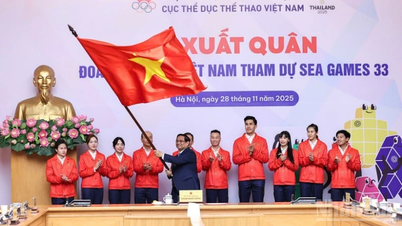
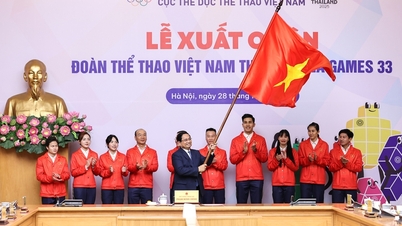





































































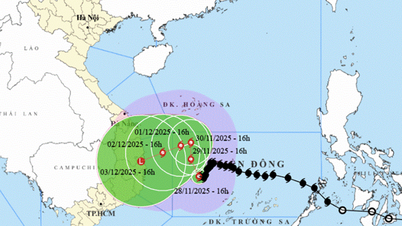




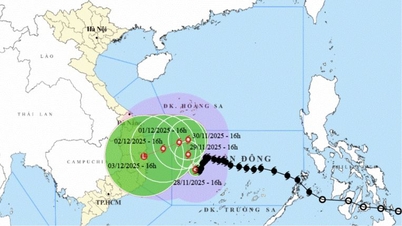














Comment (0)