Avec un droit de douane de 15 % sur la grande majorité des exportations de l'UE vers les États-Unis, l'accord a été salué comme une victoire diplomatique . Mais replacé dans le contexte plus large des règles commerciales, des déséquilibres de pouvoir et des normes internationales, la question est la suivante : s'agit-il réellement d'un succès pour l'UE, ou simplement d'une capitulation face aux pressions d'un partenaire imprévisible ?
Un pas en arrière, c'est une victoire ?
L’accord de l’UE sur un droit de douane de 15 %, nettement supérieur à la moyenne précédente de 1,47 %, a permis d’éviter la menace du président Donald Trump d’imposer des droits de douane de 30 %, qui devaient entrer en vigueur le 1er août. D’un point de vue tactique, il s’agit clairement d’une victoire : l’UE a ainsi échappé à une hausse des droits de douane tout en préservant l’essentiel de ses échanges commerciaux avec le marché américain. Mais, de façon inquiétante, ce « succès » repose sur le fait d’avoir évité le pire, et non sur l’obtention d’une meilleure situation que le statu quo.
Il y a quelques mois à peine, de nombreux États membres de l'UE avertissaient qu'un droit de douane de 10 % constituait une ligne rouge. Pourtant, lors des négociations, un droit de douane de 15 % a été accepté, voire présenté comme un accord décisif. Cela illustre la différence de positions dans les négociations : l'UE s'est engagée dans les discussions non pas en tant que partenaire égal, mais dans un souci d'éviter les pertes.
L'un des points saillants de la déclaration conjointe est l'engagement de l'UE à investir environ 600 milliards de dollars aux États-Unis et à acheter pour 250 milliards de dollars d'énergie américaine (pétrole, gaz naturel liquéfié, combustible nucléaire) chaque année pendant trois ans (selon CNBC). Cependant, les observateurs estiment que la nature et le caractère contraignant de ces engagements restent flous.
Il est difficile de déterminer si ces chiffres reflètent une réelle augmentation des investissements et des importations existants, ou s'ils ne font que confirmer les tendances actuelles. De plus, l'absence de précisions sur le calendrier, les types d'investissements et les mécanismes de suivi rend difficile la quantification des « gains » des parties à l'accord. Si ces chiffres ne sont que symboliques ou instrumentalisés à des fins de propagande politique , l'UE pourrait en réalité avoir conclu un accord asymétrique : des concessions substantielles en échange d'engagements vagues.
Impact économique bidirectionnel
Du côté américain, un taux d'imposition de 15 % peut contribuer à accroître les recettes du budget fédéral et à protéger certains secteurs industriels nationaux. Cependant, les analystes estiment que le prix à payer pour les États-Unis est loin d'être négligeable. Les mesures tarifaires entraînent souvent deux conséquences négatives : une hausse des prix pour les consommateurs et une pression accrue sur les coûts des entreprises nationales dépendantes des chaînes d'approvisionnement mondiales.
Pour l'UE, le coût le plus important ne réside pas seulement dans les droits de douane eux-mêmes, mais aussi dans le message qu'ils véhiculent : celui d'une UE prête à se mettre en retrait pour préserver ses relations commerciales bilatérales. Si les entreprises européennes choisissent d'investir directement sur le marché américain plutôt que d'exporter, l'excédent commercial de biens (qui a atteint 198 milliards d'euros l'an dernier) pourrait diminuer. Cependant, cette fuite des investissements affaiblit le marché intérieur de l'UE et fragmente sa capacité de production.
Le paradoxe est flagrant : pour conserver sa part de marché aux États-Unis, l’UE doit se « transférer » aux États-Unis, réduisant ainsi son rôle de plateforme manufacturière mondiale ; or, à terme, cela brouille la frontière entre commerce équitable et concessions stratégiques. D’exportatrice compétitive, l’UE pourrait être contrainte de modifier sa structure économique pour s’adapter aux conditions imposées par les États-Unis.
Un accord à court terme pour des défis à long terme
Le président Donald Trump est connu pour son style de négociation agressif, n'hésitant pas à recourir à des mesures coercitives pour contraindre l'autre partie à faire des concessions. Lors des négociations avec l'UE, l'éventualité de droits de douane élevés a été évoquée, créant un climat d'urgence et influençant le cadre de l'accord. Dans ce contexte, le droit de douane de 15 %, bien que nettement supérieur à la position initialement convenue, paraissait plus acceptable face aux droits de douane potentiels, bien plus élevés.
En tant qu'acteur majeur du système commercial multilatéral mondial, l'UE a le devoir non seulement de protéger les intérêts à court terme de ses exportateurs, mais aussi de rester fidèle aux principes fondamentaux du libre-échange et des marchés équitables. Or, nombreux sont ceux qui estiment que la réaction du bloc dans ce cas précis révèle un manque de cohérence entre ses paroles et ses actes. Après avoir averti qu'un droit de douane de 10 % constituait une « ligne rouge », l'UE accepte ensuite un droit de 15 % risque de susciter des doutes quant à la cohérence de son message et à sa capacité à défendre les intérêts communs sur le long terme.
Les analystes estiment que cet accord pourrait instaurer une trêve à court terme, mais qu'il ne règle pas les divergences structurelles. Des questions majeures telles que les subventions agricoles, la protection des technologies, les normes environnementales et les droits de propriété intellectuelle demeurent en suspens. Lorsque ces questions seront abordées lors des négociations, l'UE sera soumise à une pression accrue, surtout si le précédent de cet accord se répète.
L’accord commercial du 27 juillet entre les États-Unis et l’Union européenne va bien au-delà d’un simple ajustement tarifaire ; il témoigne de profonds changements dans les interactions entre les grandes économies au sein d’un contexte mondial instable. En évitant temporairement une confrontation commerciale, les deux parties se sont octroyé un délai supplémentaire pour redéfinir leurs relations économiques bilatérales et réajuster leurs priorités stratégiques.
Mais cet accord met également en lumière les défis fondamentaux qui caractérisent le système commercial international : la tension entre protectionnisme et libre-échange, entre intérêts à court terme et vision à long terme. Malgré un certain consensus, l’UE et les États-Unis sont confrontés à une question plus vaste : comment préserver les principes tout en restant flexibles face à l’accélération des mutations politiques et économiques ?
Au final, ce qui comptera, ce n'est pas tant le contenu de l'accord actuel que la manière dont les parties s'en serviront comme tremplin vers des objectifs plus durables. Dans un monde de plus en plus multipolaire et incertain, la transparence, la cohérence et la volonté de coopérer de toutes les parties seront essentielles pour bâtir un environnement commercial équitable et prévisible.
Hung Anh (Contributeur)
Source : https://baothanhhoa.vn/eu-my-dam-phan-thanh-cong-hay-thoa-hiep-chien-luoc-256263.htm





![[Photo] Le secrétaire général To Lam reçoit le vice-Premier ministre et ministre de la Défense slovaque, Robert Kalinak](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/18/1763467091441_a1-bnd-8261-6981-jpg.webp)






























![[CRITIQUE D'OCOP] Vermicelles de riz Duong Van - La quintessence du village artisanal de Hoang Dat](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/18/1763460492510_review-ocop-mie-w1200t0-di2546d245d2170303t11920l1-525e8fd67833f466.webp)
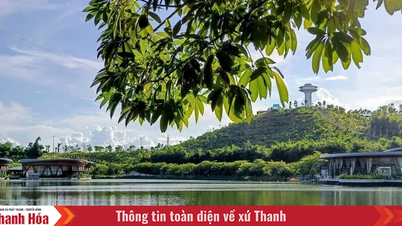






















































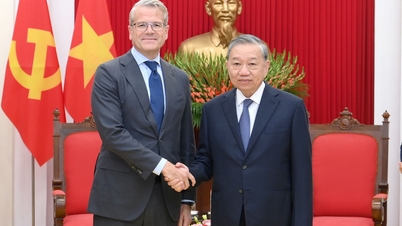


















Comment (0)