Illustration : PV |
Ma mère est décédée alors que j'étais encore bébé. Mon père est parti travailler comme ouvrier du bâtiment à Saïgon et ne venait me rendre visite qu'une fois tous les deux ou trois mois. Toute mon enfance a été marquée par l'ombre du dos de Lan autour du feu, le son de ses appels à étudier près de la lampe à huile vacillante, les après-midi d'été où elle allait aux champs glaner du riz, ramassant chaque grain tombé et le faisant sécher sur une bâche tachée au milieu du jardin.
Quand j'avais dix ans, Lan en avait aussi dix-huit – l'âge des rêves et des espoirs. Elle venait de passer son examen d'entrée à l'université, portant en elle les nombreux rêves d'études supérieures qu'elle avait caressés tout au long de ses années de lycée. C'était la fin août, les rizières devant la maison prenaient une teinte jaune doré, la lumière sèche du soleil se répandant sur chaque tige de riz mûre et courbée, dégageant un doux parfum. L'après-midi, après avoir cuisiné et fait la lessive, elle s'asseyait sous un vieux manguier, peignant ses longs cheveux noirs comme de l'encre, la lumière du soleil tombant sur chaque mèche, chatoyante comme une soie céleste. Je m'asseyais à côté d'elle, marmonnant mes tables de multiplication, tandis qu'elle chantait doucement, sa voix aussi claire que le vent dans les champs.
Lan adorait étudier. Depuis son enfance, malgré la pauvreté de sa famille, elle n'avait jamais manqué une seule journée d'école. Un jour, alors qu'il pleuvait à verse et que l'eau lui arrivait aux genoux, elle marcha près de cinq kilomètres pour se rendre à l'école. Les soirs d'hiver, par un froid glacial et un vent violent qui soufflait à travers les murs de bambou, elle allumait une lampe à huile et étudiait jusque tard dans la nuit, les mains violettes, tout en continuant à prendre des notes avec assiduité. L'écriture était peut-être pour elle le seul moyen de sortir du cercle vicieux de la pauvreté.
Puis, le jour de l'annonce des résultats d'examen, son nom n'était pas sur l'avis. À ce moment-là, il commençait à pleuvoir. À l'Ouest, la pluie n'était pas torrentielle, mais persistante, silencieuse comme un soupir caché au fond du cœur. Cet après-midi-là, elle était assise distraitement sur le porche, la copie d'examen froissée dans sa main. Je ne savais pas quoi dire, alors je me suis assis tranquillement à côté d'elle, lui donnant une patate douce bouillie.
Elle sourit en coin :
- C'est bon. Reprenez-le l'année prochaine...
Ce soir-là, mon père m'appela. Sa voix était aussi trouble que la première rosée de la saison :
- Si tu échoues, va travailler. Si tu restes tout le temps à la maison, qui pourra te nourrir ?
Le téléphone raccrocha, elle ne dit rien. Elle plia simplement le vieux carnet – celui qu'elle utilisait pour écrire son journal et ses essais – et le rangea soigneusement dans le coffre en bois. J'entendis le bruit sec et décisif du couvercle du coffre se refermer. Cette nuit-là, alors que je faisais semblant de dormir, je l'entendis soupirer très doucement. Ce soupir ne venait pas de sa gorge, mais semblait provenir du plus profond de son cœur, long, interminable, froid comme le sifflement du vent à travers un toit de chaume troué.
* * *
L'année suivante, pendant la saison des inondations, alors que les sarcelles venaient de revenir couvrir les rizières à moitié moissonnées, Lan fit ses bagages et se dirigea vers la ville. Elle dit :
Je travaille comme ouvrier d'usine. Économise pour ne pas avoir à abandonner mes études comme toi, une fois mes études terminées.
Elle quitta sa ville natale par un matin maussade, le ciel couvert d'une couche de nuages gris, comme pour retenir les pas d'une jeune fille qui n'était jamais allée bien loin. Debout sur le porche, mon cartable déchiré à la main, j'éprouvais un pincement au cœur. Depuis la mort de ma mère, je n'avais jamais senti ma maison aussi vide.
À ses débuts à Saïgon, ses lettres à sa famille étaient rares. Elle travaillait dans une usine de confection, avec beaucoup de travail et des heures supplémentaires constantes. Son salaire était modeste, mais elle économisait quand même pour m'envoyer des livres. Un jour, elle m'a même envoyé une lettre dont quelques lignes étaient brouillées par les larmes :
- « Je vais bien. Reste à la maison et étudie bien. Ne laisse pas la pauvreté te freiner. »
J'ai grandi avec chaque saison des inondations, chaque aller-retour du bus sur l'autoroute poussiéreuse. Au début de chaque année scolaire, elle m'envoyait une chemise blanche propre, ou un uniforme qui me allait à la cheville. Parfois, j'aurais aimé qu'elle soit à la maison ; du riz et des légumes suffiraient. Mais ensuite, je me disais que sans elle, je n'aurais probablement pas pu aller à l'école.
Lan avait un petit ami une année où la ville célébrait le Têt en avance, lorsque les abricotiers commençaient à fleurir sur les porches. Il était ingénieur électricien et travaillait près de la pension où elle habitait. Elle dit d'une voix basse et douce comme la fumée du soir :
- De bonnes photos, sais partager, je t'aime vraiment.
C'était la première fois que je la voyais rêver ainsi. Ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de lui, et son sourire se faisait plus fréquent lors des appels téléphoniques précipités. J'étais secrètement heureux, espérant qu'elle trouverait quelqu'un digne des années qu'elle avait sacrifiées en silence.
Mais les choses ne se passèrent pas aussi bien que le vent de mars. Quand elle me dit qu'elle voulait le ramener à la maison pour qu'il rencontre ses parents, mon père grommela au téléphone :
- Les femmes à la campagne, ouvrières, ne rêvent pas de gravir les échelons. Je ne l'accepte pas.
Elle se disputa, la première fois que j'entendis sa voix si dure. Puis le téléphone se tut. Quelques semaines plus tard, elle rentra seule chez elle, vêtue simplement, les yeux rouges. Elle dit qu'il était en voyage d'affaires à l'étranger. Je ne la crus pas, mais je n'osai pas en demander davantage. Dans la lumière gris argenté de l'après-midi, ce jour-là, Lan était assise, les genoux serrés, au bord d'un fossé asséché, le regard perdu dans le vide, comme si elle cherchait un endroit où personne ne l'attendait.
* * *
Le temps s'écoule comme un fleuve en saison sèche, effaçant doucement les contours acérés des souvenirs. J'ai réussi l'examen d'entrée à l'université, l'avis d'admission est arrivé le jour de la première pluie de la saison. La bruine frappait le vieux toit en tôle ondulée, résonnant comme le son d'une joie brisée. Mme Lan se tenait dans la cuisine, les mains encore couvertes de farine à gâteau, et se précipitait vers moi pour m'accueillir dans l'allée, tenant le morceau de papier portant mon nom comme s'il s'accrochait à un rêve. Ses larmes coulaient sur les contours flous des lettres, pas forcément par émotion, mais parce que les années silencieuses qu'elle avait laissées derrière elle semblaient maintenant s'épanouir à cet instant.
Je suis allée à Saïgon pour étudier et j'ai loué une chambre près du lieu de travail de ma sœur. La petite chambre était exiguë mais chaleureuse, car ma sœur était toujours à mes côtés, une sœur qui était à la fois une mère et une amie, une lumière inépuisable au cœur de la grande ville. Elle travaillait dans une boutique de robes de mariée, un travail qui exigeait minutie et un œil attentif. Le soir, après le travail, elle se courbait et parcourait les rues bondées à vélo, m'apportant un sac de riz gluant chaud, un bol de soupe sucrée aux haricots mungo, ou parfois simplement une patate douce rôtie parfumée. Elle disait :
- Essaie d'étudier. Le savoir est quelque chose que personne ne peut t'enlever. En ville, ne te laisse pas emporter par les autres. Termine tes études et réfléchis ensuite à ce que tu feras ensuite.
J'ai étudié. Quatre années d'université ont passé en un clin d'œil. Les périodes d'examens stressantes, les nuits blanches avec les épais manuels, son ombre était toujours là, parfois un panier-repas chaud qui m'attendait, parfois un dos maigre appuyé contre la porte qui me regardait réviser sans rien dire. Le jour où j'ai décroché mon premier emploi, mon premier salaire mensuel, je suis passée dans un magasin de chaussures et j'ai choisi une paire de ballerines roses – le modèle qu'elle regardait souvent sans jamais acheter. Elle tenait les chaussures dans sa main, hésitante :
- Tu peux toujours porter les sandales... Garde-les et préoccupe-toi de l'avenir.
Puis elle sourit, un sourire aussi fin que le soleil de fin d'été, mais étrangement chaleureux.
Lan s'est mariée à plus de trente ans. Cet homme n'était ni ingénieur, ni romantique, et ne lui offrait pas de roses pour les fêtes. C'était juste un charpentier, à l'allure négligée et aux mains calleuses, mais son regard était sincère et chaleureux comme du vieil acajou. Je l'ai rencontré pour la première fois au marché, alors qu'il la conduisait sur sa vieille moto, la protégeant soigneusement du soleil avec une vieille chemise. En la regardant dans les yeux à cet instant, j'ai su : elle avait trouvé un appui.
Son mariage fut aussi simple qu'elle : quelques plateaux de nourriture sous les manguiers derrière la maison, quelques chansons dans le calme de midi. Mon père revint aussi. Il ne dit pas grand-chose, se contentant de lui tapoter l'épaule, comme une excuse tardive après des années d'indifférence. Sa belle-mère vendait des gâteaux à la banane frits au marché ; elle avait une voix forte, mais une personnalité sincère ; elle l'aimait comme sa propre fille.
Elle vit maintenant à la campagne, dans une petite maison de deux pièces construite à côté d'un potager et de quelques bananiers. Elle a deux enfants, un garçon et une fille, tous deux intelligents et brillants. Chaque fois que je rentre à la maison, les enfants sortent en courant, bavardant de l'école, des amis et des délicieux plats que leur mère prépare. Elle sourit toujours avec douceur, une main cueillant rapidement les légumes, l'autre essuyant la sueur sur le front de son enfant.
Un jour de pluie, ma sœur et moi étions assises sur la véranda, regardant le canal boueux. Le vent soufflait dans les mangroves, bruissant comme le retour du temps. Elle demanda :
- Tu es fatigué là-haut ? Le riz braisé à la sauce de poisson que j'ai cuisiné te manque ? J'ai souri :
- Bien sûr que tu me manques. Le riz me manque, tu me manques, le bruit de la pluie sur le toit de chaume me manque. Elle ne dit rien de plus, me versa juste une tasse de thé au gingembre chaud, ses yeux brillant d'une douceur que je n'oublierai jamais.
J'étais assis là, au milieu d'une petite maison au bord d'un canal tranquille, contemplant la femme qui avait passé sa jeunesse pour moi – maintenant apaisée, non pas noble mais pleine, non pas bruyante mais heureuse. Dehors, le chant des oiseaux se mêlait aux rires des enfants, se mêlant au vent, instillant dans mon cœur une indescriptible douceur. Dans la lumière dorée de l'après-midi, ma sœur – immobile comme un champ après l'orage, tranquille, simple mais fière, et aussi le rivage le plus paisible de ma vie.
Source : https://baophuyen.vn/sang-tac/202506/chi-toi-f3e2c97/








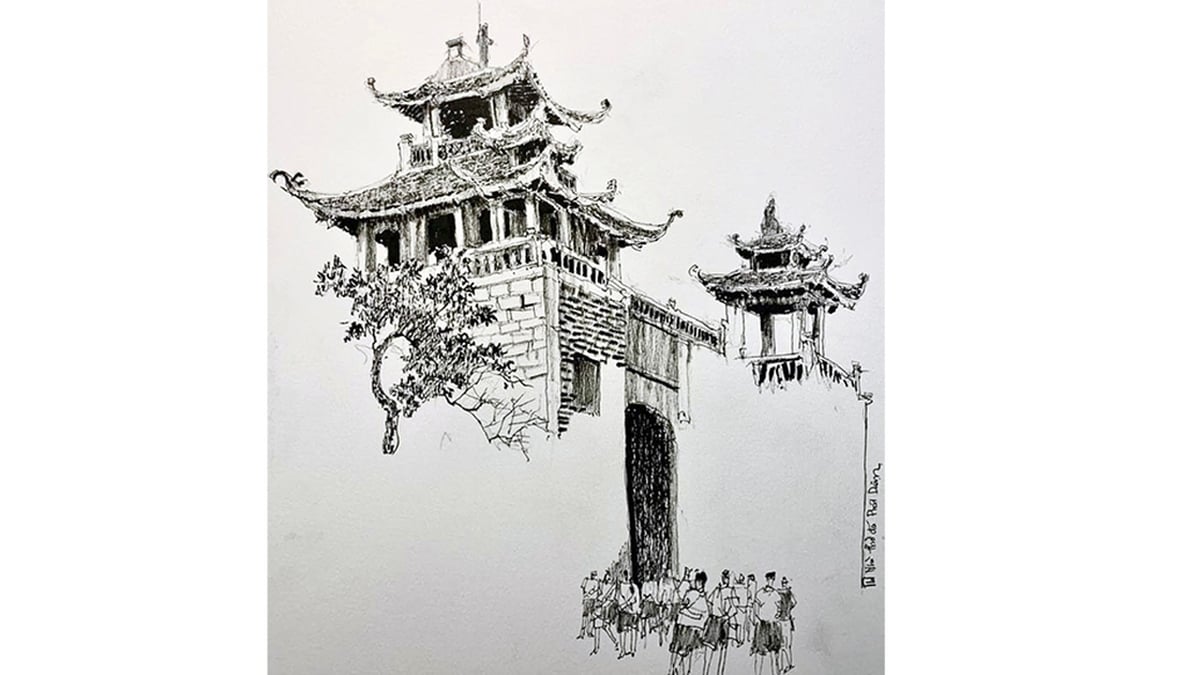


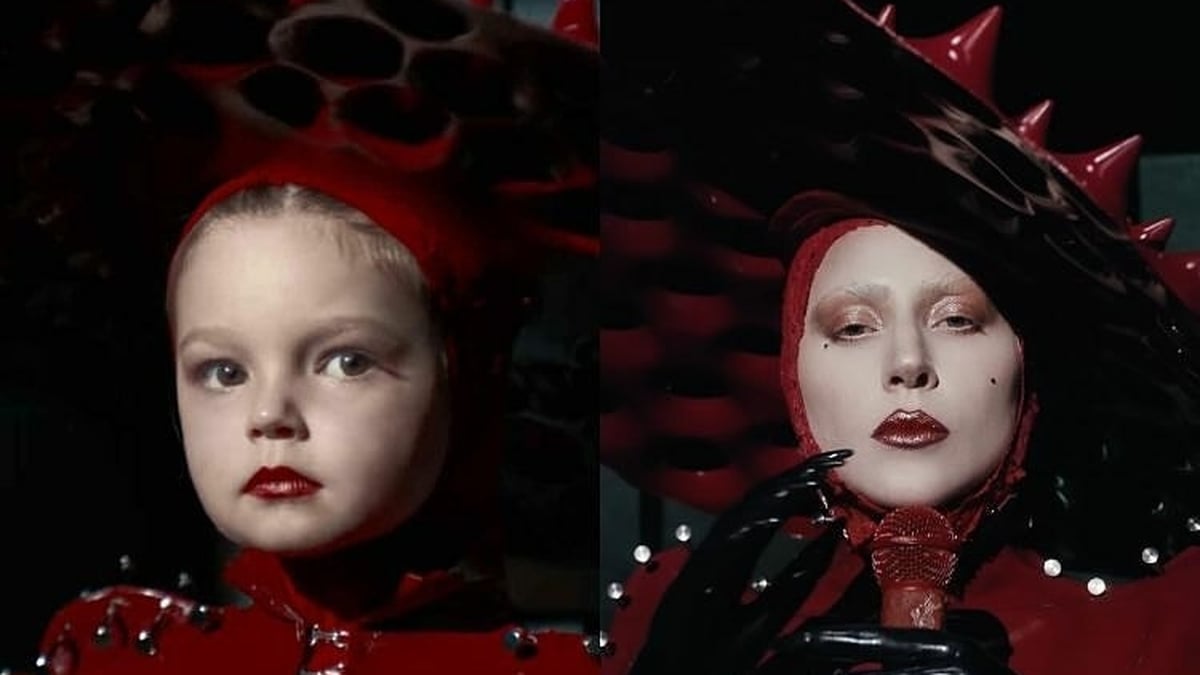




















































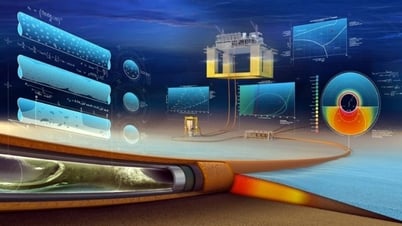



![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, reçoit le président de l'Association d'amitié Maroc-Vietnam](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/26/b5fb486562044db9a5e95efb6dc6a263)



































Comment (0)