Le poète du peuple du Daghestan, Rasul Gamzatov, a écrit dans son œuvre « Mon Daghestan » qu'une petite nation a besoin d'un grand poignard et qu'une petite nation a besoin d'un grand ami. Il y a 50 ans, le 27 janvier 1973, était signé l'Accord de Paris « sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam ». Il s’agit d’une victoire qui résulte de la force combinée de la nation, y compris de l’aide précieuse d’amis internationaux.

Le secrétaire d'État américain Henry Kissinger serre la main de M. Le Duc Tho - « Conseiller spécial » de la délégation du gouvernement de la République démocratique du Vietnam après la signature de l'Accord de Paris.
La longue et tendue bataille diplomatique
Peu de négociations ont duré aussi longtemps, avec autant de sessions, que la Conférence de Paris sur le Vietnam. La période de négociation a duré du 13 mai 1968 au 27 janvier 1973. Les négociations ont duré 4 ans et 8 mois avec 202 réunions officielles et 52 réunions fermées et secrètes. Le 13 mai 1968, la Conférence de Paris entre les deux parties s'ouvre.
Dès le début des négociations, les dirigeants du régime de Saïgon ont farouchement résisté. Plus tard, afin de se retirer rapidement du bourbier de la guerre du Vietnam, les États-Unis ont eu recours à des mesures sévères pour forcer le régime de Saïgon à accepter de signer les termes de l’accord.
Le 16 janvier 1973, le général Alexander Haig, conseiller du président Nixon au Conseil de sécurité nationale, remit à Nguyen Van Thieu une lettre de Nixon, que Kissinger qualifia de « fougueuse », qui comprenait le passage suivant : « Par conséquent, nous avons décidé de parapher définitivement l'accord le 23 janvier 1973 à Paris.
Si nécessaire, nous le ferons seuls. Dans ce cas, je dois expliquer publiquement que votre gouvernement fait obstacle à la paix. Le résultat fut l’arrêt inévitable et immédiat de l’aide économique et militaire américaine – et une réorganisation de son administration ne changerait rien à la situation (1) ». Sous la pression des États-Unis, la République du Vietnam fut finalement contrainte de signer l’accord.
Contenu essentiel de l'accord
Le contenu fondamental de l’Accord est que les États-Unis et les autres pays respectent l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Vietnam telles que reconnues par l’Accord de Genève sur l’intégrité territoriale du Vietnam. En conséquence, le Vietnam est un pays unifié, le Nord et le Sud ne sont pas deux pays séparés mais simplement deux zones de rassemblement militaire différentes.
Les parties ont mis en œuvre un cessez-le-feu dans tout le Vietnam à partir du 27 janvier 1973. Dans le Sud, toutes les unités militaires américaines et alliées, des deux côtés du Sud-Vietnam, sont restées en place (ne s'applique pas à l'armée de la République démocratique du Vietnam). Les États-Unis mettront fin à toutes les activités militaires américaines contre la République démocratique du Vietnam par toutes les forces sur terre, dans les airs, en mer... Les parties procéderont au retour des prisonniers de guerre.
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République démocratique du Vietnam s’engagent à respecter les principes d’autodétermination du peuple du Sud-Vietnam. La réunification du Vietnam se fera étape par étape, par des moyens pacifiques, sur la base de discussions et d’accords entre le Nord et le Sud Vietnam, sans coercition ni annexion de l’une ou l’autre partie et sans intervention étrangère.
Pour assurer et superviser la mise en œuvre de l'accord, une commission internationale de contrôle et de supervision et une commission militaire mixte quadripartite (comprenant la République démocratique du Vietnam, les États-Unis, la République du Sud-Vietnam et la République du Vietnam), ainsi qu'une commission militaire mixte bipartite (la République du Sud-Vietnam et la République du Vietnam) seront créées…
Victoire de la force nationale
La victoire de la signature de l’Accord de Paris est la victoire de la force combinée de la nation, y compris la victoire militaire et la victoire du soutien des amis internationaux.
La victoire militaire détermine la victoire diplomatique : à partir de la fin de 1964, après que le programme de « guerre spéciale » ait été menacé d'échec, les États-Unis ont été contraints d'augmenter leurs troupes sur le champ de bataille et de commencer des opérations militaires contre la République démocratique du Vietnam et ont fabriqué « l'incident du golfe du Tonkin » comme excuse pour attaquer le Nord-Vietnam.
Au moment même où la guerre de résistance de notre nation contre les États-Unis entrait dans sa phase la plus intense, en décembre 1965, notre Parti a publié la résolution 12 du Comité central, qui stipulait clairement que « à un moment donné, nous lutterons et négocierons en même temps », mais précisait que « la situation n'était pas encore mûre pour une solution ».
Le 31 mars 1968, le nombre total de troupes de la coalition américano-vietnamienne atteignait 1 375 747 soldats. En 1966, après que l’Armée de libération du Sud-Vietnam ait remporté une série de victoires, les États-Unis ont commencé à évoquer la solution des négociations de paix.
Au cours des trois premiers mois de 1967 seulement, la coalition américano-vietnamienne a organisé 884 opérations au niveau du bataillon ou à un niveau supérieur. Au cours des trois premiers mois de 1967, les forces aériennes des États-Unis et de la République du Vietnam ont effectué 151 044 sorties (dont 30 231 sorties de combat) et 37 851 sorties navales pour bombarder et reconnaître le Nord. Au cours de la période 1966-1967, les États-Unis et la République du Vietnam ont commencé à utiliser des produits chimiques toxiques pour défolier les zones de l'Armée de libération...
L'offensive et le soulèvement du Têt de 1968 ont porté un coup décisif à la stratégie de « guerre locale » des États-Unis. Le 31 mars 1968, le président Johnson annonce : l'arrêt unilatéral des bombardements du Nord à partir du 20e parallèle (90 % du territoire nord) et l'acceptation de négociations avec la République démocratique du Vietnam.
Victoire grâce au soutien de la communauté internationale : Sur la scène internationale, la réputation de l'Amérique a été sérieusement affectée, la vague d'opposition à la guerre, exigeant que l'Amérique s'assoie à la table des négociations, a fortement augmenté.
Début mars 1968, le secrétaire général des Nations Unies, U. Thant, a appelé les États-Unis à cesser de bombarder le Nord et a considéré cela comme une condition à la tenue de négociations. Le 14 mai 1968, dans un discours prononcé à l'Université d'Alberta (Canada), M. U. Thant, Secrétaire général des Nations Unies, « a clairement exprimé son soutien au point de vue de la République démocratique du Vietnam et a appelé le gouvernement américain à mettre en œuvre une cessation inconditionnelle et complète des bombardements du Nord (2) ».
Les dirigeants de nombreux pays du monde ont, d'une manière ou d'une autre, exprimé leur soutien au Vietnam depuis l'Inde, la Chine, la Yougoslavie, l'Algérie, la Tanzanie... Dans ses mémoires, Mme Nguyen Thi Binh raconte que lorsqu'elle s'est rendue en Inde à l'invitation du Premier ministre indien, le consul du gouvernement de Saigon en Inde s'y est opposé. Le gouvernement indien a officiellement répondu : « Nous avons le droit d’inviter n’importe qui (3) ».
Le Parti communiste français (PCF), une force politique très puissante en France à cette époque. Outre l’énorme aide matérielle apportée aux deux délégations vietnamiennes participant aux négociations, la France s’est également employée à mobiliser les forces politiques et populaires pour soutenir nos guerres de résistance et s’opposer à la guerre d’agression américaine ; a servi de pont entre le Vietnam et la France car à cette époque les deux pays n'avaient pas de relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs.
Victoire de la diplomatie populaire : Parallèlement à la diplomatie gouvernementale, le front diplomatique populaire a été pleinement utilisé. Les mémoires de Mme Nguyen Thi Binh disent : « Nous avons profité de chaque pays ou organisation qui nous a invités, en France, en Amérique, en Afrique ou en Amérique, profitant de chaque opportunité pour propager et mobiliser le peuple, les partis politiques et les gouvernements...(4) ».
Au cours des négociations, le Vietnam a créé un front populaire mondial, unissant toutes les forces politiques progressistes du monde. Les Américains progressistes ainsi que de nombreuses personnes progressistes à travers le monde ont organisé de nombreuses marches pour soutenir la juste lutte du peuple vietnamien.
Se souvenant de cet événement important, Mme Nguyen Thi Binh, ancienne vice-présidente, puis ministre des Affaires étrangères, cheffe de la délégation de négociation du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Vietnam, a été amenée à écrire dans ses mémoires qu’au moment de la signature de cet accord historique, elle fut extrêmement émue, pensant aux « compatriotes, camarades, amis du Nord comme du Sud… (…) la profonde gratitude que le monde entier éprouve pour le combat héroïque de notre peuple (5) ».
La situation mondiale et régionale évolue rapidement et devient de plus en plus complexe et imprévisible, notamment depuis la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Dans le contexte actuel, l’unité et la coopération de tous les compatriotes du pays et de l’étranger sont nécessaires de toute urgence. La grande victoire de la Conférence de Paris, il y a plus de 50 ans, nous offre de nombreuses leçons précieuses.
Il faut toujours être ferme et déterminé à protéger fermement l’indépendance et l’unité de la Patrie ; promouvoir la justice, les aspirations et la bonne volonté en faveur de la paix auprès de la communauté internationale ; combiner et promouvoir la force combinée de la nation dans les domaines politique, militaire et diplomatique ; Pour réaliser une grande unité nationale et une solidarité internationale... Dans les luttes diplomatiques, nous devons toujours être cohérents et maintenir une ligne indépendante et autonome, protéger résolument les intérêts de la nation et du peuple, et ne pas permettre aux forces extérieures de profiter ou d'interférer.
Vu Trung Kien
Académie politique régionale II
(1) Thien Phuong, L'effondrement inévitable d'un régime fantoche, l'échec inévitable d'une armée de mercenaires, journal Nhan Dan, 24 avril 2014
(2) Centre des Archives nationales II (2012), L'Accord de Paris de 1973 sur le Vietnam à travers les documents du gouvernement de Saïgon, Maison d'édition politique nationale, vol. 1, p. 75
(3) Nguyen Thi Binh (2012), Famille, amis, pays, Éditions Tri Thuc, p. 117
(4) Nguyen Thi Binh (2012), Famille, amis, pays, Éditions Tri Thuc, p. 110
(5) Nguyen Thi Binh (2012), Famille, amis, pays, Éditions Tri Thuc, p. 135
Source


![[Photo] Festival d'accompagnement des jeunes travailleurs en 2025](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/25/7bae0f5204ca48ae833ab14d7290dbc3)


![[Photo] Le président Luong Cuong reçoit le vice-président laotien Pany Yathotou](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/25/958c0c66375f48269e277c8e1e7f1545)
![[Photo] Le cercueil de l'ancien président Tran Duc Luong arrive à Quang Ngai](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/25/1f1aca0d92ab47deae07934e749b35e6)













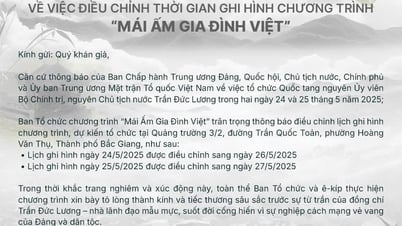










































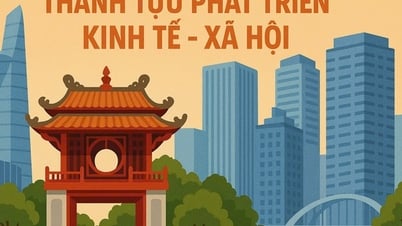

























Comment (0)