Chaque année, au plus fort de la saison des récoltes, la banlieue d'Hanoï et le nord du delta du Nil sont enveloppés d'une épaisse fumée blanche, réduisant la visibilité et provoquant des difficultés respiratoires. Cette fumée ne provient ni des usines ni des véhicules, mais du brûlage de la paille après la récolte. Bien que la loi l'interdise et mette en garde contre l'aggravation de la pollution atmosphérique, le problème persiste, constituant une importante source de pression environnementale.
Les coutumes ancestrales et le principe selon lequel « le droit public est inférieur au droit privé »
Selon le Département de la production végétale et de la protection des végétaux ( ministère de l'Agriculture et de l'Environnement ), environ 70 % des sous-produits agricoles sont encore brûlés à l'échelle nationale ; à Hanoï seulement, le taux de brûlage de la paille d'hiver-printemps atteint environ 20 %. Bien que la loi de 2020 sur la protection de l'environnement interdise formellement cette pratique et que le décret 45/2022/ND-CP prévoie une amende pouvant atteindre 3 millions de dongs, son effet dissuasif reste limité.


L'ancienne pratique des agriculteurs après chaque récolte (Photo : Journal Santé et Vie)
En réalité, le brûlage de la paille dans les zones rurales du Vietnam a souvent lieu le soir, dans des champs éloignés des habitations, et les forces de surveillance sont peu nombreuses, ce qui rend sa détection et son traitement difficiles. Bien que la loi de 2020 sur la protection de l'environnement et les décrets connexes prévoient des sanctions pour le brûlage de la paille, les inspections, la surveillance et l'application de la loi restent limitées dans la pratique. De nombreuses localités rencontrent des difficultés en matière de ressources humaines, de mécanismes de coordination et de moyens pour traiter les infractions, ce qui explique le manque de contrôle efficace du brûlage de la paille.
Plus précisément, le Comité populaire de Hanoï a publié la Directive 15/CT-UBND 2020 relative à la gestion du brûlage de la paille et des résidus de récolte, stipulant clairement : « Actuellement, le brûlage de la paille, des résidus de récolte, etc., est une pratique courante dans certaines localités. Toutefois, la gestion et le contrôle de ces pratiques présentent encore de nombreuses lacunes, ce qui entraîne une augmentation du brûlage de la paille à Hanoï (2022), Nghệ An (2025), Ninh Binh, Thaï Binh (2024), etc. »

Le phénomène consistant pour les agriculteurs à brûler la paille après chaque récolte a un impact sur la qualité de l'air.
En réalité, de nombreuses communes manquent de personnel spécialisé, si bien que beaucoup de cas d'infractions environnementales font l'objet d'une médiation. De plus, nombre d'entre elles craignent les conflits lorsqu'il s'agit de contrevenants résidant de longue date, entretenant des liens étroits avec la commune ou contribuant fortement à son économie. Cette attitude de « respect et d'évitement » conduit à ignorer les infractions au lieu de les traiter conformément à la réglementation, engendrant ainsi un climat d'anarchie et de récidive.

M. Pham Van Son, secrétaire général de l'Association vietnamienne pour la conservation de la nature et de l'environnement et directeur du Centre vietnamien d'intervention en cas d'incident environnemental
M. Pham Van Son, secrétaire général de l'Association vietnamienne pour la conservation de la nature et de l'environnement et directeur du Centre vietnamien de réponse aux incidents environnementaux, a déclaré : « En réalité, le problème ne réside pas dans un manque de réglementation ou de sanctions, mais dans leur mise en œuvre. Dans de nombreuses localités, le droit public prime sur le droit privé, ce qui engendre de nombreux obstacles à l'application des sanctions. En l'absence de documents et de mécanismes de contrôle et de soutien adéquats, il est très difficile de modifier des pratiques profondément ancrées… »
Problème économique : « Rapide, bon marché, pratique » ?
Comme on peut le constater, Les agriculteurs ont opté pour la « solution » du brûlage de la paille non seulement par habitude, mais aussi pour des raisons économiques : c’est rapide, propre et gratuit. En revanche, les méthodes alternatives telles que l’utilisation de produits microbiens, le compostage d’engrais organiques ou la production de granulés de biomasse nécessitent du matériel, du temps et des connaissances techniques, autant de ressources difficiles d’accès pour les agriculteurs.
Le marché de la paille est instable et son prix d'achat, trop bas pour couvrir les coûts de collecte et de transport, contraint les agriculteurs à privilégier la solution de facilité pour faire face aux aléas climatiques. Les bénéfices du traitement biologique, tels que l'amélioration des sols et l'augmentation des rendements rizicoles, ne se manifestent qu'après plusieurs saisons, tandis que le brûlage de la paille offre un résultat immédiat : un nettoyage instantané des champs.
Bien qu'il existe un cadre juridique clair, sa mise en œuvre sur le terrain reste difficile en raison d'habitudes agricoles profondément ancrées et d'un manque d'information sur les méthodes efficaces de valorisation de la paille. Le problème ne réside pas dans l'attente de soutien, mais dans le fait que les populations ne perçoivent pas les avantages économiques immédiats et à long terme de cette conversion. Lorsqu'on leur propose des points de vente et qu'on leur fournit des instructions sur le compostage ou la réutilisation de la paille, de nombreuses localités constatent une nette diminution du brûlage.

Le projet GAHP aide les agriculteurs à utiliser des produits microbiens pour traiter la paille.
Par ailleurs, correctement traitée, la paille peut devenir une ressource économique. Dans le cadre du projet 2024 « Réduction du brûlage à l’air libre et de l’utilisation de produits phytosanitaires » de l’Alliance mondiale pour la santé et la pollution (GAHP), financé par le gouvernement britannique via le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra), en coordination avec l’Association vietnamienne pour la conservation de la nature et de l’environnement (VACNE) en 2023-2024, de nombreux projets pilotes menés à An Giang, Ninh Binh et Dong Nai ont démontré que le traitement de la paille directement dans les champs à l’aide de produits microbiens permet de réduire significativement les émissions, d’améliorer la qualité des sols, de diminuer les coûts de production et d’accroître la productivité. Les estimations issues de ces projets pilotes indiquent que chaque hectare de riz pourrait générer un revenu supplémentaire de plusieurs millions, voire de plusieurs dizaines de millions de dongs (VND) si la paille est correctement valorisée.
Dans le même temps, plutôt que de se concentrer sur les subventions ou le soutien matériel, il est important d'aider les gens à percevoir les avantages économiques directs de l'utilisation de la paille, grâce à différents mécanismes : vente aux acheteurs, utilisation comme engrais organique, granulés de biomasse ou substrat de culture de champignons. Lorsque la chaîne de valeur est clairement établie, la paille devient une ressource. L'essentiel est de fournir des informations et des exemples concrets pour que les gens puissent se lancer en toute confiance, en évitant de créer une mentalité de dépendance. Constatant l'efficacité de cette démarche, la communauté s'y engagera spontanément.

Des experts du projet GAHP - VACNE aident les agriculteurs à utiliser la paille pour cultiver des champignons au lieu de la brûler (Photo : SOS)
M. Pham Van Son a également déclaré que si seules des sanctions sont appliquées sans alternatives adéquates, les agriculteurs auront du mal à changer leurs pratiques. Il est donc nécessaire de leur apporter des avantages concrets pour qu'ils comprennent que ne pas brûler la paille et la traiter avec des micro-organismes peuvent créer des conditions agricoles favorables et augmenter leurs revenus. Lorsqu'un modèle est concluant, son effet d'entraînement incitera de nombreuses autres localités à l'adopter, créant ainsi de nouvelles habitudes.
De « sans valeur » à « ressource »
La paille était autrefois considérée comme sans valeur, un déchet agricole… Cependant, aujourd’hui, dans le contexte du changement climatique et de la transition vers une agriculture plus verte, ces sous-produits (paille, résidus de maïs, pommes de terre, etc.) deviennent une ressource précieuse. Au lieu d’être brûlée, la paille peut servir de matière première pour la production de biens agricoles durables tels que les biocarburants, les granulés de biomasse ou la culture de champignons à partir de paille.

Les agriculteurs récoltent la paille pour transformer les sous-produits agricoles en « ressources ».
Ainsi, pour transformer les sous-produits agricoles considérés comme « sans valeur » en « ressources », la participation concertée des organismes de gestion étatiques, des collectivités locales, des entreprises et des citoyens est indispensable. Ce n’est que lorsque les politiques seront en phase avec les pratiques, que les lois seront rigoureusement appliquées et que les agriculteurs sauront comment valoriser les sous-produits agricoles de manière spécifique que la pratique du brûlage de la paille pourra être éradiquée.
La transformation durable ne s'amorce pas par l'attente, mais par l'action proactive de chaque maillon de la chaîne : les agriculteurs collectent et vendent la paille ; les entreprises d'achat et de transformation créent de nouveaux produits ; les collectivités locales assurent la liaison entre l'offre et la demande. L'ouverture des marchés existants, valorisant les avantages économiques et les sous-produits, permettra aux comportements d'évoluer naturellement, transformant la paille en un élément essentiel d'une agriculture verte, circulaire et à faibles émissions.
PV


![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse rencontrent la communauté vietnamienne en Algérie](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/19/1763510299099_1763510015166-jpg.webp)


![[Photo] Le Comité permanent du sous-comité d'organisation au service du 14e Congrès national du Parti se réunit pour un travail d'information et de propagande en vue du Congrès.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/19/1763531906775_tieu-ban-phuc-vu-dh-19-11-9302-614-jpg.webp)
![[Photo] Le secrétaire général To Lam reçoit le vice-Premier ministre et ministre de la Défense slovaque, Robert Kalinak](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/18/1763467091441_a1-bnd-8261-6981-jpg.webp)


















































































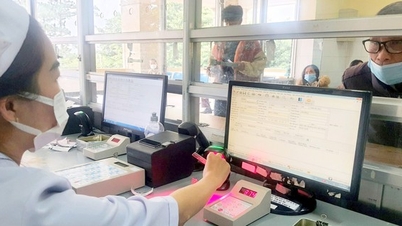
























Comment (0)