Les mouvements de protestation sociale consuméristes de 1968 en Europe ont orienté la littérature et l'art vers la sociologie et la politique .
Période de la littérature moderne
 |
| Écrivain I. Christensen. |
Dans les années 60, deux jeunes écrivains emblématiques, I. Christensen et Haw-Jorgen Niesen, revendiquaient un jugement de l'homme non pas selon ses valeurs intrinsèques, mais dans son rapport à la société. Tous deux affichaient un engagement profond envers la politique et la société. Cette tendance s'est perpétuée dans la génération des années 70.
De manière générale, les mouvements de protestation sociale et consuméristes de 1968 en Europe (et plus tard aux États-Unis) ont orienté les arts vers des voies sociologiques et politiques (débats sur les problèmes de société, émancipation des femmes). Les Danoises, en particulier, se sont montrées très actives (le journalisme d'investigation et l'art de l'interview se sont développés, même parmi les étudiantes et les ouvrières).
La poésie à vocation sociologique de Vita Andersen et P. Poulsen (exploration de la linguistique et de la structure) a marqué les années 1970. La génération des années 1970 a vu émerger des écrivains symbolistes, partagés entre poésie politique et romans historiques. Au début des années 1980, la révolte contre la société de consommation et d'abondance a refait surface.
E.K. Reich (né en 1940) allie matière historique et conscience politique non dogmatique. La Vie de Zénobie (1999) relate ses voyages entre le Danemark et la Syrie au Ve siècle. Hjernoe (né en 1938) utilise la matière, mais se concentre sur la linguistique et la philosophie. H. Bjelke (né en 1937) est influencé par James Joyce dans son œuvre majeure Saturu (1974), qui explore le mythe de la réincarnation, le moi fragmenté errant dans le présent et le monde mythique.
Il existe un genre littéraire plus compréhensible, difficile à classer (comme Saint Kaalo, né en 1945).
Le mouvement du réalisme social des années 1950 se poursuivit avec U. Graes (né en 1940) et les romans ouvriers et poèmes de L. Nielsen (né en 1935). L'ambition d'une société nouvelle s'exprimait à travers des rêves romantiques et révolutionnaires, comme en témoignent V. Lundbye (né en 1933) et R. Gjedsted (né en 1947).
L’engagement social et politique caractérise l’œuvre de M. Larsen (né en 1951). Vita Andersen (née en 1944) mêle les problématiques actuelles à des sentiments intimes, une thématique populaire dans les années 70.
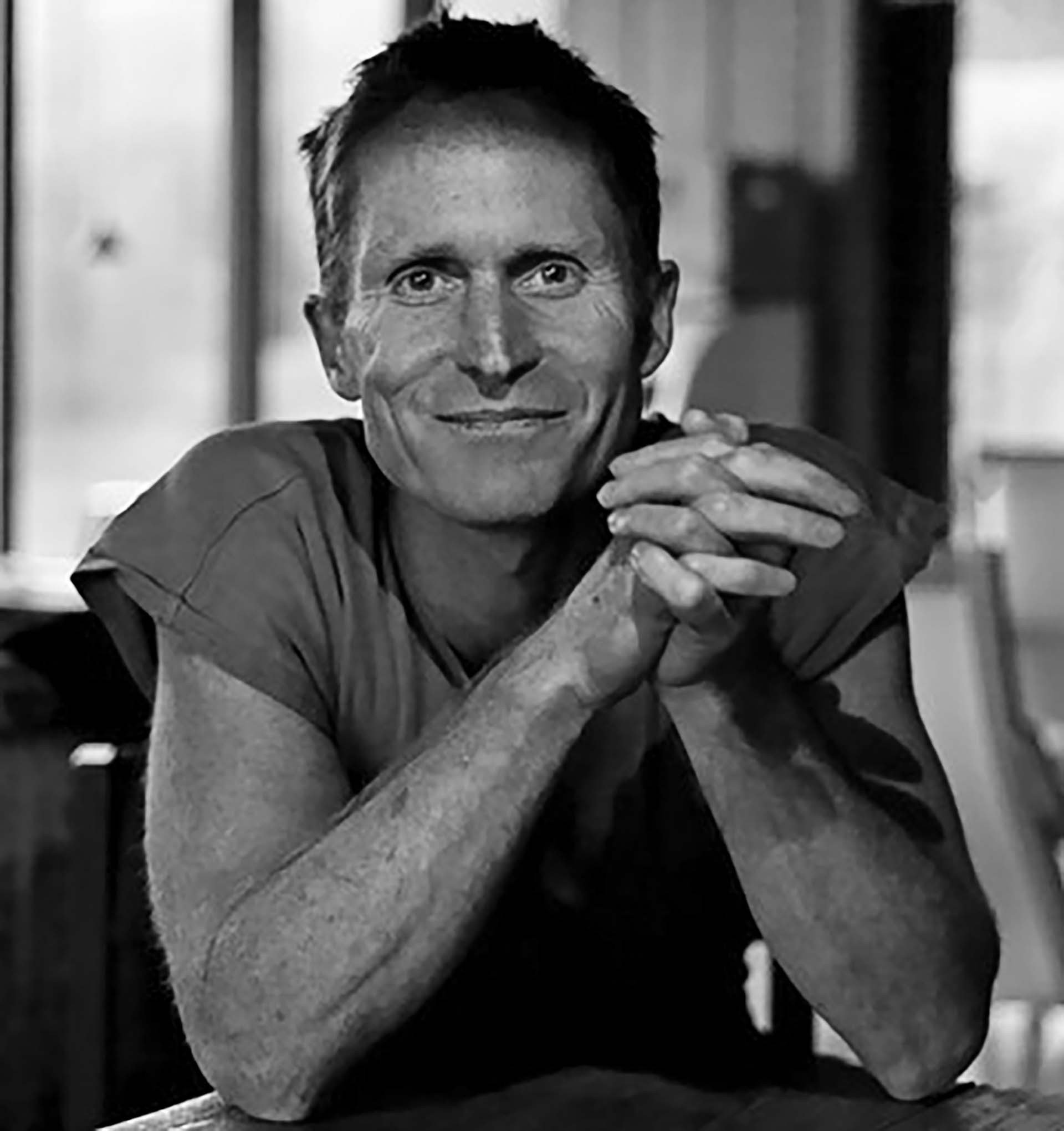 |
| L'écrivain Peter Hoeg. |
Le prix littéraire du Conseil nordique 2000 a été décerné au recueil de poésie « Les Ponts du rêve » d’Henrik Nordbrandt (né en 1945). Publié en 1998, ce recueil récompense l’ensemble de son œuvre poétique. Selon le jury, le pont est devenu un symbole de la vie, entre aller et venir, et simultanément un symbole de l’expérience de la perte et de la renaissance en poésie.
Dans les années 80 et 90, les lecteurs en avaient assez des récits sentimentaux de la vie quotidienne et des écrits formels dépourvus de toute forme ; parallèlement, le marxisme était éclipsé par les mouvements politiques non socialistes, et la littérature renouait avec ses véritables racines littéraires.
La nouvelle génération d'écrivains modernes (Michel Strunge, Bo Green Jensen, Pia Tardrup, Suren Ulrik Thomsen) a répondu à l'appel du rock tout en renouant avec les formes romantiques et symboliques, notamment en poésie. Henrik Stangerup, réaliste, s'est tourné vers l'histoire culturelle et le mythe. Ole Sarvig et Jorgen Bradt ont remis au goût du jour l'hymne. Ce genre a également été marqué par un regain de ferveur religieuse et la prise en compte des problématiques environnementales (Thorkild Björnvig, Vagn Lundbye).
Dans l'art du récit vivant, Kirsten Thurup (qui offre une palette sociale, réaliste et psychologique riche) et Suzanne Brogger (entre fiction et autobiographie) se sont distinguées. Peter Høeg, quant à lui, s'est imposé comme un grand écrivain danois et un auteur de renommée internationale.
Source



![[Photo] Lam Dong : Gros plan sur un lac illégal au mur brisé](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762166057849_a5018a8dcbd5478b1ec4-jpg.webp)








































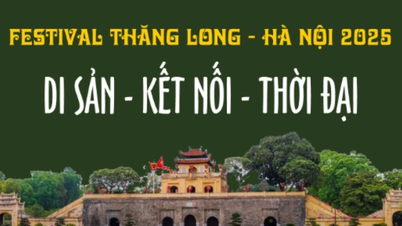




























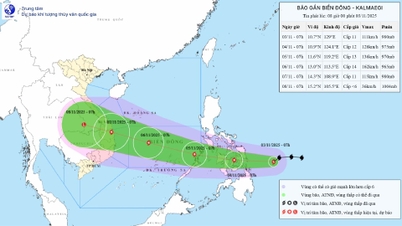





































Comment (0)