 |
| La pulvérisation d'herbicides est bénéfique à court terme, mais néfaste à long terme. Photo : Document |
Dans de nombreux champs, notamment de maïs, les herbicides sont souvent utilisés en prélude aux semis. Outre la production, on utilise également des produits chimiques pour traiter les clôtures, les trottoirs et les chemins de village, des endroits qui auparavant ne nécessitaient qu'un désherbage manuel. Le long des routes nationales, il n'est pas rare de voir apparaître de plus en plus fréquemment des plaques d'herbe jaunâtre et sèche, signe de pulvérisations récentes de produits chimiques.
Les raisons sous-jacentes à cette situation sont faciles à deviner. La main-d'œuvre rurale est rare, les jeunes quittent leurs villages et les personnes âgées restent cultiver. Dans ce contexte, les herbicides sont devenus une solution pratique et économique, choisie par de nombreux ménages. Par ailleurs, le manque de connaissances constitue également un problème majeur. De nombreux agriculteurs n'ont jamais été formés à l'utilisation des pesticides, ne lisent pas attentivement les étiquettes et ne savent pas distinguer les pesticides interdits des pesticides autorisés.
Cette « commodité » se paie par la dégradation des terres, la pollution des sources d'eau et les risques pour la santé publique. Les produits chimiques résiduels réduisent la microflore, détruisent la structure des sols, accentuent l'érosion et réduisent leur fertilité. Plus grave encore, certains pesticides peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, s'écouler avec les pluies dans les rivières et les ruisseaux, entraînant des conséquences à long terme. Alors que le monde évolue vers une agriculture écologique, biologique et circulaire, la surutilisation des herbicides va dans la direction opposée. Si nous ne changeons pas, l'agriculture de notre pays risque de perdre son avantage concurrentiel, notamment dans les exportations agricoles.
Pour enrayer cette tendance, une série de solutions synchrones est nécessaire. Tout d'abord, il est nécessaire de sensibiliser les populations. Les localités doivent intensifier et diversifier leur communication à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, par le biais de dépliants, d'affiches, etc., afin d'informer les villages des effets nocifs des herbicides sur les sols, l'eau et la santé humaine.
Parallèlement, les ministères et agences concernés doivent organiser des formations aux techniques agricoles sans pesticides, en apprenant aux agriculteurs à identifier les pesticides sûrs et interdits. Encourager l'utilisation de produits et d'engrais biologiques pour lutter contre les mauvaises herbes naturelles. Il est notamment nécessaire de développer les modèles d'agriculture écologique et biologique associés à la consommation de produits propres. La gestion du marché doit également être renforcée. Les établissements commercialisant des pesticides d'origine inconnue doivent être strictement contrôlés. La liste des pesticides interdits doit être rendue publique, mise à jour et facilement accessible.
Mettre fin à la surutilisation des herbicides ne se fera pas du jour au lendemain. Mais grâce aux efforts concertés du gouvernement, de l'industrie et de la population, nous pouvons progressivement bâtir une agriculture sûre et durable, où les sols ne sont pas empoisonnés uniquement pour « nettoyer l'herbe ».
Source : https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202508/thay-doi-thoi-quen-gay-hai-ee36527/










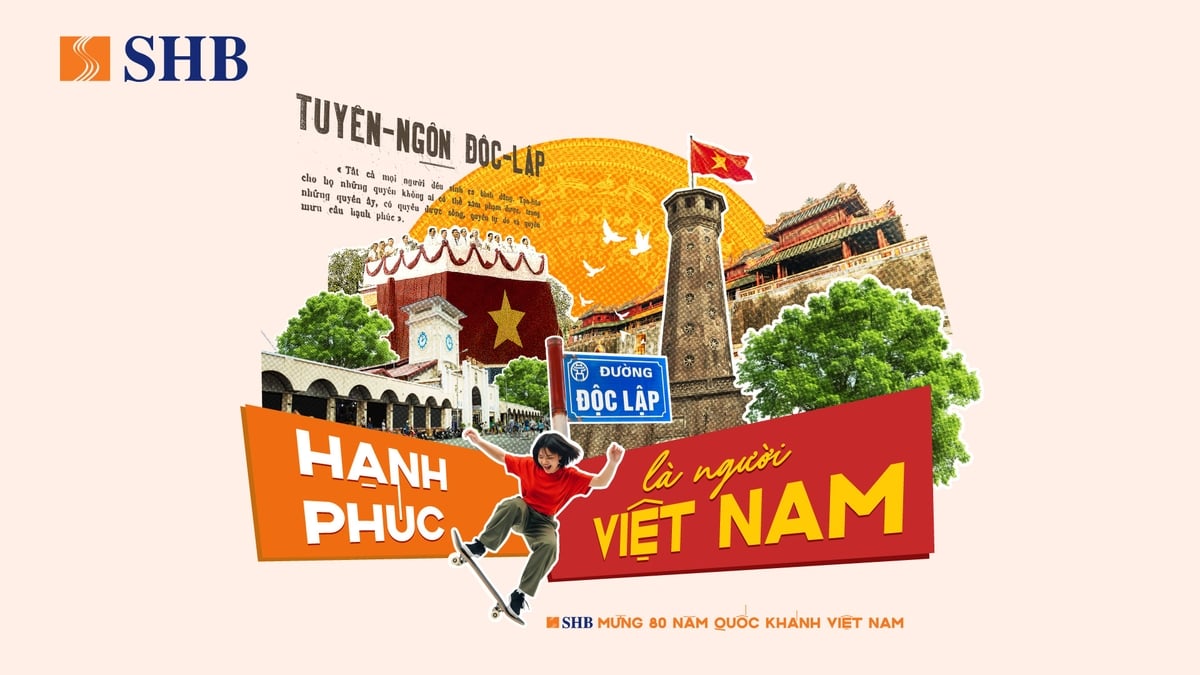




















































































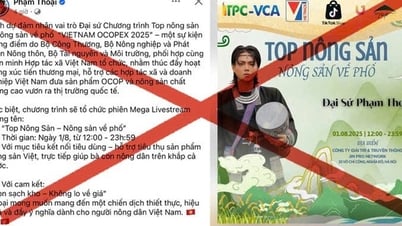





Comment (0)