Avec l'érudit Vuong Hong Sen, dans son ouvrage posthume inédit « À Man hoa tung dinh », il a consacré de nombreuses pages à cet événement. Tout d'abord, s'appuyant sur les documents de l'historien de Go Cong, Viet Cuc, il a rapporté et commenté avec précision et de manière très attrayante. Cependant, cela n'est pas unique ; le plus remarquable, pour nous, est ce que personne n'a mentionné depuis longtemps : l'histoire de la mère de l'érudit Vuong Hong Sen.
La vieille dame Hua Thi Hao (1878-1913), originaire du village de Tai Sum, également connu sous le nom de Xoai Ca Na à Soc Trang, est la personne dont M. Sen se souvient avec le plus grand amour. Il a déclaré : « Lorsque ma mère est décédée, les affaires de la maison, pourtant florissantes, ont soudainement stagné. La maison était vide, et j'étais extrêmement triste. Passionné de romans chinois, j'ai eu l'idée irréaliste de me suicider pour suivre ma mère. C'est de là que vient cette vague tristesse. »

Vieux marché de Go Cong
QUYNH TRAN a pris une photo du livre photo Southern Vietnam
Lorsque l'inondation de 1904 a dévasté tout le Sud, la mère de M. Sen avait 26 ans. Elle a raconté à son fils ce qu'elle avait vu, lorsque mère et fils étaient heureux ensemble. Dans cet ouvrage posthume, M. Sen a recueilli de nombreuses informations, essentielles aujourd'hui pour comprendre les pensées des habitants du Sud à cette époque, avant le grand désastre provoqué par la colère du ciel et de la terre. Par exemple : « La queue du dragon Giap Thin (1904), venue de Go Cong, a balayé la région côtière de Nam Ky. Les provinces de Tien Giang , de My Tho à Hau Giang (Soc Trang, Bac Lieu, Ca Mau…) ont été touchées. Les vieillards étaient simples, croyaient beaucoup aux contes chinois et aux arguments traditionnels, et croyaient à l'existence réelle du dragon. Chaque année, marquée par de fortes pluies et des vents violents, seule cette année Giap Thin (1904) a été la plus désastreuse. Tempêtes et ouragans étaient appelés « départ du dragon », « ascension du dragon »… ».
Inspiré par l'histoire, M. Vuong Hong Sen poursuit : « Cette année-là, j'avais à peine trois ans et je ne savais rien. Grâce à ma mère, qui m'a raconté plus tard, la tempête a duré toute la nuit. Le vent soufflait fort, la pluie battante. Couché sous la moustiquaire, on aurait dit un coup de feu retentissant. Le plus effrayant, c'est que le vent ne soufflait pas dans une seule direction, mais dans tous les sens. Malgré leur taille, les arbres n'ont pas résisté à la tempête. La rangée de tamariniers devant la vieille maison de mes parents a été déracinée. Le tamarinier, dont le tronc était si gros qu'on pouvait le serrer, est tombé sur le toit. Heureusement, la maison était neuve et le toit était solide, capable de supporter le poids du tamarinier. Au matin, le département artistique a envoyé un ouvrier qualifié couper chaque branche et a fait transporter la souche par une voiture. L'avenue devant la maison, anciennement appelée « rangée de tamariniers », a ensuite été rebaptisée « rue des étoiles ». et puis "rue Dai Ngai".
C'est l'histoire du village de Dai Ngai (Soc Trang), qu'en est-il de Go Cong ?
S'appuyant sur les documents de Viet Cuc, M. Sen a raconté l'histoire d'un vieil homme qui en fut témoin : « Le quinzième jour du troisième mois lunaire, il pleuvait et il y avait du vent de midi à l'après-midi, la pluie et le vent devenaient de plus en plus forts... Mon père sentit que le vent d'est était très fort, frappait le mur et brisait la porte, le toit de chaume volait. Mon père était très effrayé. Il prit une planche pour soutenir la porte, l'attacha soigneusement, mais le vent continuait de souffler. Il brisa d'abord le mur, les piliers de la maison se déformèrent, puis une tornade survint, emportant la moitié du toit, l'autre moitié s'effondra et écrasa le grenier à riz. Pris de panique, il entendit le chef du village crier : « L'eau déborde ! Oh mon Dieu ! Où aller ? »
Les horribles événements qui suivirent furent relatés en détail sur de nombreuses pages ; je ne citerai ici que le récit du jour suivant : « L’après-midi du 16, les survivants et le groupe partirent à la recherche de leurs proches. L’eau arrivait encore jusqu’aux genoux, des cadavres humains et animaux flottaient, des meubles gisaient en désordre dans les champs, dans les hameaux surpeuplés ; il ne restait plus que quelques piliers… »
Le matin du 17, l'eau s'était beaucoup retirée. Les gens se sont mis à la recherche de corps, de femmes, d'enfants, de proches, de parents et de frères. Certaines familles étaient mortes, il ne restait plus personne. Les corps étaient éparpillés un peu partout. Ce n'est que le 19 qu'ils ont organisé leur inhumation, les enterrant où ils les trouvaient. Il existe un poème similaire, que je vais copier ici :
Tuons-nous tous les uns les autres
Enterrez-le où que vous le trouviez, personne ne le portera.
Le corps est enterré parmi les morts et ne repose jamais en paix.
Où les survivants obtiennent-ils du riz et de l’argent pour manger ?
Pour en revenir à l'histoire racontée par la mère de M. Sen, nous savons que sa maison d'enfance se trouvait rue Dai Ngai, aujourd'hui rue Hai Ba Trung. M. Sen a raconté qu'au début du XXe siècle : « Cette route mène directement à l'estuaire de Dai Ngai. Il y a un quai en forme de jacinthe d'eau depuis My Tho pour livrer les documents officiels et les lettres, appelés « stations de poésie », de l'État, de Saïgon et d'autres villes. Aujourd'hui, les noms « voiture de verre », « voiture de papier », et le conducteur s'appelle xa ich (du français « sais », emprunté aux Arabes, signifiant « âne » ou « chariot à cheval »). La jeune génération et les nouveaux arrivants ne comprennent pas ce que cela signifie et doivent apprendre à lire la littérature et les romans anciens d'ici. »
M. Sen a raison. Les paroles des Sudistes concernant l'inondation de 1904 sont sans doute incompréhensibles aujourd'hui. Par exemple, à l'époque, on disait : « Mort, il faut être enterré immédiatement ». On disait souvent : « Mourir immédiatement, enterrer immédiatement ».
Mars est un mois orageux
Le mois de la mort n’est pas moins excitant.
Parce que les proches n'étaient pas autorisés à organiser des funérailles pour montrer leur piété filiale, il y avait de telles plaintes... De nos jours, à Go Cong, la coutume du troisième mois lunaire est toujours conservée, le 16e jour du troisième mois lunaire il y a un anniversaire de décès, et en mai, il y a encore des gens qui évitent de manger du riz et meurent (selon Viet Cuc).
Alors, comment le comprendre correctement ?
Selon M. Sen : « En cherchant dans le dictionnaire Huynh Tinh Cua, le dictionnaire Le Van Duc ainsi que dans celui de l'Association Khai Tri Tien Duc ( Hanoï ), je ne trouve pas le mot « nhon » pour parler de la mort. Je propose donc d'ajouter ce sens à notre langage afin de l'enrichir. En général, en matière de maladie, nous avons toujours été habitués à l'abstinence. Par exemple, pour la variole, nous utilisons les noms doux « len trai » et « trai toi », qui sont doux. Pour mourir, nous disons « mort », « da go »… Quant aux épidémies et aux maladies naturelles (peste, choléra), pour éviter le mot « ngay tay » qui sonne trop effrayant, nous utilisons ici le mot « chet nhon » avec le sens de « contraire aux symptômes, inhabituel ». J'espère que les sages approuveront. » (À suivre).
Lien source



![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président de l'Assemblée nationale hongroise Kover Laszlo](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/20/1760970413415_dsc-8111-jpg.webp)

![[Photo] Les habitants de Da Nang « chassent les photos » des grosses vagues à l'embouchure du fleuve Han](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/21/1761043632309_ndo_br_11-jpg.webp)
![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu M. Yamamoto Ichita, gouverneur de la province de Gunma (Japon)](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/21/1761032833411_dsc-8867-jpg.webp)




























































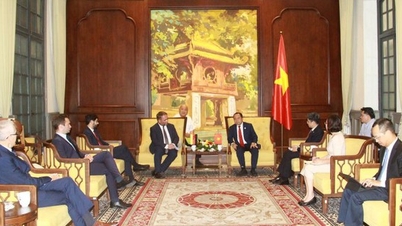
























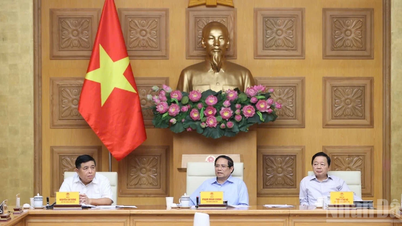







Comment (0)