La découverte de la première exolune par une équipe de l'Université de Columbia a été accueillie avec scepticisme par certains autres astronomes.

Simulation d'une exolune en orbite autour d'une planète extérieure au système solaire. Image : NASA GSFC/Jay Friedlander et Britt Griswold
Les astronomes ont toujours su que la découverte de lunes autour d'exoplanètes constituerait une avancée majeure, mais un débat a éclaté en planétologie , révélant la difficulté de repérer des exolunes, selon Live Science . L'histoire a commencé en 2018, lorsqu'une équipe de chercheurs, dont David Kipping, professeur adjoint d'astronomie à l'Université Columbia, a cru avoir découvert la première exolune. L'objet orbite autour de l'exoplanète Kepler-1625b, un monde semblable à Jupiter, situé à environ 8 000 années-lumière de la Terre. L'objet a été initialement découvert grâce au télescope spatial Kepler.
Lors de sa découverte, la lune de Kepler-1625b fut baptisée « Kepler-1625 b I ». Ce nom fut ensuite confirmé grâce aux données du télescope spatial Hubble. En 2022, une autre équipe, incluant également Kipping, semble avoir découvert une deuxième exolune, utilisant cette fois Kepler seul. L'objet orbite autour de Kepler-1708 b, une géante gazeuse située à 5 400 années-lumière de la Terre et dont la masse est 4,6 fois celle de Jupiter. Cette deuxième exolune potentielle est également nommée « Kepler-1708 b I », comme la première.
La technique utilisée pour détecter les deux exoplanètes est similaire à la méthode des transits, qui a permis d'ajouter plus de 5 000 planètes au catalogue des exoplanètes à ce jour. Cette méthode repose sur la détection de légères baisses de luminosité émise par une étoile hôte, qui se produisent lorsqu'une planète passe devant elle depuis la Terre. Le même principe s'applique aux exolunes, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Si ces lunes sont bien positionnées autour de leur planète lors de son transit, cela entraînera également une légère baisse de luminosité.
De si faibles baisses de luminosité sont cependant un indice de l'existence de Kepler-1625 b I et Kepler-1708 b I pour le camp des exolunes. Cependant, les baisses causées par les exolunes sont si faibles qu'elles ne peuvent être observées directement. Les chercheurs doivent donc utiliser de puissants algorithmes informatiques pour les déduire à partir des données des télescopes.
Kipping a expliqué que son équipe et l'équipe adverse dirigée par René Heller utilisaient le même ensemble de données provenant du même télescope, mais que la disparition de Kepler-1625 b I et Kepler-1708 b I pourrait être due à la façon dont les équipes ont traité les données avec leurs algorithmes. Kipping a suggéré que Kepler-1708 b I pourrait avoir échappé à Kipping en raison du logiciel choisi pour analyser les données de Hubble et de Kepler. Bien que cela soit lié au logiciel utilisé par l'équipe de Kipping, celui de Heller est légèrement différent. Kipping a également suggéré que l'équipe de Heller utilise son logiciel car il est généralement très fiable en dehors de ses paramètres par défaut et sensible à certaines étapes de traitement des données. Cela pourrait expliquer pourquoi les exolunes ont été exclues des calculs.
Pour Kepler-1625 b I, Heller et ses collègues ont suggéré que l'effet d'« assombrissement du bord stellaire », dans lequel le bord d'une étoile est plus sombre que son centre, affecte le signal d'exolune. L'équipe de Heller a soutenu que cet effet explique mieux les observations de l'étoile hôte que l'atténuation causée par une exolune. Kipping a déclaré que cette approche n'est pas appropriée pour une exolune potentielle, car son équipe a pris en compte l'assombrissement du bord stellaire pour décrire l'existence de Kepler-1625 b I. Heller et son équipe ne croient pas à l'existence de Kepler-1625 b I et de Kepler-1708 b I.
À tout le moins, Heller et Kipping s'accordent à dire que des recherches plus approfondies sont nécessaires. Si les exolunes apparaissent lors des transits, c'est parce qu'elles sont des objets massifs de la taille de sous-Neptune, avec un diamètre compris entre 1,6 et 4 fois celui de la Terre. Si elles existent, elles sont massives. Kipping pense que c'est en partie la raison pour laquelle elles sont trop inhabituelles pour être considérées comme les premières exolunes. Il prévoit d'utiliser le télescope spatial James Webb (JWST) pour rechercher d'autres exolunes ressemblant davantage à nos propres lunes du système solaire.
An Khang (selon Live Science )
Lien source











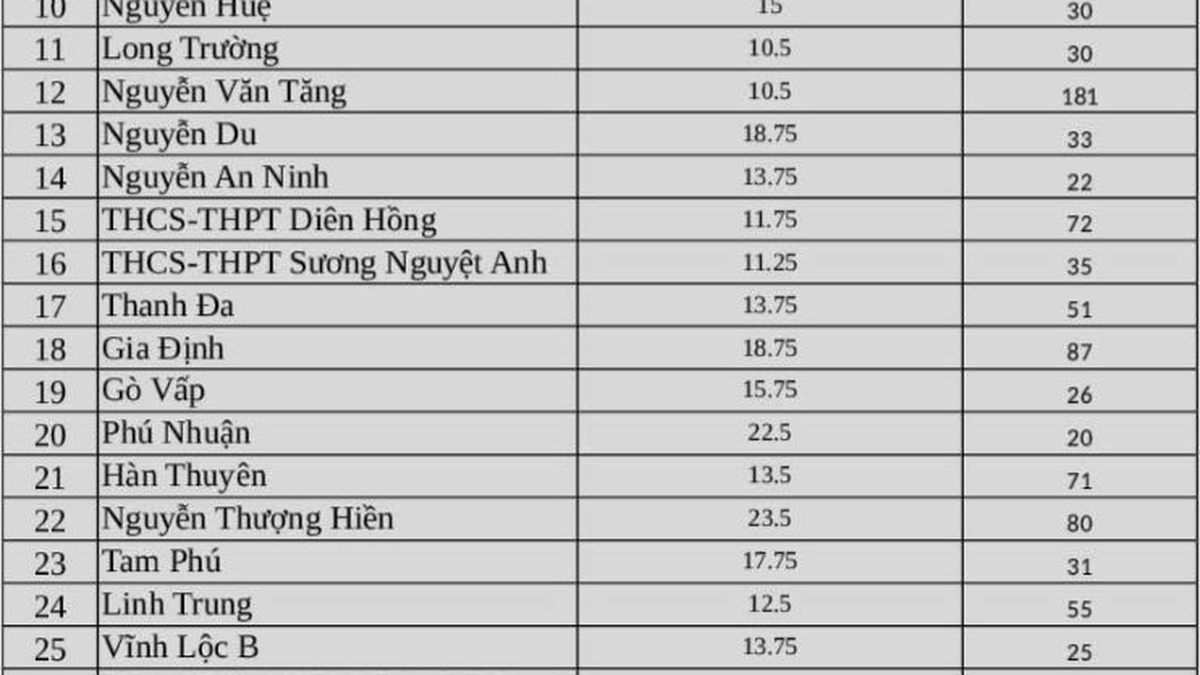













![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale participe au séminaire « Construire et exploiter un centre financier international et recommandations pour le Vietnam »](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)








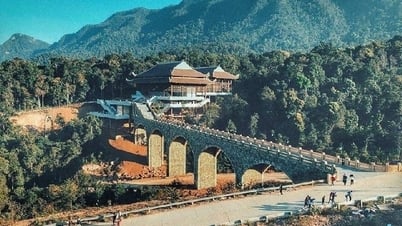

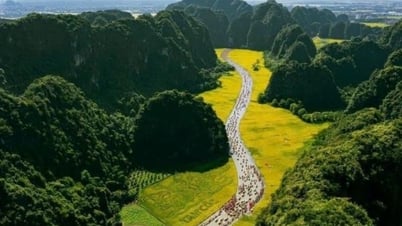



































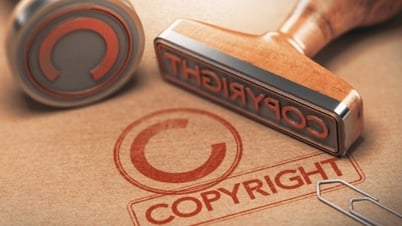




























Comment (0)