
La TGPL est une politique humanitaire visant à garantir les droits humains, les droits civiques et l'accès à la justice pour les groupes « vulnérables ». Photo d'illustration.
La nature et le rôle de l'aide juridique
L'aide juridictionnelle est une politique humanitaire visant à garantir les droits humains, les droits civiques et le droit d'accès à la justice des groupes « vulnérables », en permettant aux personnes pauvres et défavorisées d'être protégées rapidement et sur un pied d'égalité devant la loi. Contrairement à certains pays qui facturent une partie ou réduisent les frais d'aide juridictionnelle, le Vietnam applique une politique d'aide juridictionnelle entièrement gratuite pour les personnes éligibles dans tous les domaines du droit (civil, pénal, administratif), à l'exception du droit commercial.
Après près de 30 ans de formation et de développement, l'aide juridictionnelle a affirmé sa place et son rôle dans la mise en œuvre des politiques de sécurité sociale. Le Vietnam affirme : « L'aide juridictionnelle est la responsabilité de l'État. L'État met en œuvre des politiques visant à garantir le droit à l'aide juridictionnelle en fonction des conditions socio -économiques. » L'État s'acquitte de cette responsabilité en créant des organismes d'aide juridictionnelle, dont le Centre national d'aide juridictionnelle, et en mobilisant simultanément les ressources sociales pour participer à ces actions.
Conformément à la loi de 2017 sur l'aide juridique, les bénéficiaires de cette politique comprennent les pauvres, les personnes ayant contribué à la révolution, les enfants et les personnes accusées de crimes tels que prescrits... Grâce à l'aide juridique, les droits et intérêts légitimes des personnes sont protégés pendant le processus de litige, la résolution des conflits et les plaintes, contribuant ainsi à limiter les condamnations injustifiées, à protéger les droits de l'homme et à renforcer la confiance dans la justice.
TGPL est un service public humanitaire à but non lucratif, garanti par l'État, doté d'un budget et d'un personnel qualifié. Cette activité contribue à réduire la pauvreté juridique et à rapprocher les connaissances juridiques des populations, notamment dans les zones reculées et les minorités ethniques, contribuant ainsi à promouvoir un développement socio-économique durable.
Après huit ans de mise en œuvre de la loi de 2017 sur l'aide juridictionnelle, le système d'aide juridictionnelle est mieux organisé et la qualité des dossiers a été améliorée grâce à des critères d'évaluation spécifiques. Le rôle des conseillers juridiques est de plus en plus reconnu, et les citoyens leur font de plus en plus confiance et les choisissent pour traiter leurs dossiers. Les conseillers juridiques détiennent le titre professionnel le plus élevé (grade I), confirmant ainsi leur place et leur rôle dans le système des titres professionnels des fonctionnaires.
La coordination entre les services de poursuite et le Centre d'aide juridictionnelle a été renforcée, notamment grâce au programme de permanences d'agents d'aide juridictionnelle au tribunal. Cela permet aux accusés, aux victimes et aux justiciables bénéficiant de l'aide juridictionnelle d'accéder rapidement aux services et de ne pas perdre leurs droits pendant la procédure. De nombreuses localités ont mobilisé activement avocats et organisations sociales pour participer à l'aide juridictionnelle, tout en favorisant la communication.
« Goulots d'étranglement » à supprimer
Malgré de nombreux résultats positifs, le travail pratique de l'aide juridictionnelle révèle qu'il subsiste de nombreux obstacles à surmonter, notamment : les bénéficiaires ne couvrent pas tous les groupes vulnérables. La loi ne prévoit pas d'aide juridictionnelle pour les ménages sortant de la pauvreté, les mineurs victimes d'infractions pénales ou les personnes handicapées mises en examen. Le champ d'application de l'aide reste limité. Actuellement, elle se concentre uniquement sur les affaires civiles, pénales et administratives, alors que le besoin de conseils juridiques économiques pour sortir de la pauvreté est en augmentation.
De plus, la responsabilité des autorités locales n'est pas clairement définie. La loi ne précise pas la responsabilité du comité populaire communal dans l'accès à l'aide juridictionnelle.
De nombreuses localités manquent de personnel d’aide juridique et de financement pour les dossiers d’aide juridique ; les installations et l’infrastructure informatique sont encore faibles et ne parviennent pas à répondre aux exigences de la transformation numérique.
De plus, la sensibilisation de la population reste limitée. Une partie de la population, notamment dans les zones reculées, ignore l'existence de la TGPL. Dans de nombreux endroits, les efforts de communication manquent d'innovation et sont loin de refléter la réalité des coutumes et pratiques locales.
Dans le contexte des nombreuses nouvelles politiques d'amélioration institutionnelle, d'intégration internationale et de transformation numérique, la loi sur l'aide juridictionnelle doit être étudiée, amendée et complétée afin de moderniser l'aide juridictionnelle et de mieux répondre aux besoins de la population. Le projet d'élaboration d'une loi modifiant et complétant plusieurs articles de la loi de 2017 sur l'aide juridictionnelle est proposé pour inscription au programme législatif de 2026.
Le projet de loi se concentrera sur les contenus suivants : élargir le champ d’application de l’aide juridique aux ménages qui viennent de sortir de la pauvreté, aux mineurs victimes d’affaires pénales, aux personnes handicapées accusées de crimes, etc. ; élargir le champ de l’aide juridique au-delà des domaines civil, pénal et administratif ; décentraliser et déléguer fortement le pouvoir, en donnant aux autorités locales l’autorité d’évaluer et d’apprécier la qualité des dossiers.
Parallèlement, moderniser le système d’aide juridique, accroître l’application de la technologie, construire une plateforme numérique, déployer l’aide juridique en ligne pour un accès plus large ; développer un réseau de collaborateurs, d’avocats et un mécanisme de coordination avec les autorités locales.
L'amendement de la loi non seulement supprime les goulots d'étranglement, mais constitue également une avancée dans la mise en œuvre de la résolution n° 27-NQ/TW, de la résolution n° 66-NQ/TW et de la résolution n° 57-NQ/TW sur l'innovation dans le travail juridique, la transformation numérique et la modernisation des services publics.
Il apparaît clairement que la loi sur l'aide juridictionnelle n'est pas seulement une politique juridique, mais aussi un symbole de justice sociale, un moyen pour tous, en particulier les groupes vulnérables, d'accéder à la justice. Modifier cette loi est une urgence pour garantir la protection des droits légitimes de chacun et contribuer à l'édification d'un véritable État de droit.
Dieu Anh
Source : https://baochinhphu.vn/tro-giup-phap-ly-bao-dam-tiep-can-cong-ly-binh-dang-truoc-phap-luat-102250905104310789.htm


![[Photo] Le secrétaire général To Lam a reçu la délégation participant à la conférence internationale sur les études vietnamiennes](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/26/1761456527874_a1-bnd-5260-7947-jpg.webp)

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres assistent à la conférence de presse de la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/25/1761391413866_conguoctt-jpg.webp)


![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à l'ouverture du 47e sommet de l'ASEAN](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/26/1761452925332_c2a-jpg.webp)
















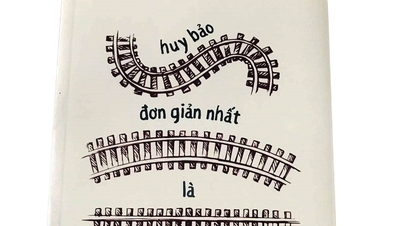














![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, reçoit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/25/1761390815792_ctqh-jpg.webp)


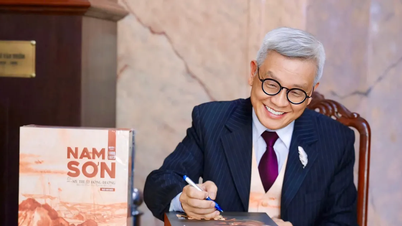









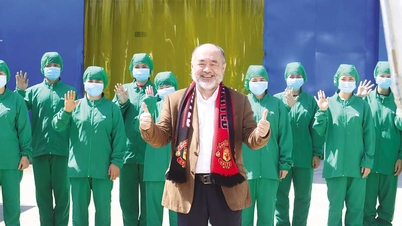






















































Comment (0)