Le président américain Donald Trump signe un décret fiscal à la Maison Blanche, le 2 avril 2025. Source : AFP.
Sur le concept de surprise stratégique
Dans la recherche en relations internationales, la « surprise stratégique » est souvent comprise comme un événement soudain, échappant aux prévisions habituelles, affectant directement les intérêts et la sécurité nationaux, obligeant ainsi le pays à ajuster fondamentalement sa politique étrangère et son orientation stratégique (1) . Même pleinement informés, les décideurs politiques peuvent sombrer dans la passivité en raison de biais cognitifs et de contraintes de temps, les empêchant de percevoir correctement la nature des nouvelles menaces.
De même, dans son importante étude sur l'attaque surprise de Pearl Harbor (États-Unis) en 1941, la chercheuse Roberta Wohlstetter a souligné que disposer de davantage d'informations ne permet pas toujours d'éviter les surprises stratégiques (2) . En réalité, l'incapacité à prévoir et à prévenir les surprises stratégiques n'est souvent pas due à un manque d'information, mais à l'important « bruit » inévitable lors du traitement d'une masse d'informations. Ce défi devient encore plus aigu à l'ère du numérique, où les pays sont confrontés à un flux massif d'informations et de données provenant de sources multiples, et où, parallèlement, la situation internationale évolue de manière exponentielle.
D'un autre point de vue, le chercheur Erik Dahl met l'accent sur deux facteurs clés pour prévenir la surprise stratégique : la précision des informations au niveau tactique ; la réceptivité des décideurs politiques aux avertissements (4) . En comparant la participation américaine à la bataille de Pearl Harbor et à la bataille navale de Midway dans le Pacifique , Erik Dahl souligne que le succès de la prévention de la surprise stratégique dépend non seulement de la capacité à analyser la stratégie globale, mais aussi de la nécessité de disposer d'informations précises et exploitables, ainsi que de la capacité des dirigeants à les recevoir et à les traiter. Cette théorie est particulièrement précieuse dans le contexte actuel, où les pays sont confrontés à de nombreux nouveaux types de défis sécuritaires, du terrorisme aux cyberattaques, qui nécessitent une combinaison harmonieuse de capacité de collecte d'informations et de capacité de décision rapide de l'appareil décisionnel.
En général, les études montrent que la surprise stratégique est multidimensionnelle et complexe, et peut avoir de multiples causes. Il s'agit d'un défi global, impliquant des facteurs cognitifs, organisationnels et systémiques, qui exige des pays qu'ils mettent en place un processus et un système complets combinant la capacité de collecter et de traiter des informations détaillées, l'aptitude à analyser la stratégie et la flexibilité du processus décisionnel. Dans un contexte géopolitique mondial de plus en plus incertain, avec l'émergence d'innovations de rupture telles que l'intelligence artificielle (IA), le big data et les nouvelles formes de conflit dans le cyberespace, la capacité à identifier et à réagir à la surprise stratégique devient une compétence essentielle pour garantir la sécurité nationale.
Expérience internationale en réponse aux surprises stratégiques
Une étude des conflits internationaux a montré que jusqu'à 68 cas de surprise stratégique ont été recensés au XXe siècle, apparaissant souvent après des périodes de tension et de crise (4) . Cette caractéristique suggère un paradoxe fondamental dans l'étude de la surprise stratégique : même lorsque des signes avant-coureurs apparaissent, l'État peut rester passif en raison de ses difficultés à les identifier et à y réagir.
Depuis 1945, la nature de la surprise stratégique a fondamentalement changé. Premièrement, son champ d'application s'est étendu au-delà du domaine militaire traditionnel, incluant les attaques terroristes, les cyberattaques et les crises économiques et financières aux répercussions géopolitiques. Deuxièmement, la technologie est devenue une variable importante, créant de nouveaux outils de prévision et de prévention, et ouvrant de nouvelles voies d'attaque et de surprise. Troisièmement, les conflits régionaux, bien que limités en ampleur, peuvent avoir des conséquences stratégiques mondiales par l'effet de chaîne et l'interconnexion croissante du système international.
La crise des missiles de Cuba de 1962 a montré que la surprise stratégique pouvait résulter d'une mauvaise évaluation de la tolérance au risque de chaque pays. Les conséquences de cette crise ont conduit à la mise en place d'une ligne directe entre l'Union soviétique et les États-Unis et d'un mécanisme de dialogue régulier entre les deux superpuissances, ainsi qu'à la conclusion de nombreux traités sur le contrôle des armes nucléaires au cours des décennies suivantes (5) .
Parallèlement, la guerre du Kippour de 1973 entre les États arabes et Israël est un exemple classique de la manière dont une coalition d'États peut créer la surprise stratégique en exploitant les « angles morts » de la réflexion stratégique de ses adversaires. Après sa victoire écrasante lors de la guerre des Six Jours de 1967, Israël a élaboré un « concept de défense » fondé sur sa croyance en une supériorité militaire absolue et sa doctrine d'alerte avancée (6) . L'Égypte et la Syrie ont exploité avec succès cette faiblesse de réflexion, menant une campagne de diversion sophistiquée pendant des mois, comprenant plus de 40 exercices de grande envergure le long de la frontière, faisant progressivement perdre à Israël sa vigilance face à ces activités militaires. Parallèlement, l'Égypte et la Syrie ont également exploité des facteurs culturels, religieux (choix de la fête du Kippour) et géostratégiques (attaque simultanée sur deux fronts) pour maximiser l'effet de surprise.
L'expérience de cette guerre a profondément modifié l'approche israélienne face au problème de la surprise stratégique (7) . Premièrement, Israël a créé une unité chargée de remettre en question les hypothèses stratégiques dominantes afin de réduire les angles morts dans l'analyse du renseignement. Deuxièmement, il a mis en place un système d'alerte précoce multicouche, combinant des éléments technologiques et humains, avec une attention particulière portée à la surveillance des moindres variations de l'environnement stratégique. Troisièmement, il a élaboré une doctrine de « défense multicouche », ne s'appuyant pas sur une seule couche de défense, aussi sophistiquée soit-elle. Cet enseignement est considéré comme toujours précieux pour les États de petite et moyenne taille dans le contexte actuel.
À l'aube du XXIe siècle, l'attentat terroriste contre le World Trade Center et le Pentagone aux États-Unis (11 septembre 2001) a posé un nouveau défi pour identifier et gérer les surprises stratégiques. La surprise ne résidait pas dans la collecte d'informations, car de nombreux rapports de renseignement mentionnaient l'organisation terroriste Al-Qaïda avant l'attentat, mais dans l'incapacité de relier ces informations fragmentées pour en dresser un tableau complet (8) . Le rapport de la Commission nationale américaine sur les attentats terroristes aux États-Unis (également connue sous le nom de Commission du 11 septembre), créée par le président George Bush en 2002, indiquait également que cela résultait d'un manque d'imagination et de limitations organisationnelles au sein des services de renseignement américains, ce qui entravait le partage d'informations importantes au sein de l'ensemble du réseau des agences de sécurité. Peu de temps après, les États-Unis ont entrepris la réforme la plus radicale de l’histoire du secteur du renseignement, notamment la création d’un poste de directeur du renseignement national (DNI), la restructuration des processus de partage d’informations et la construction d’un centre d’analyse interinstitutions.
Alors que les États-Unis se concentrent sur une réforme institutionnelle de grande envergure, certains pays de petite et moyenne taille ont développé des approches différentes pour faire face aux surprises stratégiques. Singapour, de par sa situation géostratégique sensible et vulnérable, a mis en place un système d'alerte global reposant sur trois piliers. Premièrement , le développement de capacités de prévision stratégique par l'intermédiaire du Bureau national des scénarios et du Centre national de situation, en mettant l'accent sur l'élaboration de scénarios et des exercices d'intervention réguliers. Deuxièmement, le renforcement de la résilience de la société tout entière grâce au programme de « défense totale », qui contribue à préparer la mentalité et la capacité de réaction de la population aux situations d'urgence (9) . Troisièmement, le maintien d'un réseau diversifié de relations extérieures afin de disposer de multiples sources d'information et de soutien en cas de besoin. Par ailleurs, Singapour a activement imbriqué ses intérêts avec ceux des grands pays en attirant des entreprises de premier plan des États-Unis, de la Chine et de l'Union européenne (UE) pour y établir leur siège. Le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Conseil de coopération économique du Pacifique (PECC) et de nombreuses autres institutions internationales ont également leur siège à Singapour.
L’expérience internationale permet de dégager certaines caractéristiques communes des approches efficaces en matière de surprise stratégique.
Premièrement, il est important de mettre en place un système d'alerte précoce à plusieurs niveaux, s'appuyant non seulement sur la technologie ou le renseignement technique, mais aussi sur diverses sources d'information, allant des analyses diplomatiques aux analyses universitaires. Les expériences d'Israël et de Singapour montrent que la création de groupes d'experts chargés de remettre en question les hypothèses stratégiques largement acceptées est essentielle pour éviter les « angles morts » dans le processus décisionnel.
Deuxièmement, les pays qui réussissent à réagir aux surprises stratégiques développent souvent une approche globale qui va au-delà des simples solutions militaires et technologiques. Tout en maintenant leurs capacités traditionnelles de dissuasion et de défense, ces pays accordent une importance particulière au renforcement de la résilience de la société dans son ensemble (résilience sociale). Le modèle de « défense totale » des pays nordiques en est un exemple typique. La Suède et la Finlande ont développé des programmes systématiques pour renforcer la sensibilisation et la résilience de leurs populations en situation de crise, des conflits armés aux défis sécuritaires non traditionnels, tels que les cyberattaques ou la guerre de l'information (10) . Cette approche contribue à créer une importante « zone tampon », contribuant à minimiser l'impact des chocs stratégiques et à renforcer la capacité d'adaptation du pays aux situations imprévues.
Troisièmement, dans le contexte de la mondialisation et de l'interdépendance croissante, les petits et moyens pays ont développé des méthodes innovantes pour améliorer leur prévisibilité et leurs capacités de réaction. Par exemple, en construisant un réseau diversifié de partenaires, en participant activement aux mécanismes de coopération régionale et internationale et en maintenant une certaine flexibilité en matière de politique étrangère afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un partenaire particulier.
Quatrièmement, le renforcement des capacités de réaction aux surprises stratégiques est un processus continu et adaptatif. Les menaces sont de plus en plus diverses et complexes, exigeant une approche globale et flexible, capable d'intégrer les nouveaux enseignements et de s'adapter aux changements de l'environnement stratégique. Il s'agit d'une expérience précieuse dont les petits et moyens pays peuvent s'inspirer pour perfectionner leur capacité à anticiper et à réagir aux surprises stratégiques dans le nouveau contexte.
Évitez d’être passif et surpris dans des situations nouvelles
Le Vietnam est confronté à un environnement international de plus en plus complexe et imprévisible. Premièrement, la concurrence entre les grandes puissances, notamment entre les États-Unis et la Chine, crée de nouvelles pressions et de nouveaux défis pour les petits et moyens pays de la région. Cette tendance se manifeste non seulement dans la géopolitique traditionnelle, mais aussi clairement dans les domaines de la technologie, du commerce et des chaînes d'approvisionnement mondiales. Deuxièmement, les défis sécuritaires non traditionnels, tels que le changement climatique, la cybersécurité, les épidémies, etc., imposent de nouvelles exigences en matière de prévision et de réponse. Troisièmement, la question de la mer Orientale continue de se développer de manière complexe, avec des enjeux étroitement liés entre la souveraineté territoriale, la liberté de navigation et la gestion des ressources marines.
De plus, les conflits et les « points chauds », de l'Ukraine à la péninsule coréenne, montrent que l'environnement sécuritaire régional peut évoluer rapidement et profondément. Parallèlement, le développement de nouvelles applications, telles que l'IA, les armes hypersoniques et les cybercapacités, crée de nouveaux défis pour identifier et gérer les surprises stratégiques. Dans ce contexte, la capacité à maintenir l'initiative stratégique et à éviter la passivité et la surprise devient plus importante que jamais.
Durant la période révolutionnaire, le président Ho Chi Minh a fait preuve d'une vision stratégique profonde et d'une capacité à anticiper et à saisir habilement les opportunités, comme en témoignent de nombreuses décisions historiques importantes, telles que le déclenchement de l'Insurrection générale d'août 1945 et la Guerre de résistance nationale de 1946. Héritant et développant cette idéologie dans un contexte nouveau, le concept de « ne pas être passif ni surpris » a été formalisé dans la résolution n° 08-NQ/TW du 12 juillet 2003 de la 8e Conférence centrale du 9e mandat, sur la « Stratégie de protection de la patrie dans la nouvelle situation » (11) . Dans le contexte international de l'époque, marqué par les événements complexes du 11 septembre 2001 et la multiplication des interventions militaires dans le monde, le Parti communiste vietnamien a souligné l'importance de « gérer rapidement toute source d'insécurité, sans être passif ni surpris ». Il s’agit d’une évolution importante dans la réflexion stratégique du Parti communiste vietnamien, qui reflète une prise de conscience de plus en plus profonde de la nature complexe et imprévisible de l’environnement sécuritaire international.
Au fil des congrès, du Xe Congrès (2006) au XIIIe Congrès (2021) du Parti, ce point de vue a été constamment évoqué et approfondi dans les résolutions du VIIIe Comité central des XIe et XIIIe législatures sur la « Stratégie de protection de la Patrie dans la nouvelle situation », insistant sur la nécessité de prévenir et de repousser les risques de guerre et de conflit « à temps et à distance » afin de prévenir, détecter et gérer efficacement les surprises stratégiques et les événements soudains. Cette expression apparaît notamment dans deux contextes principaux : d'une part, lors de l'évaluation de la situation mondiale et régionale, marquée par de nombreuses évolutions imprévisibles et difficiles à prévoir ; d'autre part , dans les principes directeurs de la défense et de la sécurité nationales, notamment en lien avec les défis de souveraineté maritime et insulaire et la concurrence stratégique entre les grandes puissances. Lors du 13e Congrès, notre Parti a ajouté l'élément de « maintien de l'initiative stratégique » (12) , reflétant le développement de la conscience d'une position défensive à une position proactive dans la réponse aux défis stratégiques (13) .
Dans ses discours prononcés lors de la Conférence militaro-politique de l'armée depuis 2016, l'ancien secrétaire général Nguyen Phu Trong a souligné qu'il était essentiel de ne pas rester passif et surpris, ce qui constituait une tâche stratégique essentielle et vitale (14) . Lors de la 32e Conférence diplomatique (19 décembre 2023), il a notamment insisté sur la nécessité de suivre régulièrement l'évolution de la situation extérieure, de prévoir correctement son évolution et, surtout, d'évaluer correctement ses conséquences sur le Vietnam afin de ne pas rester passif et surpris . « Calme, vigilance, saisir les opportunités, les avantages, surmonter les difficultés et les défis » (15) . Le 31 octobre 2024, lors d'une discussion thématique avec la classe des membres du Comité central préparant le 14e mandat sur « la nouvelle ère, l'ère de l'essor national », le secrétaire général To Lam a commenté que dans le contexte d'un monde en pleine mutation, « les défis sont plus importants et de nouvelles opportunités peuvent encore apparaître entre les changements soudains » (16) . Lors d'une séance de travail avec le Comité permanent de la Commission militaire centrale (août 2024), le secrétaire général To Lam a souligné l'importance d'« identifier rapidement, gérer correctement, avec harmonie et flexibilité les partenaires et les sujets, ne pas être passif ou surpris ; prévenir le risque de conflit et de confrontation, éviter l'isolement et la dépendance » (17) .
Compte tenu du processus de réflexion stratégique évoqué précédemment et des nouveaux défis actuels, il est nécessaire d'affirmer que le renforcement des capacités de prévention et de réponse aux surprises stratégiques exige une approche globale, systématique et flexible. Cette approche doit combiner harmonieusement renforcement institutionnel, développement des ressources et amélioration des capacités d'anticipation, tout en garantissant la cohérence de la réflexion à l'action dans l'ensemble du système politique. Sur cette base, il est possible de proposer des pistes pour renforcer la capacité du Vietnam à prévenir et à répondre aux surprises stratégiques dans les temps à venir.
Premièrement, il faut continuer à promouvoir l'éducation et la sensibilisation de l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée aux défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels et au rôle de la prospective stratégique. Cette tâche ne relève pas uniquement des agences spécialisées, mais doit également relever de la responsabilité de l'ensemble du système politique, en lien avec le renforcement de la défense nationale et d'une sécurité populaire solide. Il faut également s'attacher à construire une « attitude citoyenne », en promouvant la force combinée du grand bloc d'unité nationale pour détecter, informer et participer à la prévention des risques et des défis à la sécurité nationale. Ainsi, nous contribuerons à développer le potentiel politique et spirituel et à jeter des bases solides pour la défense de la patrie « à distance et en amont » dans le nouveau contexte.
Deuxièmement, il faut se concentrer sur le renforcement de l'autonomie du pays dans des domaines clés, de l'économie à la technologie, en passant par la défense et la sécurité. L'expérience internationale montre que la capacité à réagir aux surprises stratégiques dépend non seulement de la capacité d'anticipation, mais exige également une base spirituelle, matérielle et technologique solide, ainsi que la capacité d'autonomie de l'ensemble de la société, afin de garantir la résilience face aux chocs potentiels. Le développement de l'industrie de la défense, la maîtrise de plusieurs technologies fondamentales et le renforcement des capacités de réserve stratégique sont particulièrement importants.
Production de meubles en bois d'intérieur et d'extérieur destinés à l'exportation vers les États-Unis, le Japon, la Corée et le Moyen-Orient, par l'entreprise Hiep Long Wooden Furniture Manufacturing Company, quartier d'An Phu, ville de Thuan An, province de Binh Duong. Photo : VNA
Troisièmement, continuer à promouvoir le principe de « s'adapter à tous les changements avec la même cohérence » dans les relations extérieures. Cela exige à la fois le respect des principes fondamentaux d'une politique étrangère indépendante, autonome, multilatérale et diversifiée, et une réponse flexible aux évolutions complexes de la situation. Il est notamment nécessaire de renforcer la coopération en matière de sécurité et le partage d'informations avec les partenaires stratégiques et multilatéraux, contribuant ainsi à améliorer la capacité à saisir l'information en temps opportun et à élargir la marge de manœuvre pour gérer les situations complexes. Pour ce faire, il est nécessaire de créer une imbrication toujours plus étroite des intérêts et de renforcer la confiance politique dans le partage d'informations stratégiques.
Quatrièmement, perfectionner le mécanisme de coordination et de partage d'informations intersectorielles en matière de prévision stratégique, afin de combiner étroitement les agences des affaires étrangères, de la défense, de la sécurité et de recherche stratégique. Dans le contexte actuel, la mise en place d'un système d'alerte précoce multicouche, capable d'intégrer et de traiter des informations provenant de sources multiples, est une exigence urgente. Il convient également d'améliorer la capacité de gestion des crises (y compris médiatiques) grâce à des exercices basés sur des scénarios. Il convient notamment d'accroître les investissements dans la création d'agences de recherche stratégique de haute qualité, de jouer un rôle efficace dans la liaison entre la recherche universitaire et l'élaboration des politiques, et de contribuer à améliorer la capacité du pays à prévoir et à identifier rapidement les imprévus stratégiques.
Cinquièmement, promouvoir la modernisation de l’analyse et du traitement de l’information. Dans un contexte de volumes d'informations toujours plus importants et d'évolutions de plus en plus rapides, l'application de technologies avancées telles que l'IA à l'analyse du big data, combinée à l'amélioration des capacités de jugement et de prévision des équipes d'experts, est une nécessité incontournable. Cela permet non seulement d'améliorer la rapidité et la précision de la détection des signes avant-coureurs, mais aussi d'améliorer la capacité à anticiper l'évolution de la situation, et ainsi de proposer des plans d'intervention rapides et efficaces.
Dans un contexte d'évolutions mondiales et régionales de plus en plus complexes et imprévisibles, la recherche et la réponse aux surprises stratégiques sont devenues une exigence urgente pour chaque pays. De la conscience de « ne pas être passif ni surpris » à la politique de « maintenir l'initiative stratégique » et à la devise « répondre à tous les changements par l'immuable », notre Parti a réalisé d'importants progrès en matière de réflexion stratégique. La concrétisation de cette vision directrice exige les efforts de l'ensemble du système politique et une étroite coordination entre les agences, départements, ministères et branches afin d'améliorer la capacité d'anticipation et de gestion des situations. Ainsi, le Vietnam relèvera avec détermination tous les défis, tirera pleinement parti des opportunités de développement et mènera à bien les deux missions stratégiques que sont la construction et la défense de la République socialiste du Vietnam.
-----------------
(1) Michael I. Handel : « Le renseignement et le problème de la surprise stratégique », The Journal of Strategic Studies 7, n° 3, 1984, pp. 229-281
(2) Voir : Wohlstetter, Roberta : Pearl Harbor : Avertissement et décision, Stanford University Press, 1962
(3) Voir : Erik J. Dahl : Renseignements et attaques surprises : échec et succès de Pearl Harbor au 11 septembre et au-delà, Presses universitaires de Georgetown, 2013
(4) Voir : Stanley L. Mushaw : « Strategic Surprise Attack », Naval War College Newport Advanced Research Program, 1989
(5) Jonathan Colman : Crise des missiles de Cuba : origines, évolution et conséquences, Edinburgh University Press, 2016
(6) Voir : Ephraim Kahana : « Alerte précoce versus concept : le cas de la guerre du Kippour de 1973 », Intelligence and National Security 17, n° 2, 2002, pp. 81 - 104
(7) Voir : Itai Shapira : « L’échec des services de renseignement de Yom Kippour après cinquante ans : quelles leçons peut-on en tirer ? », Intelligence and National Security 38, n° 6, 2023, pp. 978 - 1 002
(8) Thomas H. Kean - Lee Hamilton, Rapport de la Commission du 11 septembre : Rapport final de la Commission nationale sur les attaques terroristes contre les États-Unis, vol. 1. Government Printing Office, 2004.
(9) Ron Matthews - Nellie Zhang Yan : « La « défense totale » des petits pays : une étude de cas de Singapour », Defence Studies 7, n° 3, 2007, pp. 376 - 395
( 10 ) Alberto Giacometti - Jukka Teräs : Résilience économique et sociale régionale : une étude exploratoire approfondie dans les pays nordiques, Nordregio, 2019
(11) Dang Dinh Quy : « Approche de la réflexion sur les « partenaires » et les « objets » dans le nouveau contexte », Electronic Communist Magazine, 13 janvier 2023, https://www.tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/tiep-can-tu-duy-ve-doi-tac-doi-tuong-trong-boi-canh-moi
(12) Documents du XIIIe Congrès national des délégués, Éditions politiques nationales Vérité, Hanoï, 2021, vol. I, p. 159
(13) Nguyen Ngoc Hoi : « Le point de vue de la « prévention proactive des risques de guerre et de conflit, à l'avance et à distance » lors du 13e Congrès national du Parti », National Defense Magazine, 5 juin 2021, http://m.tapchiqptd.vn/vi/quan-triet-thuc-hien-nghi-quyet/quan-diem-chu-dong-ngan-ngua-cac-nguy-co-chien-tranh-xung-dot-tu-som-tu-xa-tai-dai-hoi-xiii-cua-dang-17139.html
(14) VNA : « Texte intégral du discours du secrétaire général Nguyen Phu Trong à la Conférence militaro-politique de 2016 », Journal électronique de l'Armée populaire, 13 décembre 2016, https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-hoi-nghi-quan-chinh-toan-quan-nam-2016-494879
(15) Voir : « Texte intégral du discours du secrétaire général Nguyen Phu Trong à la 32e Conférence diplomatique », journal électronique du gouvernement, 19 décembre 2023, https://baochinhphu.vn/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-hoi-nghi-ngoai-giao-lan-thu-32-102231219155116287.htm
(16) Professeur, Dr. To Lam : « Quelques contenus de base sur la nouvelle ère, l'ère de l'essor national ; orientations stratégiques pour amener le pays dans une nouvelle ère, l'ère de l'essor national », Magazine communiste électronique, 1er novembre 2024, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/ky-nguyen-moi-ky-nguyen-vuon-minh-cua-dan-toc-ky-nguyen-phat-trien-giau-manh-duoi-su-lanh-dao-cam-quyen-cua-dang-cong-san-xay-dung-thanh-cong-nuoc-vie
(17) « Le secrétaire général et président To Lam travaille avec le Comité permanent de la Commission militaire centrale », Journal électronique du gouvernement, 28 août 2024, https://baochinhphu.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-quan-uy-trung-uong-102240828091158399.htm
Source : https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/1075702/bat-ngo-chien-luoc-trong-quan-he-quoc-te-va-mot-so-ham-y-chinh-sach.aspx




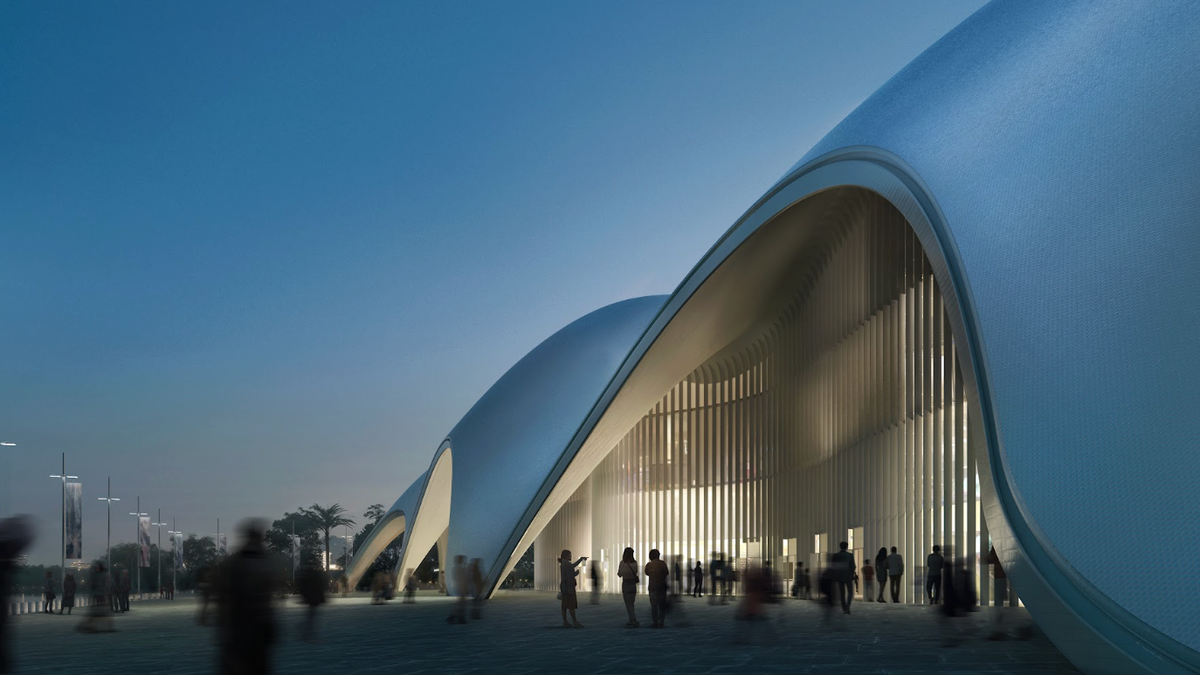
![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion du Comité de pilotage sur l'organisation des unités de service public au sein des ministères, des branches et des localités.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/06/1759767137532_dsc-8743-jpg.webp)
![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une réunion du Comité permanent du gouvernement pour éliminer les obstacles aux projets.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/06/1759768638313_dsc-9023-jpg.webp)
























































































Comment (0)