Un jour, à la fin du cours sur les genres journalistiques, un étudiant m'a demandé : « Cela ne vous inquiète-t-il pas de toujours laisser votre vrai nom sous vos articles critiquant l'éducation ? »
 |
| Des étudiants ont interrogé l'auteur lors d'un séminaire. (Photo : VHP) |
Même si j'ai soudainement éclaté de rire et répondu aussitôt : « Si un professeur a peur de dire la vérité, qui d'autre peut-il enseigner ? », cette question m'a poursuivie pendant plusieurs jours, m'alimentant de réflexions.
Sur le podium, le professeur se sent responsable face aux regards impatients des élèves.
Dans un journal, l'auteur imagine toujours le regard confiant des lecteurs. D'un côté, on cherche à apprendre ce qui est juste ; de l'autre, on veut connaître la vérité. Et lorsqu'on écrit sur l'éducation, le juste et la vérité se confondent.
En théorie, l'école est un lieu d'apprentissage. Mais la réalité est bien plus complexe. Il y a des sujets que l'on hésite à aborder, par crainte de froisser ses collègues, de nuire à ses performances ou de franchir des limites invisibles.
Parfois, mes collègues se rappellent en plaisantant de faire attention à leurs paroles et à leurs actes, de peur que je ne les publie dans le journal. D'autres me prennent à part et me disent sincèrement à voix basse : « S'il te plaît, écris avec modération, chaque profession a ses avantages et ses inconvénients. »
Oui, chaque profession a ses moments de gloire et ses aspects plus sombres que ceux qui l'exercent préfèrent taire. Mais si ces personnes ne partagent pas leurs opinions, ne font pas entendre leur voix pour contribuer de manière constructive et refusent de reconnaître leurs faiblesses et leurs erreurs, comment peuvent-elles espérer un avenir durable ?
Si les enseignants ont peur de dire la vérité, qui apprendra aux élèves à la dire ? Ou bien nous contentons-nous de pointer du doigt les vérités des autres professions, en privilégiant celle d'enseignant ? La critique de l'éducation exige donc plus que jamais de nous le courage de rester honnêtes.
Le journalisme permet de réfléchir sur le métier d'enseignant, et inversement. Lorsque j'ai commencé à écrire des articles critiques sur les questions d'éducation, j'ai compris qu'aborder de front les problèmes les plus urgents n'est pas seulement un droit pour les lecteurs, mais aussi une responsabilité pour la profession.
Chaque récit, chaque exemple consigné, porte la voix de ceux qui l'ont vécu. Ils reflètent la réalité et contribuent ainsi à façonner notre perception et notre comportement.
Paradoxalement, dans de nombreux milieux éducatifs, admettre ses lacunes ou ses limites est parfois considéré comme « problématique ». Les enseignants, les responsables ou les instances de gestion subissent, pour la plupart, leurs propres pressions : résultats des élèves, critères de compétition, évaluation sociale.
Dans un tel contexte, regarder la vérité en face et la critiquer devient un acte courageux et risqué. Mais c'est précisément ce risque qui confère toute sa valeur à la voix critique.
Le pouvoir du journalisme réside non seulement dans l'art de raconter des histoires, mais aussi dans sa capacité à créer un espace de dialogue public. Lorsque j'écris sur l'éducation, je me dis toujours : au-delà du simple compte rendu d'un événement, chaque article est aussi un rappel, une suggestion d'amélioration pour l'avenir.
Journalistes et enseignants, en ce sens, ont plus en commun qu'on ne le croit. Les deux professions sont soumises aux exigences de l'honnêteté ; toutes deux subissent la pression de l'opinion publique, des collègues et d'elles-mêmes.
Si le journalisme permet d'analyser, de réfléchir et de questionner, l'enseignement, quant à lui, contribue à forger des valeurs et à encourager la pensée critique. Ensemble, ces deux voix créent une force mutuelle : le journalisme rend l'éducation plus transparente ; l'éducation offre au journalisme une source d'expériences et d'émotions authentiques.
Utiliser le journalisme pour parler du métier d'enseignant est aussi une façon de promouvoir une culture de responsabilité sociale. On ne peut espérer un meilleur environnement éducatif si les problèmes existants sont toujours dissimulés derrière des statistiques ou des rapports de performance.
Chaque profession a son côté sombre, mais lorsqu'on l'examine avec un regard critique et du courage, ces aspects sombres ne sont plus des zones d'ombre invisibles, mais deviennent un matériau pour l'amélioration, créant ainsi une dynamique de développement.
Source : https://baoquocte.vn/dung-nghe-bao-de-noi-ve-nghe-day-334898.html



![[Photo] Lam Dong : Vue panoramique de la cascade de Lien Khuong qui déferle comme jamais auparavant](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763633331783_lk7-jpg.webp&w=3840&q=75)


![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s'entretient avec le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Woo Won Shik.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763629724919_hq-5175-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[Photo] Le président Luong Cuong reçoit le président du Sénat de la République tchèque, Miloš Vystrčil](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763629737266_ndo_br_1-jpg.webp&w=3840&q=75)




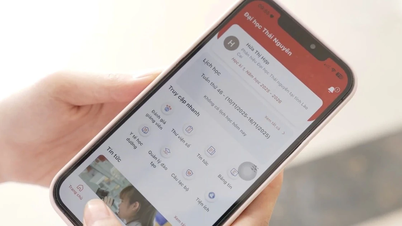


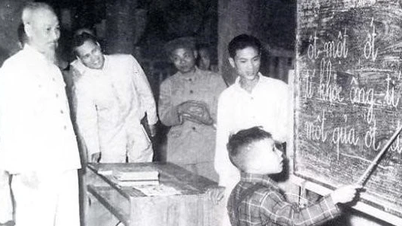





































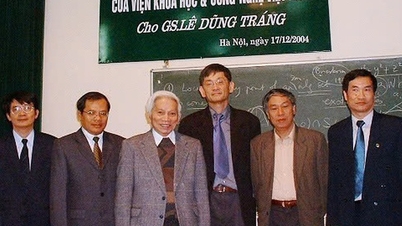




















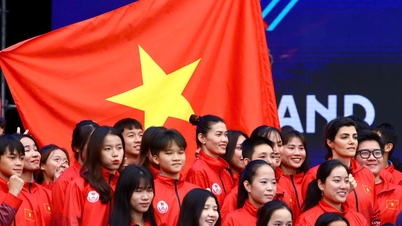



































Comment (0)