(Journal Journalist & Public Opinion) Depuis longtemps, lorsqu'on aborde le développement de l'industrie culturelle, nombreux sont ceux qui affirment que nous n'avons pas pleinement exploité le potentiel de notre patrimoine. Pourquoi ? Quels sont les obstacles ? Comment exploiter durablement ce patrimoine ? Le Journalist & Public Opinion s'est entretenu avec la professeure Tu Thi Loan à ce sujet.
Nous devons lever ces barrières.
Transformer le patrimoine en atouts : ce sujet a été largement débattu et fait l'objet de nombreux consensus. Cependant, la question de savoir comment y parvenir reste encore floue. Selon vous, comment faire du patrimoine une ressource pour le développement, afin d'induire un véritable changement et non de simples slogans ?
C'est évidemment un problème complexe, et c'est pourquoi nous continuons à le défendre sans grand succès. Mais selon moi, toute action concrète exige non seulement une prise de conscience et une mobilisation collectives, mais aussi de nombreux autres facteurs. Avant tout, nous avons besoin de ressources, humaines, financières et matérielles. Lorsque la main-d'œuvre manque de compétences professionnelles et d'expertise, et que les infrastructures nécessaires (routes, hôtels, restaurants, etc.) sont inadéquates, le site patrimonial reste à l'abandon, incapable d'attirer les touristes ou de développer des produits touristiques ou culturels.

Professeure, Docteur Tu Thi Loan. Photo : quochoi.vn
Par ailleurs, les mécanismes et les politiques sont également essentiels. Nous en parlons sans cesse, mais nous n'avons pas mis en place de cadre juridique favorable ; face à tant d'obstacles, il est très difficile de valoriser le patrimoine. De plus, il est nécessaire de créer un marché ouvert et dynamique pour permettre le développement des entreprises touristiques et culturelles.
Afin d'exploiter les sites historiques à des fins touristiques, on observe une situation où de nouvelles structures sont rénovées et construites, perturbant ainsi la structure originale des sites, les « modernisant » et les surexploitant. Il existe également une tendance à « glorifier » les sites et le patrimoine historiques, ce qui les dénature et les rend inexacts. Pensez-vous qu'il faille limiter l'exploitation du patrimoine ? Et si oui, comment devrait-elle être gérée ?
Cela exige assurément une gestion étatique rigoureuse. Si nous laissons faire à la population, aux instances de gestion et aux gardiens des temples ce qu'ils veulent, le chaos est inévitable. D'ailleurs, il y a peu de temps, à la pagode des Parfums, des cas de faux temples et de fausses pagodes ont contraint les autorités à intervenir et à les démolir. Dans le site pittoresque de Trang An, on a également constaté la construction d'une route de plusieurs milliers de marches au cœur même du site. Des spectacles record, réunissant jusqu'à 5 000 personnes et des milliers de personnes chantant des chants folkloriques traditionnels, ont aussi été organisés, soi-disant pour promouvoir le site et attirer les touristes. Mais l'essence du patrimoine est tout autre. Si cette approche grandiose endommage et détruit le patrimoine, il nous faut des principes directeurs.
Nous disposons déjà des outils nécessaires, à savoir les conventions de l'UNESCO et, en particulier, la loi récemment adoptée sur le patrimoine culturel. Toutes ces lois constituent des réglementations qui nous aident à protéger et à promouvoir la valeur de notre patrimoine. Nous devons reconnaître que le patrimoine est un bien national, un bien commun de l'humanité ; il est donc indispensable de mettre en place des réglementations strictes pour encadrer et contrôler les atteintes à notre patrimoine, afin d'en prévenir toute violation.
La communauté doit partager les bénéfices.
+ Dans le processus de transformation du patrimoine en ressources pour le développement, comment sont définis les rôles et les droits des communautés qui possèdent ce patrimoine, Madame ?
L'une des exigences des Nations Unies en matière de développement culturel durable stipule clairement que les bénéfices tirés de l'exploitation du patrimoine culturel doivent être équitablement partagés avec la communauté locale ou les gardiens de ce patrimoine. Dans le cadre du développement socio -économique, les responsables locaux exigent systématiquement que chaque projet d'exploitation du patrimoine crée des emplois, génère des revenus pour l'État et profite également aux résidents locaux. Par conséquent, le rôle de la communauté, en tant que partie prenante, est indéniablement de bénéficier de ces bénéfices. C'est le cas à Hoi An, où les habitants du quartier historique peuvent commercer, profiter des activités touristiques et accéder à de nombreux services connexes. Au temple Hung, à la pagode Huong, à la pagode Bai Dinh, à la tour Ponagar, au temple Ba Chua Xu sur le mont Sam et dans bien d'autres sites, la population tire également de nombreux avantages de l'exploitation du patrimoine à travers le tourisme. Lorsque les habitants ont un emploi et que leur niveau de vie s'améliore, ils s'engagent volontairement dans la protection du patrimoine.



Le complexe du Temple de la Littérature et de l'Université nationale a toujours été une attraction touristique populaire à Hanoï. Photo : Conseil d'administration du Temple de la Littérature et de l'Université nationale.
Mais en réalité, ce n'est pas possible partout. Par exemple, à Duong Lam, il y a eu une histoire où des gens demandaient à ce que le titre de site historique soit restitué.
L'histoire de la valorisation et de la protection du patrimoine exige une étroite collaboration de tous les acteurs concernés. Par exemple, lorsque des entreprises touristiques exploitent le patrimoine, elles doivent reverser un certain pourcentage de leurs revenus aux autorités locales, qui le redistribuent ensuite à la population. Même si la construction de logements est interdite, les habitants doivent pouvoir bénéficier du patrimoine. De nombreux pays y parviennent avec succès. À titre d'exemple, dans le village de Lijiang en Chine, la participation des habitants à la préservation du village ancien leur permet d'en retirer des bénéfices importants. Grâce aux retombées du tourisme, les habitants ont développé un artisanat traditionnel et des services connexes.
Pour revenir à l'histoire de Duong Lam, nous devons nous inspirer de modèles étrangers comme ceux de la Corée du Sud et de la Thaïlande. Duong Lam recèle de nombreux atouts qui pourraient être transformés en produits touristiques uniques ; ce qui nous manque, c'est la capacité de leur donner vie. Nous n'avons pas su créer d'histoires captivantes autour de ce village ancestral à raconter aux touristes, à l'instar du récent spectacle « Essence du Nord du Vietnam » à la pagode Thuy, ou de la notoriété acquise par Trang An après la sortie du film « Kong : Skull Island ». Pour Duong Lam, une simple association avec un film ou un événement culturel suffirait peut-être à promouvoir efficacement ses caractéristiques uniques. Plus largement, nous pouvons exploiter pleinement les éléments contemporains liés au patrimoine, en intégrant des éléments créatifs au patrimoine traditionnel, et ainsi créer des produits touristiques attractifs. Si nous restons passifs, figés dans notre patrimoine et vivant dans le désenchantement du passé, il sera très difficile de réaliser des progrès significatifs.
Merci, madame !
Le Vu (Exécution)
Source : https://www.congluan.vn/gs-ts-tu-thi-loan-khong-the-dong-bang-di-san-de-song-voi-tro-tan-qua-khu-post328145.html






![[Image] Le parcours coloré de l'innovation au Vietnam](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F14%2F1765703036409_image-1.jpeg&w=3840&q=75)





















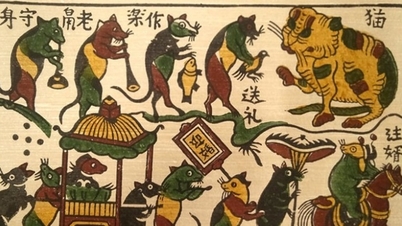















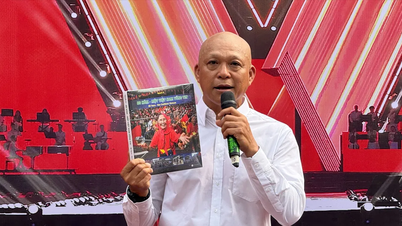










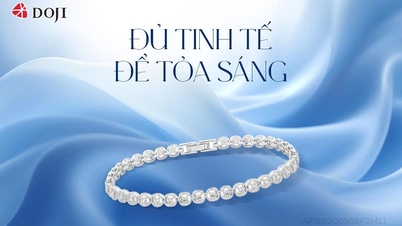













![[Image] Le parcours coloré de l'innovation au Vietnam](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/14/1765703036409_image-1.jpeg)






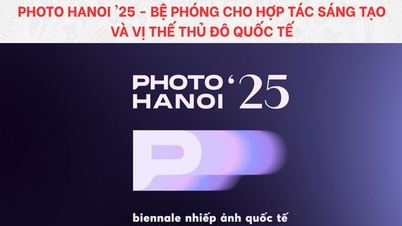






























Comment (0)