Un dôme en béton contenant du sol radioactif et des déchets nucléaires dans les îles Marshall risque de se fissurer en raison de la montée du niveau de la mer, menaçant les personnes vivant à proximité.

Arche géante en béton sur l'île de Runit. Photo : Ashahi Shimbun
À première vue, les eaux turquoise qui entourent les îles Marshall ressemblent à un paradis. Pourtant, ce cadre idyllique du Pacifique a été le théâtre de 67 bombes nucléaires, déclenchées lors des essais militaires américains de la Guerre froide, entre 1946 et 1958. Les bombes ont explosé au-dessus et au-dessous des atolls de Bikini et d'Enewetak, dont une 1 100 fois plus puissante que la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Le rejet de radiations équivalentes à celles de Tchernobyl a contraint des centaines de personnes à fuir leurs foyers. Bikini a été abandonnée. À la demande du gouvernement américain, les habitants ont commencé à revenir à Enewetak.
Aujourd'hui, il reste peu de traces visibles d'essais nucléaires sur les îles, à l'exception d'un dôme de béton de 115 m de large surnommé le Grave. Construit à la fin des années 1970 et aujourd'hui usé et fissuré, ce dôme géant de béton sur l'île Runit contient plus de 90 000 m³ de sol radioactif et de déchets nucléaires (l'équivalent de 35 piscines olympiques), selon le Guardian .
Ian Zabarte, représentant de la tribu amérindienne Shoshone, s'efforce de sensibiliser les habitants des îles du Pacifique touchés par les essais nucléaires. « Les effets des essais nucléaires sur la santé de notre peuple n'ont jamais été étudiés. Nous n'avons jamais reçu d'excuses, et encore moins d'indemnisation », a déclaré M. Zabarte.
« Le cancer se transmet de génération en génération », a déclaré Alson Kelen, navigateur chevronné ayant grandi à Bikini. « Si vous demandez à quelqu'un ici si les essais nucléaires ont affecté sa santé, la réponse est oui. »
Les États-Unis affirment que les Îles Marshall sont un pays sûr. Après leur indépendance en 1979, les Îles Marshall sont devenues autonomes, mais sont restées fortement dépendantes de Washington sur le plan économique . Aujourd'hui, l'État insulaire utilise toujours le dollar américain et les subventions américaines représentent toujours une part importante de son PIB.
En 1988, un tribunal international a été créé pour examiner l'affaire et a condamné les États-Unis à verser 2,3 milliards de dollars aux Îles Marshall pour frais médicaux et de réinstallation. Le gouvernement américain a refusé, affirmant avoir rempli sa responsabilité en versant 600 millions de dollars dans les années 1990. En 1998, les États-Unis ont cessé de fournir des soins médicaux aux insulaires atteints de cancer, laissant nombre d'entre eux en difficulté financière. La décision est en attente de renégociation cette année. Les insulaires ont également demandé aux États-Unis de démanteler l'arche de Runit, qui risque de s'effondrer en raison de la montée du niveau de la mer et de la détérioration naturelle de la structure en béton.
La menace qui pèse sur le tombeau est particulièrement grave, car les Îles Marshall se trouvent à seulement 2 mètres au-dessus du niveau de la mer et sont très vulnérables à la montée du niveau de la mer. Selon une étude de la Banque mondiale, Majuro, la capitale de l'île, est exposée à de fréquentes inondations. Les États-Unis affirment que, le dôme étant situé sur le territoire marshallais, sa réparation ne relève pas de leur responsabilité.
Les experts ne savent toujours pas ce qu'il adviendra de l'environnement après l'effondrement du Tombeau. Il est difficile de suivre la réaction de l'écosystème au fil du temps, car peu de personnes sur l'atoll de Bikini sont en mesure de surveiller les changements. En 2012, un rapport des Nations Unies indiquait que les effets des radiations sur les Îles Marshall étaient durables et contaminaient l'environnement à un niveau quasi irréversible. Lors d'une visite sur les îles en 2016, Stephen Palumb, professeur d'océanographie à l'université de Stanford, et ses collègues ont été avertis par les habitants de ne pas boire l'eau de coco radioactive ni de manger des crabes de cocotier, car les eaux souterraines étaient contaminées.
Les explosions nucléaires ont représenté une menace considérable pour la biodiversité locale. Une étude du gouvernement américain de 1973 a révélé des dommages immédiats et à long terme pour la vie marine : des poissons ont explosé lorsque leurs vessies remplies de gaz ont réagi aux variations de pression sous-marine, et des centaines de loutres sont mortes sur le coup.
La résilience de l'océan est impressionnante, a déclaré Palumbi, avec la repousse des récifs coralliens aux Îles Marshall dix ans après les essais nucléaires. Mais des traces de cet événement vieux de plusieurs décennies subsistent, notamment une fine couche de sédiments poudreux recouvrant les récifs.
An Khang (selon le Guardian )
Lien source





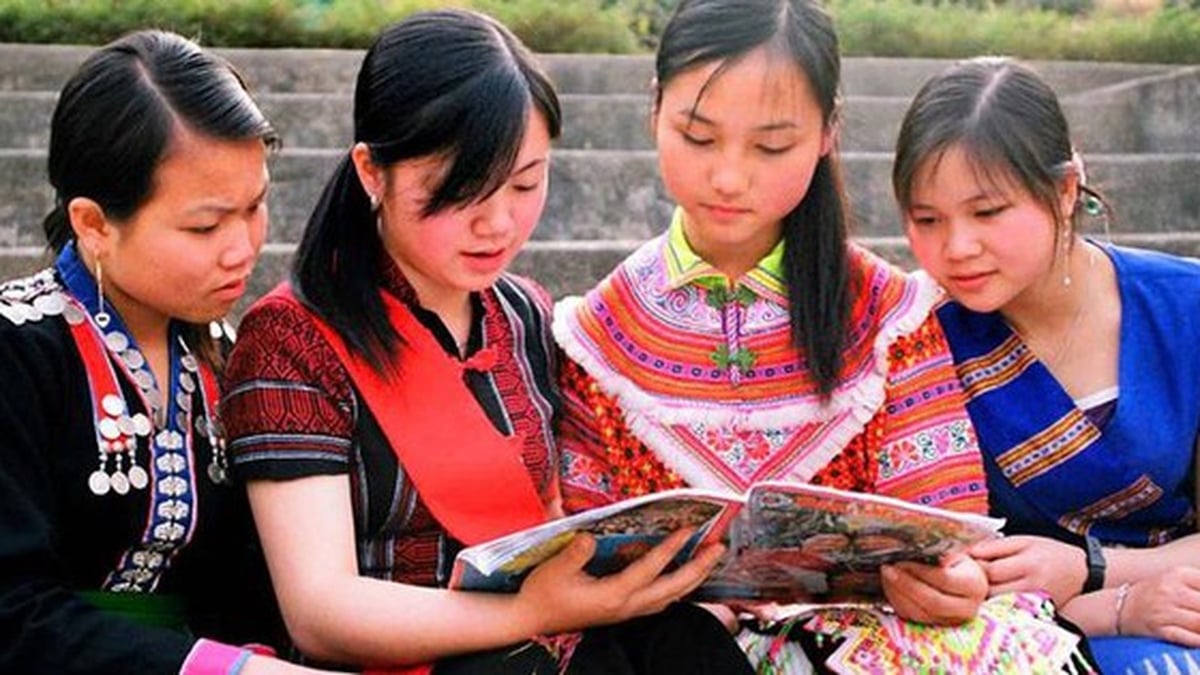

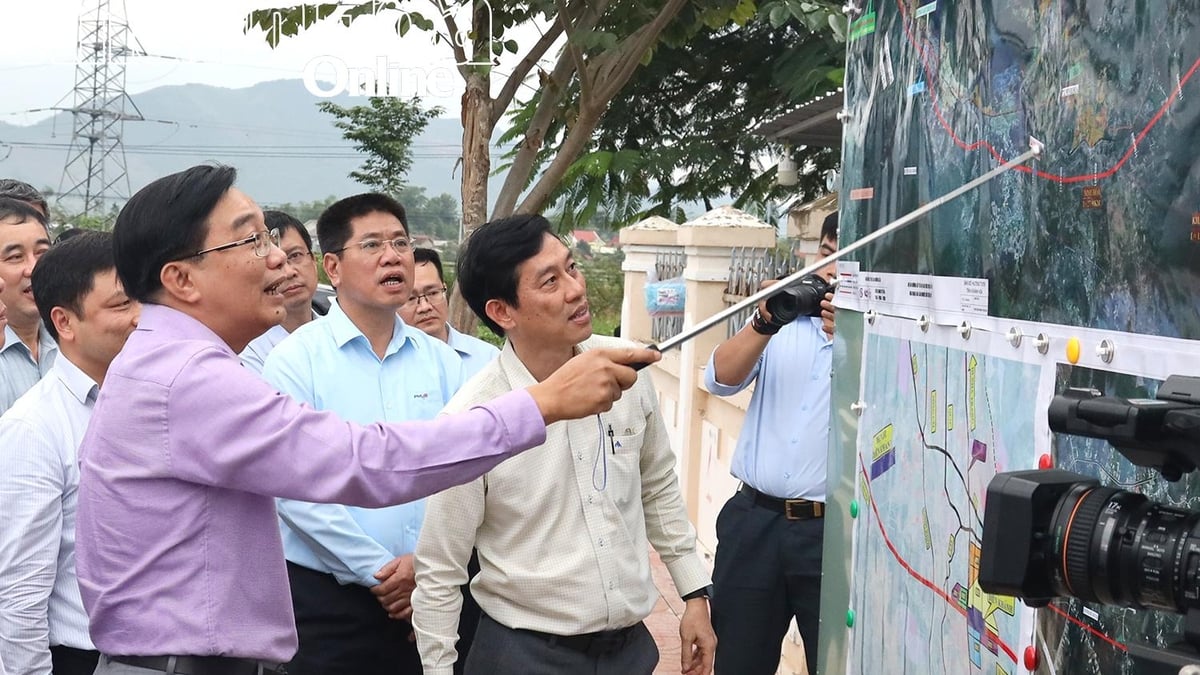






















![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale participe au séminaire « Construire et exploiter un centre financier international et recommandations pour le Vietnam »](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)











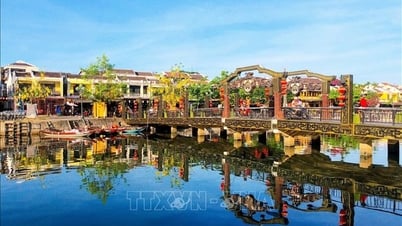



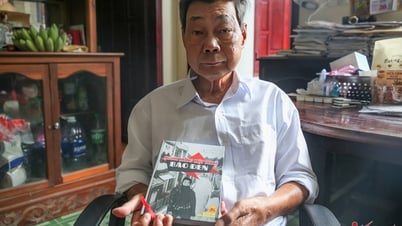





























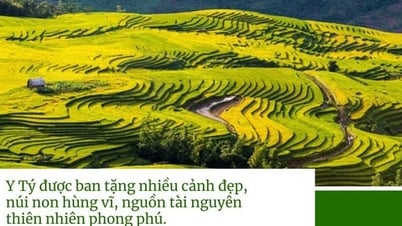
























Comment (0)