
Mon oncle Tung et moi nous sommes engagés dans l'armée en même temps. Le jour de notre départ, le soleil n'avait pas encore percé la canopée. Un épais brouillard matinal, aussi opaque que de la fumée, enveloppait encore tout. Un véhicule militaire , lourdement camouflé, nous attendait sous un kapokier à l'entrée du village.
La plupart des voisins étaient sortis pour dire au revoir aux nouveaux soldats. Ma femme tenait notre fille de cinq mois contre elle. Son frère de cinq ans me tenait par le cou. Toute la famille était serrée les uns contre les autres, à contrecœur, pour partir. La mère de l'oncle Tung, le dos légèrement voûté, tenta de relever sa tête tachetée d'argent, ouvrant ses yeux ternes, grands comme des longanes, pour observer attentivement le visage de son fils. D'une main, elle portait le sac à dos, de l'autre, elle lui tapotait le dos, l'encourageant fermement : « Vas-y, sois fort, tes frères t'attendent dans la voiture. » Elle répétait la même phrase plusieurs fois, sa bouche l'encourageant, mais elle tenait fermement le bras de l'oncle Tung.
C'était début mars, et le kapokier à l'entrée du village était déjà d'un rouge éclatant. De la cime jusqu'aux fines branches retombantes, des grappes de flammes vacillantes pendaient de partout. Le vent du fleuve Nguon soufflait à travers la cime des arbres, et de nombreuses fleurs tombaient sous la voiture, se déposaient sur les sacs à dos et sur les épaules des nouvelles recrues qui s'essayaient encore maladroitement à leurs uniformes kaki flambant neufs.
Bien souvent, à chaque floraison, le kapokier de mon village se joignait aux villageois pour dire adieu, les larmes aux yeux, à leurs enfants partis rejoindre l'armée. J'avais l'impression que cet arbre, lui aussi, était empli d'amour, qu'il se tordait de désir pour extraire de son tronc les gouttes de sang pur et frais qui nous donneraient la force d'aller au combat avec confiance.
Assis près de moi, l'oncle Tung tendit les mains pour recevoir une fleur de coton encore humide de rosée matinale et la serra contre sa poitrine. Me soufflant un souffle chaud à l'oreille, il murmura : « La fleur de coton s'appelle aussi la fleur de coton. » Je savais qu'il regrettait amèrement son camarade de terminale, Mien.
J’ai demandé : « Pourquoi Mien n’est-il pas venu me dire au revoir ? » Sa voix était rauque : « Aujourd’hui, c’était au tour de Mien d’être de service ; il devait être à la batterie dès quatre heures du matin. Hier soir, nous avons sangloté et parlé derrière ce kapokier. Après minuit, quand nous nous sommes dit au revoir, Mien a fourré dans la poche de ma chemise le stylo Anh Hung et une pile de papier cellophane, puis il m’a soudainement tordu le cou et m’a mordu l’épaule douloureusement. »
J'ai fait semblant de pleurer : « Tu as du sang partout sur ta chemise. » Elle a haleté : « Ce n'est rien ! J'espère que ça restera une cicatrice, pour que tu te souviennes toujours de Mien. » Incapable de trouver les mots pour l'encourager, je me suis contentée de tenir en silence la main de l'élève de mon oncle, douce comme une nouille. Je me répétais en silence les paroles de ma grand-mère la veille : « Tu es encore très faible, tu dois toujours le soutenir et le protéger dans les moments difficiles, je compte sur toi. »
Avant de quitter le village, j'avais le cœur lourd, rongé par le mal du pays. Lorsque la voiture a démarré, j'ai entendu de nombreux sanglots étouffés sous le feuillage du vieux fromager, couvert de ses magnifiques fleurs. Nous avons dû nous retenir, nous nous sommes levés ensemble, avons levé les mains et avons crié à haute voix : « À bientôt le jour de la victoire ! »
Mon grand-père avait dix frères et sœurs. Le père de l'oncle Tung était le benjamin. J'ai cinq ans de plus que l'oncle Tung. Dans ma famille, il a toujours été courant que ceux qui ont plusieurs enfants appellent un élève de terminale « oncle » ou « tante ». Cela a toujours été le cas.
Le père de l'oncle Tung est mort en 1948, durant la nuit où l'armée a attaqué la garnison de Tam Chau. Il n'avait que quatre ans. Sa mère l'a élevé seule depuis. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires l'année dernière, fils unique d'un martyr, il a été prioritaire pour une place en Union soviétique, une opportunité très convoitée. Il a refusé, s'est mordu le bout du doigt et a utilisé son sang pour écrire une lettre de détermination, dans laquelle il s'engageait volontairement pour combattre les Américains. Sa mère a dû signer la demande pour confirmer son accord, et le comité de sélection a ensuite approuvé son enrôlement dans la première promotion de cette année.
Mon oncle et moi avons été affectés à la même escouade. Nous avons combattu ensemble sur les champs de bataille de plusieurs provinces du Sud-Est. Grâce à la protection de nos ancêtres, au cours des quatre dernières années, ni mon oncle ni moi n'avons été touchés par un seul éclat d'obus. Nous avons seulement contracté le paludisme à quelques reprises et subi quelques blessures dues à des explosions, avant que notre santé ne revienne à la normale.
En mars dernier, suite à une réorganisation militaire, mon oncle Tung et moi avons été envoyés par notre unité suivre un stage d'entraînement spécial avec des dizaines de soldats d'autres unités. Notre groupe a traversé clandestinement le fleuve Saigon et a rejoint la base R. Nous voyagions de nuit et nous reposions le jour à l'ombre de la forêt.
C'était en 1970, la guerre était à son paroxysme. Cette nuit-là, nous venions de traverser un ruisseau asséché lorsque l'officier de liaison donna l'ordre : « Ce secteur est un point stratégique où les avions ennemis effectuent régulièrement des reconnaissances et des bombardements ; camarades, soyez vigilants, ne soyez pas subjectifs. »
Il y a eu pas mal de victimes ici. Je venais de repousser mon chapeau mou et j'étais sur le qui-vive quand j'ai entendu plusieurs fusées éclairantes exploser au-dessus de ma tête. Mon oncle et moi nous sommes rapidement cachés derrière un vieil arbre au bord du sentier. Oncle Tung a chuchoté : « Un kapokier, un fromager, mon ami ! »
J’ai effleuré l’écorce rugueuse, mes paumes ont touché les épines acérées. Soudain, je me suis souvenue des kapokiers de mon village, qui devaient être en fleurs en cette saison. En levant les yeux, j’ai vu d’innombrables fleurs de kapokier scintiller dans les lueurs, s’éteignant un instant, puis révélant de magnifiques flambeaux.
Une branche, à mi-hauteur de l'arbre, de la taille d'une charrue, avait été arrachée par une bombe et ressemblait à un bras mutilé pointant vers le croissant de lune qui se levait à l'horizon, orné lui aussi de grappes de fleurs éclatantes. Il semblait qu'à cet instant, l'oncle Tung avait oublié tous ses ennemis dans le ciel. Se redressant d'un bond, il serra le kapokier dans ses bras et s'écria avec enthousiasme : « Mien ! Mien ! Au cœur de la forêt, il y a aussi des kapokiers comme chez nous, mon cher. »
Soudain, un éclair jaillit. Je n'eus que le temps d'apercevoir quelques points lumineux se reflétant dans les grands yeux noirs de l'oncle Tung. Puis ce fut le noir complet. Le silence se fit. J'étais sourd. La bombe explosa tout près. La déflagration me projeta au sol au moment même où le corps de l'oncle Tung s'écrasa lourdement sur mon dos. Le sang qui jaillit de sa poitrine gicla, imbibant ma chemise brûlante.
L'oncle Tung mourut, transpercé par un éclat de bombe qui lui transperça le cœur, ressortit par le dos et s'enfonça profondément dans le tronc d'un kapokier. On retira un morceau d'écorce long comme une main, révélant un tronc d'un blanc pâle. Entre mes mains, l'oncle Tung ne put plus prononcer un mot.
Mien ! Mien ! Ce furent les derniers mots de mon oncle. Après le bombardement, la forêt retomba dans un silence terrifiant. Du ciel, les kapokiers déversaient leurs feuilles tristement comme une pluie fine, nous recouvrant, mon oncle et moi. Leurs fleurs, telles des gouttes de sang rouge vif, flottaient et dégoulinaient sans fin.
Nous avons allongé l'oncle Tung dans une fosse profonde creusée dans le sentier, à une dizaine de mètres du pied du kapokier. J'ai fouillé dans mon sac à dos et l'ai habillé de son uniforme kaki de Suzhou, encore plié, qu'il gardait précieusement pour son retour de permission du Nord. J'ai aussi glissé avec précaution dans ma poche de poitrine droite un flacon de pénicilline portant sa photo et les informations nécessaires concernant un soldat, inscrites au dos.
J’ai délicatement glissé le papier cellophane imbibé de sang et le stylo Hero que Mien lui avait donné dans la poche gauche de sa chemise, là où son cœur ruisselait encore du sang pur de sa jeunesse. Avant de l’envelopper dans la couverture, nous l’avons regardé une dernière fois à la lampe torche.
Son visage était pâle à cause de la perte de sang, mais les commissures de ses lèvres n'étaient pas encore fermées, dévoilant une rangée de dents de devant aussi régulières que des grains de maïs, luisantes à la lumière. Un sourire n'avait pas encore disparu, un sourire de jeunesse à jamais gravé dans ma mémoire. Il semblait qu'il n'avait pas encore connu la douleur, qu'il n'avait pas encore su qu'il devrait quitter ce monde à vingt-cinq ans.
Il s'effondra comme dans les bras de sa mère, sombrant paisiblement dans un long sommeil. Sans pierre tombale, nous avons trouvé une dalle de latérite enfouie sous terre, à la tête de la sépulture. Une fois notre travail terminé, toute l'escouade inclina la tête en silence et reprit sa marche. Sachant que j'étais le neveu de l'oncle Tung, l'officier de liaison me dit doucement : « Ce kapokier se trouve à environ deux kilomètres du ruisseau Tha La que nous venons de traverser. »
La route que nous allons emprunter est à peu près à la même distance, prenez-la comme repère. Quant à moi, je m'attardai près de sa tombe, sanglotant et priant : « Oncle Tung ! Repose en paix ici. Voici un kapokier qui, chaque année en mars, se pare de magnifiques fleurs. L'âme de la patrie, l'amour et le désir de ta mère, de Mien et de toute notre famille sont à jamais cachés à l'ombre de cet arbre, dans l'éclosion des fleurs de mars, qui réchaufferont ton âme durant les mois et les années que tu passeras encore en ce lieu. Après la victoire, je viendrai te chercher pour te ramener auprès de tes ancêtres, au cœur de ta patrie. »
La seule chose qui restait de mon oncle était le sac à dos taché de sang que j'avais toujours emporté avec moi pendant la guerre. La première fois que je suis rentrée en permission, j'ai dû me retenir et le ranger dans un coffre en bois attaché à une poutre. C'était très douloureux pour moi de voir une mère tenir le souvenir ensanglanté de son enfant.
Après le retour de la paix, ma femme m'a appris que la commune avait organisé une cérémonie commémorative en l'honneur de l'oncle Tung quelques années auparavant. Tante Mien est également décédée un an après l'oncle Tung sur le champ de bataille de Quang Tri . Sa mère, après avoir longtemps supplié l'organisation et ma femme, est venue vivre définitivement chez moi. Ma maison étant mitoyenne, il lui était facile de rentrer chaque jour pour brûler de l'encens devant les deux portraits de nos martyrs bien-aimés.
Mais elle montrait des signes de démence. Ma femme a écrit dans une lettre : « Chaque matin, elle se rendait à l’entrée du village, une faucille et un panier à la main, et s’asseyait d’un air absent sous le kapokier. Quand on lui demandait ce qui se passait, elle répondait : “Je cherche de l’amarante pour nourrir mes enfants et moi. J’attends aussi Tung qui rentre à la maison. Après tant d’années d’absence, il a dû oublier le chemin, c’est vraiment dommage !” »
Ce n'est qu'en mars 1976 que mon unité m'accorda un mois de permission. Assis dans le train militaire qui filait du nord au sud, j'étais d'une lenteur exaspérante. En contemplant les cotonniers en fleurs de part et d'autre de la route, mon cœur était empli d'une nostalgie infinie pour mon oncle Tung.
La situation était encore compliquée et m'empêchait d'aller sur la tombe de mon oncle. Comment l'annoncer à ma grand-mère ? Je suis descendue à la gare de NB à minuit, j'ai pris mon sac à dos et j'ai marché. À l'aube, je suis arrivée au fromager à l'entrée du village. La mère de l'oncle Tung a été la première parente que j'ai rencontrée ; elle était au même endroit onze ans auparavant. Elle tenait la chemise de l'oncle Tung et m'a encouragée : « Vas-y, ma fille, tes jambes seront fortes et tes épaules souples. Tes amis t'attendent au bus. »
Connaissant son état, je ne pus retenir mes larmes. Je lui pris la main et lui dis mon nom. Elle laissa tomber la faucille et le panier, me serra fort dans ses bras et pleura : « Ce fils ingrat, Tung, pourquoi n’est-il pas revenu ? Il a laissé sa mère seule et vieille comme ça. Oh, mon fils ! »
Sachant qu'elle était dans la lune, j'ai fait semblant de lui demander de me raccompagner, prétextant avoir oublié le chemin. Comme si elle se réveillait brusquement, elle m'a grondé : « Ton père, où que tu ailles, tu dois toujours penser à ta ville natale, c'est humain. C'est très mal. » Puis elle m'a de nouveau saisi le bras en murmurant : « Vas-y, sois fort et courageux. »
Tout comme ce matin-là, lorsque je tenais la main de l’oncle Tung. Ce matin-là, c’était la saison des fleurs de coton. Le vent de la rivière Nguon soufflait encore dans la cime des arbres, et de nombreuses fleurs de coton tombaient comme des larmes couleur de sang sur nos têtes, à ma grand-mère et à moi. Comme pour partager, comme pour compatir.
Ma carrière militaire s'est poursuivie en première ligne pour protéger la frontière sud-ouest, puis j'ai combattu les expansionnistes du Nord. En 1980, alors que le calme était revenu, j'ai été démobilisé. À mon retour à midi, ma femme était encore au front et mes enfants n'avaient pas encore fini l'école. La maison de trois pièces était silencieuse et déserte ; seule elle était assise, recroquevillée près du hamac en jute, ses cheveux blancs ébouriffés.
Le sac à dos imbibé du sang de l'oncle Tung que j'avais rapporté d'il y a quelques années était soigneusement roulé et déposé dans le hamac. D'une main, elle tenait le bord du hamac et le berçait doucement, tandis que de l'autre, elle agitait l'éventail de feuilles de palmier. Je parlai doucement ; elle leva les yeux et murmura : « Ne parle pas fort, laisse-le dormir. Il vient de rentrer. Mon fils est affaibli, et pourtant, il a dû se battre dans la jungle des bombes et des balles pendant tant d'années. Je le plains tellement ! » Je détournai discrètement le visage pour cacher mes larmes.
J'ai posé des questions sur le sac à dos de l'oncle Tung, et ma femme m'a expliqué : « C'est très étrange, chéri. Pendant plusieurs jours, elle n'arrêtait pas de montrer du doigt le coffre que tu as accroché à la poutre en pleurant : “Tung est dans ce coffre. S'il te plaît, pose-le avec moi. Il me fait tellement pitié.” Je ne pouvais plus le lui cacher, alors je l'ai décroché, et dès qu'elle l'a ouvert, elle a serré le sac à dos contre elle en sanglotant de tendresse. À partir de ce moment-là, elle a cessé d'errer. Chaque jour, elle s'asseyait, le dos courbé, berçant le hamac et murmurant des berceuses tristes. »
Je suis restée à la maison quelques jours. À cette époque, la mère de l'oncle Tung était très faible. Le jour, elle berçait son bébé dans un hamac, et la nuit, elle murmurait : « Tung ! Pourquoi ne reviens-tu pas auprès de maman ? Grand-père ! Pourquoi ne m'emmènes-tu pas chercher un moyen de rentrer au village ? Je suis encore si jeune. Un corps d'étudiant est comme une jeune pousse de bambou. Comment pourrais-je supporter d'être envoyée au champ de bataille pour toujours, mon enfant ? »
À ce rythme, la vieille dame ne vivrait plus longtemps. Le seul moyen de retrouver la dépouille de l'oncle Tung et de la ramener au village serait de l'aider à se rétablir un peu. Tant que je ne remplirai pas ce devoir sacré, ma conscience me rongera tellement que j'en oublierai de manger et de dormir.
Fort de ce bref répit, je pris la résolution de partir à la recherche de la dépouille de mon oncle Tung afin de la faire reposer auprès de son père au cimetière des martyrs de ma ville natale. Un de mes camarades travaillait alors au commandement militaire provincial de Tay Ninh . Confiant, je me mis en route, certain de mener à bien ma mission.
Mon compagnon d'armes s'interrogeait et en discutait avec moi : « Tu ne connais que le nom vague du ruisseau Tha La. Il y a plusieurs endroits appelés Tha La dans cette province. Sais-tu de quel Tha La il s'agit ? Traverser un ruisseau peu profond, puis être bombardé au milieu du ruisseau et la route bloquant la marche, je suppose qu'il pourrait s'agir du ruisseau Tha La à Tan Bien. »
Là-bas, une nouvelle commune économique a été créée. Si le kapokier et la tombe de l'oncle Tung sont abattus et détruits, il sera très difficile de la retrouver. Je suis occupé à étudier la résolution pendant encore une semaine. Le plus tard sera le mieux. Tu peux prendre mon Six-Seven et y aller en premier. J'appellerai les gars du district et de la nouvelle commune économique pour nous aider.
J'ai roulé directement de la ville de Tay Ninh jusqu'au district de Tan Bien. Arrivé au carrefour de Dong Pan, j'ai été surpris de découvrir un marché animé, où une foule de gens achetaient et vendaient. De là, une route menait à la nouvelle commune économique, puis aux rives du ruisseau Tha La. J'étais soulagé, pensant avoir peut-être trouvé l'endroit où mon oncle était décédé cette année-là.
J'étais fou d'inquiétude car, après seulement quatre ans de paix, la voie de communication qui passait autrefois sous les arbres de la forêt n'offrait plus l'ombre d'aucun vieil arbre. Devant moi s'étendaient à perte de vue des champs de canne à sucre et de manioc d'un vert éclatant. Les traces du passé étaient-elles encore visibles ?
Dieu merci, le kapokier au cœur de la forêt, qui avait longtemps abrité la tombe hâtive de mon oncle, était toujours là. Il gazouillait et m'appelait de ses flammes éclatantes qui se reflétaient dans le ciel bleu sans nuages de mars. Le moignon de sa branche, pointant vers le croissant de lune ce soir-là, portait encore les stigmates du deuil.
L'endroit où les éclats de bombe avaient arraché une grande partie de l'écorce de l'arbre laissait encore apparaître un profond trou noir, imprégné de fumée. Je supposai que la nouvelle zone économique commençait au pied de cet arbre. De nombreuses maisons au toit de chaume et aux murs de terre, toutes de même taille et de même style, donnaient sur le chemin de terre rouge rectiligne.
Dans chaque carré de cour en terre battue, des enfants erraient avec des poules et des canards. Garant mon vélo sous le couvert d'un kapokier qui ombrageait la moitié de la route, je me tenais nerveusement devant le portail en bambou ouvert, plissant les yeux pour apercevoir le kapokier niché à l'intérieur de la clôture d'un jardin d'environ trois sao nord de large.
Une petite maison dont la façade était faite de planches fraîchement sciées qui conservaient encore la teinte rougeâtre du bois. La porte d'entrée, grande ouverte, laissait apparaître ses deux panneaux de bois. Assis par terre, un homme torse nu. Ou plutôt, à moitié nu. J'aperçus bientôt deux cuisses noires et courtes qui dépassaient de son short.
Une planche de bois, sur laquelle était griffonnée l'inscription : « Tu Doan répare les serrures, répare les voitures et gonfle et comprime les pneus », était accrochée en haut de la colonne où il était assis. Je lui demandai : « Monsieur, puis-je vous rendre visite ? » Il répondit doucement, sans indifférence ni enthousiasme : « Que se passe-t-il ? Avez-vous besoin de faire réparer votre voiture ? » « Non, mais oui. »
J'ai conduit la moto dans la cour, relevé la béquille centrale et lui ai demandé de retendre la chaîne. Elle était trop lâche et cliquetait sans cesse. En s'appuyant sur la chaise en bois et en se penchant en avant, le propriétaire a rampé jusqu'à la moto. Pendant qu'il resserrait les vis, j'ai engagé la conversation : « Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu d'accident ? » « Quel genre d'accident ? Je suis un ancien combattant handicapé. »
En mars 1975, j'étais encore à l'hôpital militaire de la République. Après la libération, l'hôpital militaire révolutionnaire a continué à me soigner jusqu'à ma guérison complète. En 1976, ma femme, mes deux enfants et moi nous sommes portés volontaires pour venir ici construire un nouveau village économique. Nous y avons vécu paisiblement jusqu'à présent.
Il demanda de nouveau : « Où êtes-vous, vous et vos enfants ? » « Leur mère va travailler à l’usine de transformation d’amidon, où elle épluche des graines de manioc. Les deux enfants vont à l’école le matin et travaillent avec leur mère l’après-midi. » Il demanda encore : « Y a-t-il beaucoup de pénuries ? » « Quand on en sait assez, on en a assez. Des légumes du jardin. Du riz du marché. Trois repas complets par jour et une bonne nuit de sommeil. »
J'ai désigné le coin du jardin devant la maison où l'herbe était si dense qu'aucun arbre ne pouvait être planté à cause de l'ombre du kapokier. J'ai demandé : « J'ai entendu dire qu'à l'époque, lorsqu'on défrichait la forêt pour créer une nouvelle zone économique, on a abattu tous les arbres, grands et petits, mais pourquoi ce kapokier a-t-il été épargné ? » « Quand je suis arrivé pour prendre possession de la maison, j'ai vu cet arbre. Je me posais les mêmes questions que vous. J'ai interrogé les anciens occupants, et ils m'ont tous répondu : il semble y avoir une sorte de présence spirituelle autour de cet arbre. Chaque bûcheron qui est venu l'abattre a renoncé, le visage blême. »
Le chef d'équipe claqua alors la langue : « Laissez-la là, elle fleurira à chaque saison et embellira le paysage. » Chacun se disputa la maison et le terrain résidentiel à l'entrée de la commune. Au bout de quelques jours, tous demandèrent à déménager. À la question « Pourquoi ? », ils secouèrent tous la tête en silence. Ma famille est arrivée en dernier et y vit paisiblement depuis.
Une chose est sûre : dites aux soldats de ne pas m’accuser de propager la superstition. Il est vrai que j’ai demandé plusieurs fois à un peintre d’abattre ce fromager, mais je n’ai pas pu m’y résoudre. Car chaque année, des dizaines de fois, je rêve d’un très jeune soldat qui sort du fromager, au coin du jardin, et vient chez moi pour m’inviter à boire un verre.
Chaque soirée arrosée était bondée, qu'elle soit organisée par l'Armée de Libération ou l'Armée de la République du Vietnam. On s'embrassait, on dansait et on chantait des airs jaunes et rouges. Le lendemain matin, mon haleine sentait encore l'alcool. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, en sa présence, j'étais un soldat sur deux jambes, si heureux et insouciant. Quand je ne le voyais pas depuis longtemps, je me sentais si triste et si distrait.
C’est alors seulement que j’ai dit la vérité : « Ce soldat est peut-être mon oncle. C’est là, dans les hautes herbes, que nous l’avons enterré il y a plus de dix ans. Il y a encore une pierre de latérite à l’endroit où nous l’avons marqué. Merci de l’avoir conservée intacte, cela me permet de ramener mon oncle dans sa ville natale. » À ces mots, Tu Doan a failli tomber à la renverse. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s’est ouverte et il a répété : « C’est vraiment Linh, c’est vraiment Linh. Nous avons vécu ensemble si longtemps et pourtant nous n’avions pas pensé à brûler de l’encens pour lui le jour de la pleine lune. Quel dommage ! »
M. Doan et moi avons nettoyé l'herbe dans le coin du jardin. Le sommet de la roche latéritique dépassait d'une dizaine de centimètres du sol. Cela prouvait que, depuis cette nuit-là, la tombe de l'oncle Tung était restée intacte. J'ai brûlé tout l'encens et disposé les offrandes que j'avais apportées de ma ville natale sur le monticule de terre. À genoux, j'ai incliné la tête et joint les mains pour rendre hommage à l'oncle Tung à trois reprises, laissant couler deux larmes sur sa tombe que l'on venait de débarrasser des épines.
Tu Doan, un vétéran handicapé, était assis à côté de moi. La tête baissée, les larmes ruisselaient sur son visage. Il murmura : « Je vous prie respectueusement de me pardonner d'être resté si longtemps auprès de vous sans même un bâton d'encens à vous offrir. » Je le consola : « Ce n'est pas ma faute si je l'ignore. Les esprits des défunts sont plus tolérants et plus sages que nous, simples mortels, mon ami ! »
L’encens brûlait avec ardeur sur la tombe de l’oncle Tung. Le midi de mars était calme et paisible, les fleurs de coton rouge vif tombaient doucement sur le sol. Cette année, elles semblaient d’une fraîcheur inhabituelle, moins tristes que celles des saisons où le pays était encore enveloppé de fumée et de flammes.
VTK
Source


![[Photo] Da Nang : Des centaines de personnes se mobilisent pour nettoyer un axe touristique majeur après le passage de la tempête n° 13](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/07/1762491638903_image-3-1353-jpg.webp)
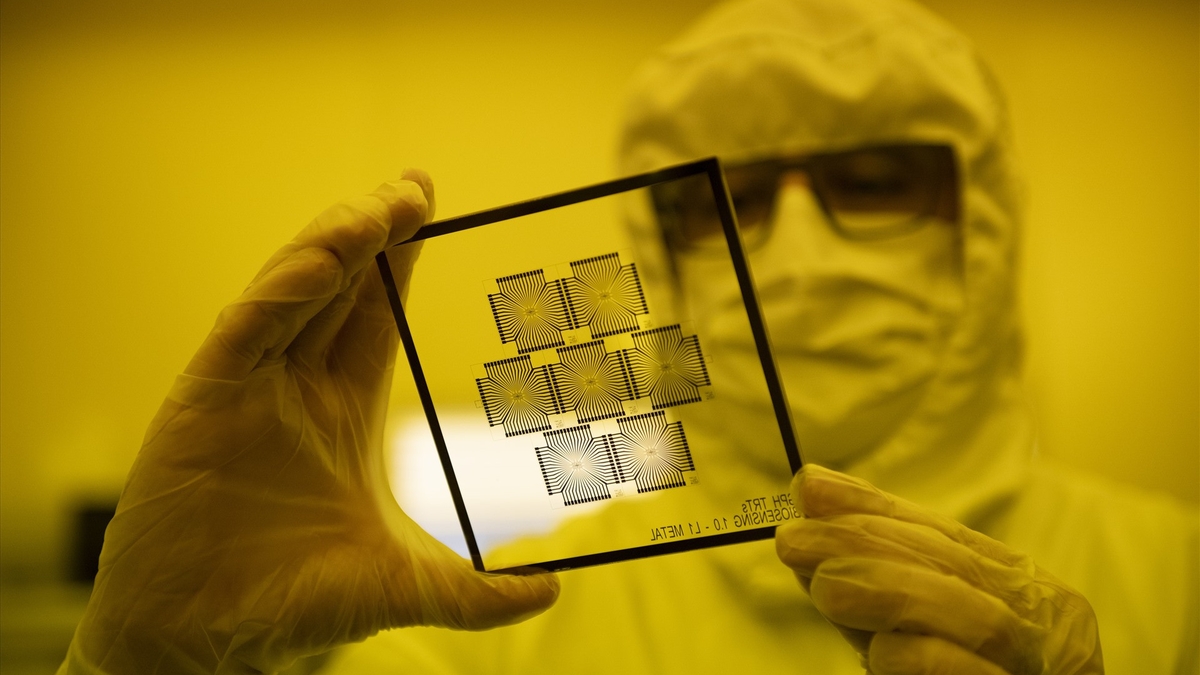




















































































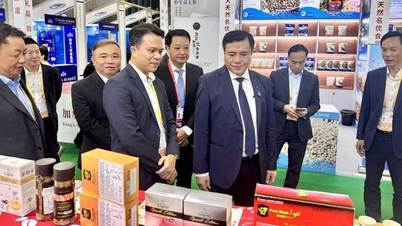













Comment (0)