Les Nung du hameau de Dia Tren, commune de Phuc Sen (district de Quang Hoa, Cao Bang), racontent encore à leurs enfants et petits-enfants l'art ancestral du papier. Ce matériau est principalement utilisé pour la fabrication de papier votif, mais il est aussi parfois utilisé pour copier des généalogies familiales, des chants folkloriques, ou pour décorer des autels. Aujourd'hui, grâce aux cours de fabrication de produits touristiques , le papier est utilisé pour la fabrication de recueils de poésie, de papier à dessin, d'éventails, de sacs à main et de nombreux autres objets décoratifs.

Éventails en papier fabriqués après le cours comme cadeaux de voyage du projet
« Ce sont des éventails en papier que les sœurs ont fabriqués après avoir suivi une formation en artisanat traditionnel, dans le cadre du projet « Préserver et développer l'artisanat traditionnel associé au tourisme dans le géoparc de Non Nuoc Cao Bang », parrainé par le Vingroup Innovation Fund (VinIF). Le jour même, après la fin de la formation, les sœurs ont pris une photo ensemble », a expliqué le Dr Bui Thi Bich Lan, directrice adjointe de l'Institut d'ethnologie de l'Académie des sciences sociales du Vietnam et cheffe de projet.
Le projet, mené depuis près de deux ans, mobilise des chercheurs issus de disciplines variées telles que l'ethnologie/anthropologie, la culture et le tourisme, partageant la même passion pour la préservation et la valorisation de l'artisanat traditionnel, la valorisation du potentiel touristique du géoparc de Non Nuoc Cao Bang, et la promotion du développement socio-économique et de la réduction durable de la pauvreté dans les zones peuplées de minorités ethniques, dans un contexte d'intégration. Le projet vise également à œuvrer en faveur des principes particulièrement mis en avant par le label « Géoparc mondial », à savoir : la protection de l'environnement , la préservation de l'identité culturelle de la communauté où se trouve le patrimoine, et la mobilisation de la communauté pour la préservation et l'exploitation rationnelle du patrimoine.
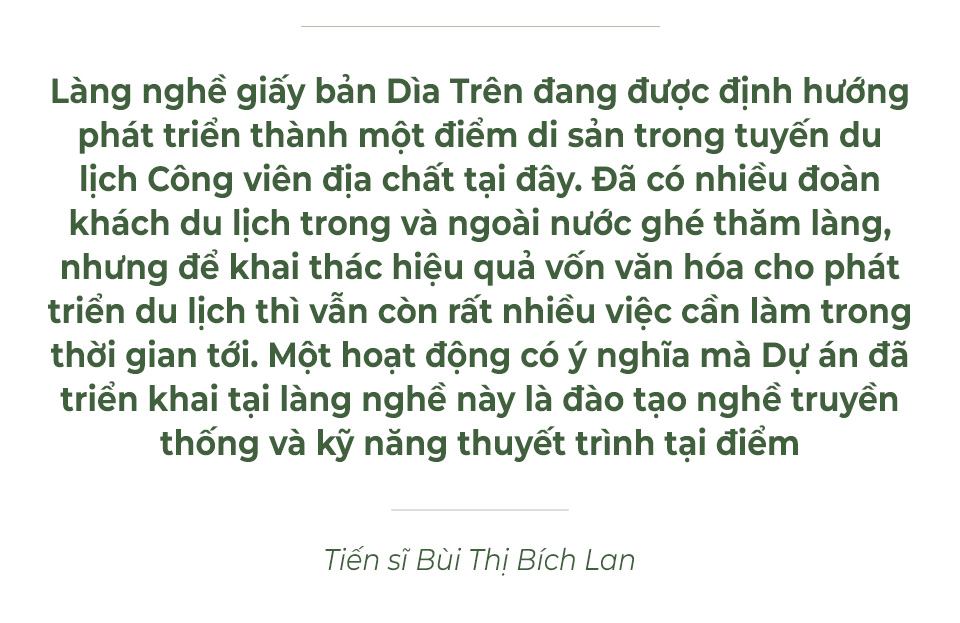
La classe accueille de nombreux intervenants d'horizons divers. Certains sont également des spécialistes de la culture, comme Mme Nong Thi Kinh, une artisane du village artisanal. Avant ce projet, l'usine de production de papier de Mme Kinh était le seul partenaire du géoparc de Non Nuoc Cao Bang. Certains sont enseignants à l'Université de Hanoï et possèdent une longue expérience dans la formation aux métiers du tourisme. Aujourd'hui, bien que le projet ne soit pas terminé, les valeurs transmises à la communauté sont déjà bien présentes.
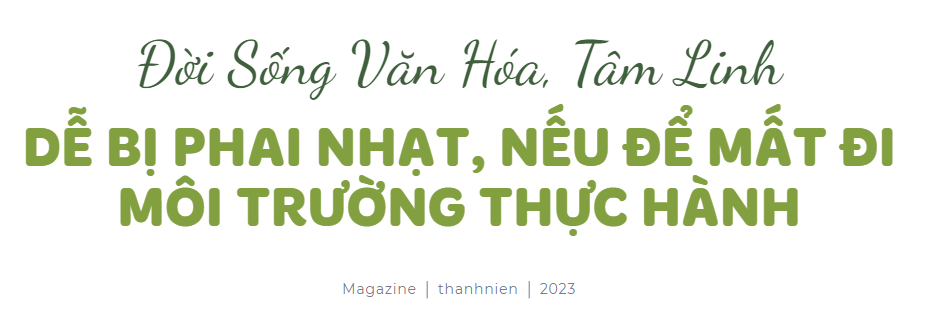
Dans les années 2000, la Faculté d’Histoire de l’Université des Sciences Sociales et Humanités (Université Nationale du Vietnam, Hanoi) proposait également d’autres filières attractives, comme l’archéologie, la culture ou l’histoire du monde… Pourquoi avoir choisi l’Ethnologie ?
À cette époque, j'ai choisi l'ethnologie par curiosité pour l'espace culturel et social des minorités ethniques. J'ai été convaincu par un stage dans un village thaïlandais de Son La. Le professeur Hoang Luong, lui aussi thaïlandais, était alors mon instructeur. Habitué à la vie urbaine, la première fois que je suis arrivé dans un village des hautes terres, immergé dans cet espace culturel unique, j'ai découvert un monde nouveau et étrange. Nous étions « ensemble » avec les gens comme un membre de la famille : le matin, nous allions chercher de l'eau, nous allions aux champs, l'après-midi, nous retournions à la cuisine pour cuire le riz, le soir, nous dansions sur des bambous, buvions du vin de riz… Fasciné par l'espace culturel des hautes terres, j'ai fait mon choix.
Malgré le climat, les routes éloignées, le manque de commodités...?
À l'époque, j'étais jeune et je ne comprenais pas vraiment les obstacles de ce métier. Plus tard, lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai dû effectuer des voyages d'affaires seul, notamment pour ma thèse de doctorat. Il s'agissait de longs séjours sur le terrain dans les villages du peuple Khang à Son La. Parfois, la barrière de la langue et les difficultés de la vie sur le terrain m'ont amené à me demander si je pouvais continuer dans cette profession.
Les voyages d'affaires dans les hautes terres se sont enchaînés. Passionnée, je me suis rapidement adaptée, j'ai surmonté les obstacles avec aisance, et chaque voyage m'a apporté de nouvelles découvertes et expériences.

Dr. Bui Thi Bich Lan (chemise à carreaux) lors d'une excursion scolaire
Quel était alors le sujet de votre thèse ?
J'ai étudié les moyens de subsistance du peuple Khang, puis proposé des solutions pour un développement économique durable, comme remédier au manque de terres productives ou la transition vers une agriculture commerciale aux impacts négatifs sur l'environnement. La population s'est tournée vers de nouvelles cultures à haut rendement, mais les techniques agricoles et l'utilisation d'engrais chimiques mal dosés ont accéléré la dégradation des terres.
Mais avant cela, ils devaient avoir un moyen de l’exploiter de manière durable, pour qu’il puisse durer des générations ?
Ils cultivent des cultures traditionnelles en utilisant les savoirs locaux. Ces pratiques causent peu de dommages environnementaux, mais leur productivité est très faible. Par conséquent, la plupart des zones cultivées ont été converties en cultures commerciales. Le problème est que lorsque les gens gagnent des revenus et améliorent leurs conditions de vie, leur vie culturelle et spirituelle s'affaiblit, faute d'un environnement propice à la pratique.
Lors de la culture du riz pluvial, les populations pratiquent toute une série de rituels. Au début des semis, on procède à une cérémonie de plantation du riz, et après la récolte, à une nouvelle cérémonie du riz, pour prier et remercier les dieux pour une récolte abondante. Aujourd'hui, avec le passage à des cultures commerciales comme le maïs hybride et le manioc hybride, les cérémonies de culte ne sont plus maintenues. Sans pratiques agricoles, la culture ethnique se perd et la cohésion communautaire s'affaiblit. Préserver la culture ethnique est encore plus difficile, surtout dans un contexte d'échanges et d'intégration forts avec la culture populaire. Cela pose la question du développement durable lorsque la croissance économique doit sacrifier la culture.

Les chercheurs peuvent rapidement identifier le problème. Mais la communauté ressent-elle la perte ?
La jeune génération est prisonnière de l'économie de marché et ne prête pas attention à la perte des valeurs culturelles. Mais les générations plus âgées, elles, s'en préoccupent beaucoup ! C'est comme une loi.
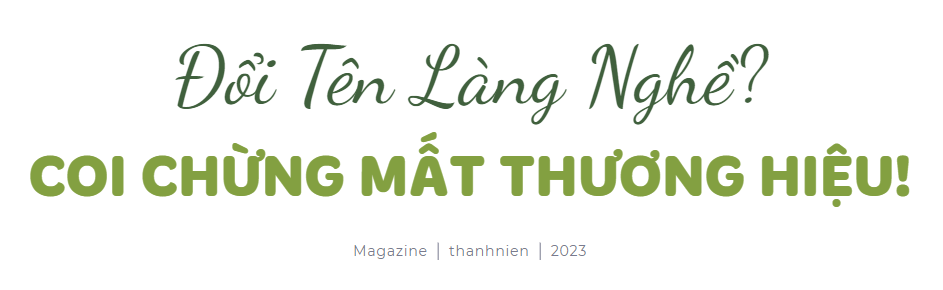
Des ambitions d'étudiant de troisième année ont maintenant disparu depuis des décennies. Ces années d'ethnologie ont sûrement dû être ponctuées d'histoires douloureuses ou heureuses. Cela donne envie de persévérer dans cette profession.
Il y a une histoire qui me hante. C'était un après-midi, alors que j'étais assis à l'épicerie Kinh d'un village Khang. En observant les achats et les ventes des villageois, j'ai aperçu un homme Khang à l'air hagard. Il revenait des champs, un sac d'argent à la main. Interrogé, il m'a dit qu'il venait de vendre un champ de maïs. Je lui ai demandé ce qu'il achetait à l'épicerie ; il a répondu que non, qu'il était là pour rembourser une dette. Il devait de l'argent pour de l'engrais. Mais lorsqu'on lui a demandé combien il devait, il a secoué la tête, incertain.
Il entra dans la boutique et attendit que le propriétaire vérifie le livre, car il ne savait pas calculer et ne pouvait rien écrire, étant illettré. Le propriétaire additionna et soustraya un moment, puis annonça le montant. Il compta encore et encore, mais ce n'était toujours pas suffisant. Il dut donc réclamer davantage, puis s'en alla distraitement.
Je pense qu'ils continueront à emprunter et à rembourser, alors qu'ils ont seulement besoin de savoir qu'ils peuvent emprunter de l'argent, mais ils ignorent le montant des intérêts qu'ils obtiendront, et ils ignorent si un tel investissement dans la production sera rentable. Ils savent seulement qu'ils peuvent gagner plus d'argent en vendant du maïs qu'en cultivant du riz, mais ils ne tiennent pas compte du fait qu'ils ont dépensé de l'argent pour acheter des semences en début de saison, emprunté de l'argent pour acheter de l'engrais au revendeur, et qu'ils doivent payer des intérêts en fin d'année.
Le travail est une réalité, mais les limitations en matière de conscience et de capacité à calculer les dépenses les ont conduits à tomber dans la spirale du « emprunt et remboursement, remboursement et emprunt ». Ce n'est qu'un cas, mais cela se produit dans de nombreux endroits, dans de nombreuses communautés ethniques minoritaires des hautes terres. Cela me hante encore.
Mais il y a aussi des exemples positifs, comme le projet que nous mettons en œuvre dans le géoparc de Non Nuoc Cao Bang. Il a apporté des avantages concrets à la communauté. Après deux courtes formations, de nombreux artisans de Dia Tren maîtrisent désormais la fabrication de produits touristiques et sont prêts à recevoir des commandes importantes. Ils maîtrisent également les techniques de présentation sur place, renforçant ainsi l'attractivité de la destination. L'approche locale est une méthode essentielle pour la réussite du projet. Nous nous rendons au village, au sein de la communauté, « trois ensemble » avec les habitants tout au long du processus de mise en œuvre de la recherche.

De nouvelles destinations touristiques sont le souhait du Dr Bui Thi Bich Lan.
Il existe une précieuse connaissance locale des minorités ethniques. Les politiques qui ne s'appuient pas sur cette connaissance sont souvent difficiles à mettre en œuvre. Avec le projet de préservation de l'artisanat dans le géoparc de Non Nuoc Cao Bang, vos recommandations politiques doivent-elles être nombreuses ?
Une fois ce projet terminé, je transmettrai également à la localité certains résultats de recherche, notamment des propositions et des recommandations intéressantes. Par exemple, conformément à la résolution 18-NQ/TW de la 6e Conférence du 12e Comité central du Parti sur « Questions relatives à la poursuite de l'innovation et de la réorganisation de l'appareil politique afin de le rationaliser et de le rendre plus efficace et efficient », des localités abritant des villages artisanaux traditionnels ont également fusionné et ont été rebaptisées villages, hameaux et groupes résidentiels. Cela a entraîné la disparition soudaine de célèbres villages artisanaux, existant depuis des siècles à Cao Bang, ce qui est très regrettable. Par exemple, le village d'encens de Phia Thap est devenu, après sa fusion, le village de Doan Ket ; le village sucrier de Bo To est désormais classé dans le groupe résidentiel 3.
Le nom d'un village artisanal n'est pas un simple nom, il renferme de nombreuses significations et valeurs liées à sa culture et à son histoire, et contribue à en créer l'image de marque. La fusion et le changement systématiques de noms des villages artisanaux, conformément à la politique générale, ont involontairement fait disparaître le nom du village artisanal, bâti par de nombreuses générations d'ancêtres.

Le village de canne à sucre de Bo To est meilleur grâce au projet d'orientation du tourisme culturel
Si l'on examine la situation du point de vue d'un gestionnaire, on constate que la fusion est une politique courante et donc indispensable. Cependant, du point de vue d'un chercheur, dans des cas particuliers comme les villages artisanaux traditionnels, une réflexion approfondie est nécessaire. Prenons l'exemple du village d'encens de Phia Thap. La marque d'encens Phia Thap est réputée dans toute la région du Nord-Est, voire dans tout le pays, depuis des générations. Il est donc envisageable de conserver les noms de ces villages artisanaux, plutôt que de les obliger à changer de nom. Ainsi, la politique commune est toujours appliquée et les noms des villages artisanaux préservés. Ce qui s'est passé m'inquiète et me désole. De toute évidence, de nombreuses questions relatives à la gestion et à la protection du patrimoine de notre région de Géoparc mondial doivent être abordées à l'avenir.
Merci!
Lien source


































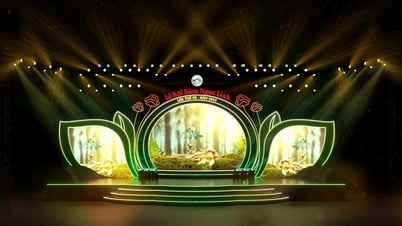

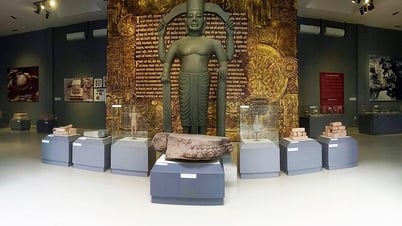
































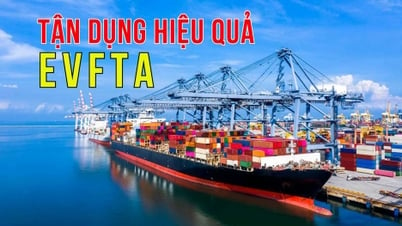




















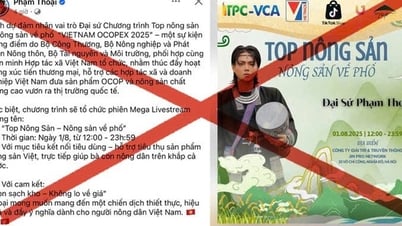






Comment (0)