L'élection présidentielle américaine de 2024, qui se tiendra le 5 novembre, opposera la vice-présidente sortante Kamala Harris à l'ancien président Donald Trump. Cet événement politique majeur pourrait constituer un tournant décisif et avoir un impact profond sur la démocratie américaine ainsi que sur la position du pays dans le monde, notamment dans un contexte de conflits et de troubles internationaux.
Bien que M. Trump soit confronté à de nombreux recours juridiques, cela n'a pas entamé le soutien dont il bénéficie auprès des électeurs. La possibilité qu'il remporte l'élection reste donc très élevée.
Et si cela se produit, la politique étrangère américaine deviendra une préoccupation majeure tant pour les États-Unis que pour le monde .
En matière de politique étrangère
Bien que de nombreuses personnes craignent actuellement qu'une victoire de M. Trump n'entraîne de nombreux changements dans la politique étrangère américaine, la plupart des experts s'accordent à dire que, que ce soit Mme Harris ou M. Trump qui l'emporte, les différences en matière de politique étrangère américaine ne seront pas trop importantes.
Si M. Trump est réélu, il maintiendra vraisemblablement son style diplomatique « erratique et conflictuel », notamment avec les alliés de l’OTAN, comme lors de son premier mandat. Cependant, lors d’un second mandat, il pourrait mettre en œuvre une politique étrangère très proche de celle de M. Biden, en particulier sur des dossiers importants pour les États-Unis tels que l’Ukraine, la Chine ou le Moyen-Orient.
conflit russo-ukrainien
Depuis le début du conflit russo-ukrainien, l'administration Biden-Harris a concentré ses efforts sur le soutien à Kiev, malgré l'opposition de nombreux élus républicains et les perspectives de plus en plus sombres que Kiev puisse gagner ou reconquérir les territoires perdus.
Cependant, les observateurs politiques estiment que si M. Trump est réélu, la politique américaine envers l'Ukraine changera considérablement et il est très probable que les États-Unis réduiront leur aide à Kiev.
Toutefois, rien ne garantit que Mme Harris maintiendra l'aide actuelle à l'Ukraine si elle remporte l'élection, surtout compte tenu de l'évolution défavorable de la situation sur le terrain ukrainien en 2023.
De manière générale, les experts politiques internationaux s'accordent à dire que Mme Harris et M. Trump tenteront tous deux de pousser l'Ukraine à négocier la fin de la guerre après janvier 2025 et que l'accord conclu pourrait être plus proche des objectifs de la Russie que de ceux de Kiev.
La Chine et les sujets brûlants en Asie
Durant sa présidence, M. Trump a abandonné de manière décisive la politique de coopération économique avec la Chine que les États-Unis avaient précédemment mise en œuvre, déclenchant ainsi une guerre commerciale coûteuse. L'administration américaine, sous la présidence de M. Biden, a poursuivi cette politique, en renforçant même les mesures à l'encontre de la Chine afin d'entraver les efforts de Pékin dans certains secteurs clés tels que la technologie et les semi-conducteurs.
En réalité, la politique américaine à l'égard de la Chine est l'un des rares sujets qui bénéficient d'un large consensus bipartisan aux États-Unis. M. Biden et Mme Trump s'accordent à dire que la Chine est la seule puissance internationale à avoir à la fois la volonté et la capacité de remettre en cause l'ordre mondial dominé par les États-Unis. Par conséquent, que M. Trump ou Mme Harris remporte l'élection, la politique américaine vis-à-vis de la Chine restera globalement inchangée.
Par ailleurs, pour les alliés asiatiques, si M. Trump l'emporte, son approche pourrait se révéler plus intransigeante, car lors de son précédent mandat, il leur a reproché à maintes reprises leur trop grande dépendance à l'égard de la protection américaine. Toutefois, il ne pourra certainement pas les abandonner, surtout dans un contexte de concurrence stratégique de plus en plus féroce avec la Chine dans la région.
Par ailleurs, la politique de M. Trump à l'égard de l'Asie et des questions régionales sensibles telles que Taïwan, la mer de Chine méridionale et la concurrence stratégique avec la Chine sont des sujets qui doivent être surveillés de près.
Le « fourneau » du Moyen-Orient
On constate que les administrations Trump et Biden ont des approches similaires concernant la question du Moyen-Orient et, quel que soit le vainqueur de la prochaine élection présidentielle, la politique américaine envers le monde arabe ne sera pas très différente.
En tant que président des États-Unis, M. Trump a abandonné l'accord nucléaire avec l'Iran, également connu sous le nom de Plan d'action global commun (JCPOA), le 8 mai 2018, a transféré l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem et a fermé le bureau consulaire américain chargé des affaires palestiniennes à Washington.
M. Trump a œuvré pour la normalisation des relations d'Israël avec le monde arabe, mais n'a rien fait pour remédier au sort de millions de Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Parallèlement, la politique de l'administration Biden concernant le Moyen-Orient reste, comme prévu, très différente. En effet, cette administration a mis en œuvre une politique consistant à la fois à soutenir la campagne d'Israël contre le Hamas et à promouvoir une solution à deux États pour instaurer la paix et la stabilité dans la région, malgré l'opposition de son allié israélien. Si elle est élue, Mme Harris devrait poursuivre la politique de son prédécesseur.
Jusqu'à présent, les actions des États-Unis ont surtout consisté à réagir à l'évolution de la situation sur le terrain, sans parvenir à la résoudre fondamentalement. Les États-Unis sont actuellement confrontés à un dilemme : comment protéger leur allié israélien tout en apaisant le monde arabe ?
Par ailleurs, le dilemme des États-Unis s'est accentué suite à la récente escalade des tensions entre Israël et l'Iran. Actuellement, les États-Unis prônent la paix et la non-escalade. Cependant, si la situation venait à se compliquer, menaçant la sécurité de leur allié israélien et leurs intérêts stratégiques dans la région, il n'est pas exclu que les États-Unis sollicitent l'intervention de leurs alliés déployés au Moyen-Orient (comme le Royaume-Uni et la France).
Malgré des baisses ponctuelles de priorité, le Moyen-Orient demeure l'une des zones les plus stratégiques pour les États-Unis. Par conséquent, la politique américaine à l'égard du Moyen-Orient devrait rester globalement inchangée dans les prochains mois.
Cependant, les changements que M. Trump pourrait apporter à la politique américaine au Moyen-Orient seraient considérables. Il est possible que son administration intensifie ses efforts pour affaiblir l'économie iranienne, renforcer les liens avec les pays du Golfe afin de promouvoir la normalisation des relations avec Israël et de consolider la coopération en matière d'endiguement, avec pour objectif ultime l'affaiblissement de l'Iran.
Il est également possible que M. Trump décide de retirer les forces américaines de Syrie et d'Irak. Et bien sûr, la nouvelle administration Trump n'accueillera pas favorablement les réfugiés, et encore moins les réfugiés musulmans.
Relations avec l'OTAN
Alors que l'administration Biden-Harris prône une politique d'amélioration des relations avec l'Europe, Donald Trump pourrait créer de graves problèmes pour de nombreux pays européens s'il était élu. Durant sa présidence, Trump a souvent critiqué l'OTAN et souhaité réduire la contribution financière de cette dernière à l'organisation.
Il est possible que M. Trump trouve un moyen de retirer les États-Unis de l'OTAN malgré l'opposition des milieux diplomatiques et de défense américains. Cependant, de nombreux experts politiques estiment qu'il s'agit plutôt d'une simple manœuvre de négociation visant à inciter les alliés des États-Unis à augmenter leurs dépenses de défense et à alléger le fardeau pesant sur Washington. De plus, certains pensent que ses récentes déclarations montrent que M. Trump est moins enclin qu'auparavant à évoquer un retrait des États-Unis de l'OTAN. Il a affirmé que les États-Unis resteraient « à 100 % au sein de l'OTAN sous sa direction tant que les pays européens joueraient le jeu ».
L'Europe attend toujours avec anxiété les résultats de l'élection présidentielle américaine, car il est clair qu'une victoire de M. Trump engendrera de nouvelles inquiétudes. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que la réélection de M. Trump constituerait une menace pour l'Europe.
Préparatifs des États-Unis et de leurs alliés
La confrontation entre la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump, ainsi que la possibilité d'une victoire de ce dernier, suscitent des inquiétudes quant à la politique étrangère américaine à venir. Par conséquent, l'administration américaine actuelle et ses principaux alliés élaborent activement des stratégies pour faire face aux défis potentiels.
Aux États-Unis, les cercles politiques pourraient être en train de discuter de scénarios potentiels, le Département d'État, le Conseil national de sécurité et le Département de la Défense participant à des activités de planification de scénarios pour évaluer les répercussions potentielles de différents résultats politiques dans une hypothétique administration Trump.
Sur le plan juridique, cependant, l'administration Biden pourrait se heurter à des obstacles pour freiner la mise en œuvre des politiques de Trump après une éventuelle défaite électorale, notamment si la Chambre des représentants reste aux mains des républicains après les élections.
Fin 2018, le Congrès américain a adopté une loi de finances de la défense incluant une disposition empêchant le président de se retirer unilatéralement de l'OTAN sans l'accord du Congrès ou sans une loi de ce dernier. Cette disposition souligne l'engagement des États-Unis envers l'OTAN, engagement que l'administration Biden-Harris a pris plus au sérieux que la précédente, notamment sur la question ukrainienne.
De plus, compte tenu de la politique étrangère de M. Trump, il est envisageable que non seulement le gouvernement américain, mais aussi d'autres pays, notamment les alliés des États-Unis, prennent des mesures pour adapter leurs politiques à la situation à venir. Les alliés des États-Unis s'emploient d'ailleurs activement à protéger ou à promouvoir leurs intérêts au cas où M. Trump reviendrait au pouvoir.
Plusieurs entretiens menés par Reuters auprès de diplomates et de responsables gouvernementaux du monde entier laissent entrevoir des préparatifs en vue d'un « scénario Trump 2.0 ». Le Mexique, par exemple, a évoqué la possibilité de nommer un nouveau ministre des Affaires étrangères connaissant bien M. Trump lors des élections de juin, tandis que l'Australie a discuté du rôle de son envoyé spécial dans la protection des contrats relatifs aux sous-marins.
Les autorités allemandes s'efforcent d'accélérer les négociations avec les gouverneurs républicains des États américains, alors que l'Allemagne investit massivement dans l'industrie américaine. Parallèlement, en Asie, le Japon, allié des États-Unis, prend également des mesures pour renforcer son engagement diplomatique auprès de la future administration Trump, craignant que ce dernier ne réactive le protectionnisme commercial et n'exige une contribution accrue du Japon au budget du maintien des forces américaines sur son territoire.
Les résultats de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre suscitent un vif intérêt non seulement chez les électeurs américains, mais aussi dans le monde entier, car ils influencent non seulement la politique intérieure des États-Unis, mais aussi les enjeux internationaux. Outre les affaires intérieures, les questions majeures de la politique étrangère américaine, qu'il s'agisse de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de la Chine ou des tensions transatlantiques, serviront de prisme aux électeurs américains pour évaluer le jugement et les politiques à venir du président des États-Unis.
Quel que soit le candidat vainqueur, cela pourrait signaler des changements dans la politique étrangère américaine susceptibles de façonner la trajectoire des relations internationales pour les années à venir.
Selon FP, Economist et WSJ
Dantri.com.vn
Source : https://dantri.com.vn/the-gioi/du-bao-chinh-sach-doi-ngoai-cua-my-neu-ong-donald-trump-thang-cu-20241102231352126.htm


![[Photo] Inondation sur le côté droit de la porte, entrée de la citadelle de Hué](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761660788143_ndo_br_gen-h-z7165069467254-74c71c36d0cb396744b678cec80552f0-2-jpg.webp)
![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion pour discuter des solutions à apporter aux conséquences des inondations dans les provinces centrales.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761716305524_dsc-7735-jpg.webp)
![[Photo] Hue : À l'intérieur de la cuisine qui distribue des milliers de repas par jour aux personnes sinistrées dans les zones inondées](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761738508516_bepcomhue-jpg.webp)











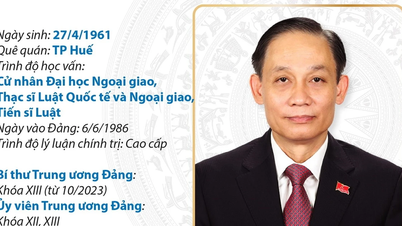




































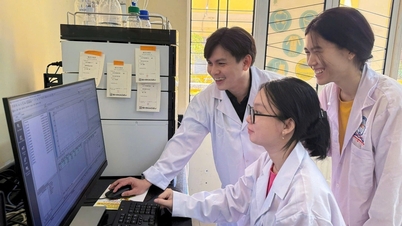
















![[Infographie] Situation socio-économique du Vietnam sur 5 ans (2021-2025) : des chiffres impressionnants](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761730747150_anh-man-hinh-2025-10-29-luc-16-38-55.png)




































Comment (0)